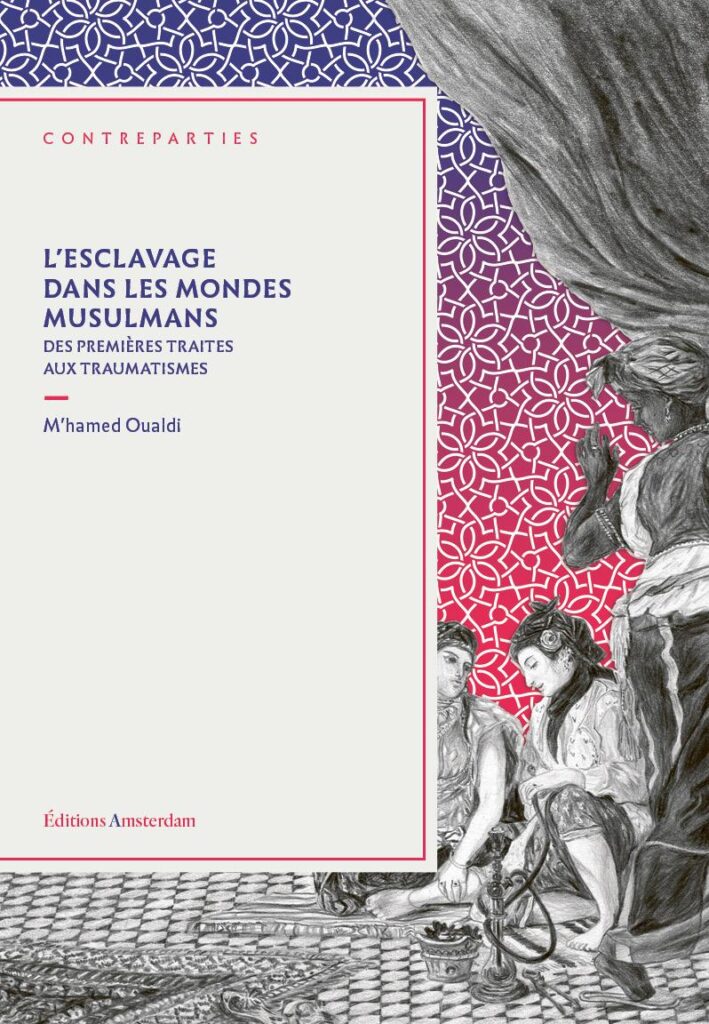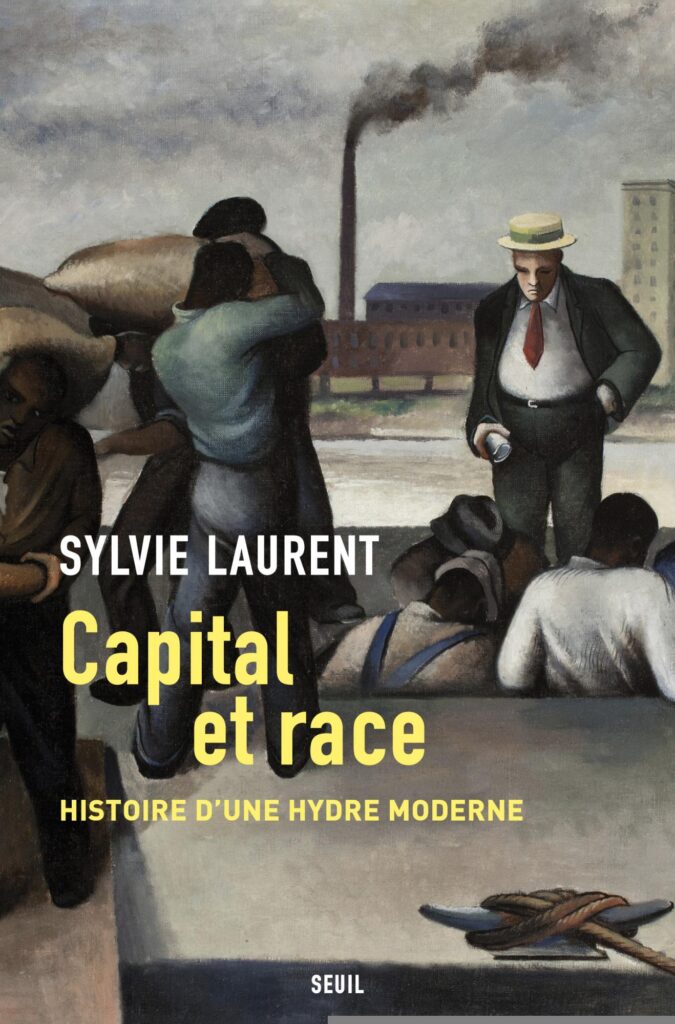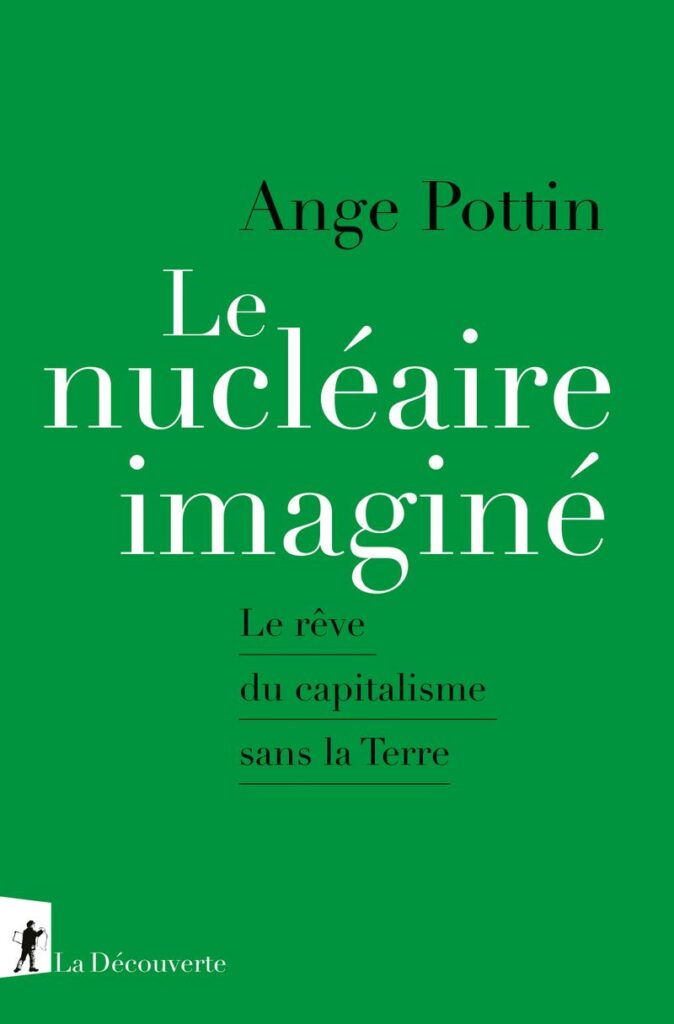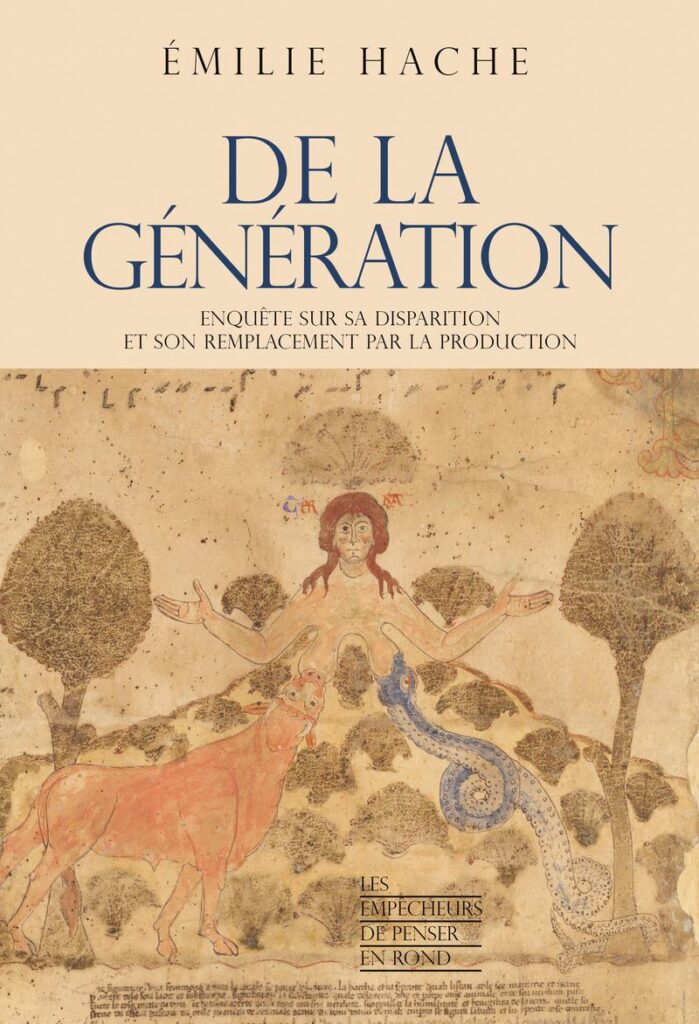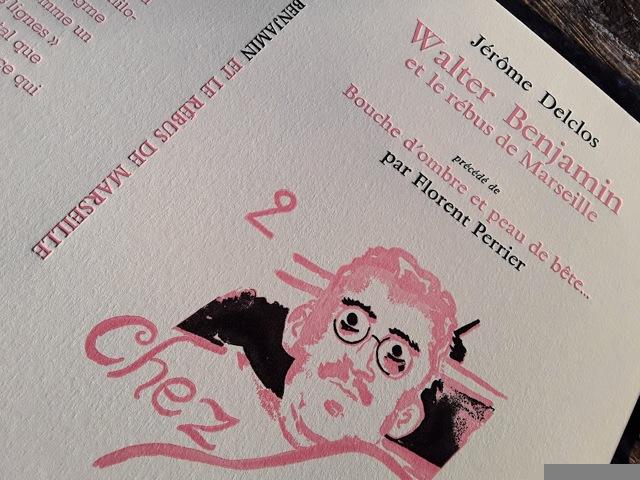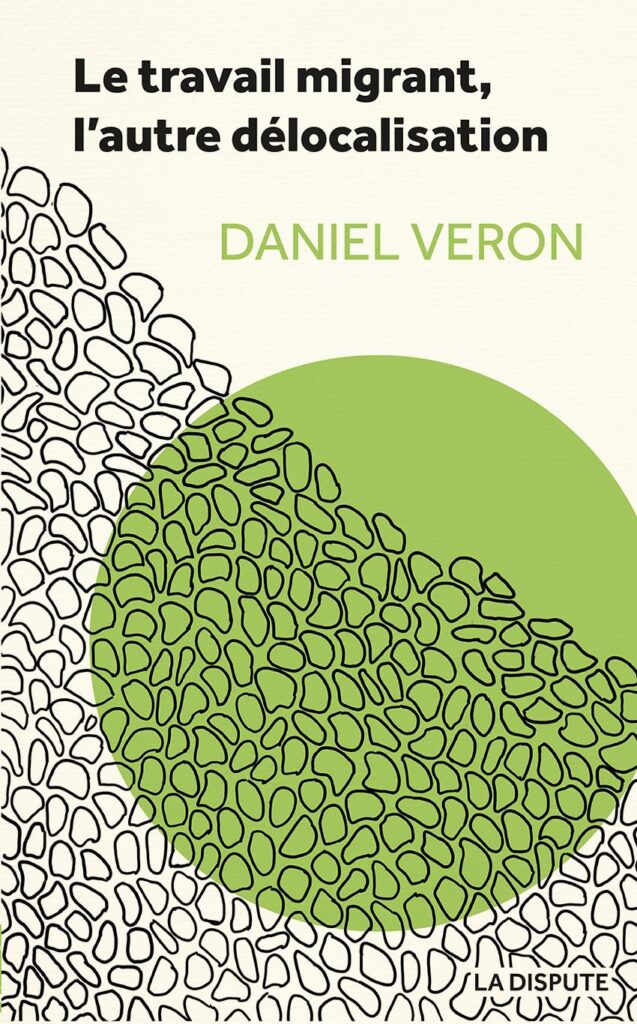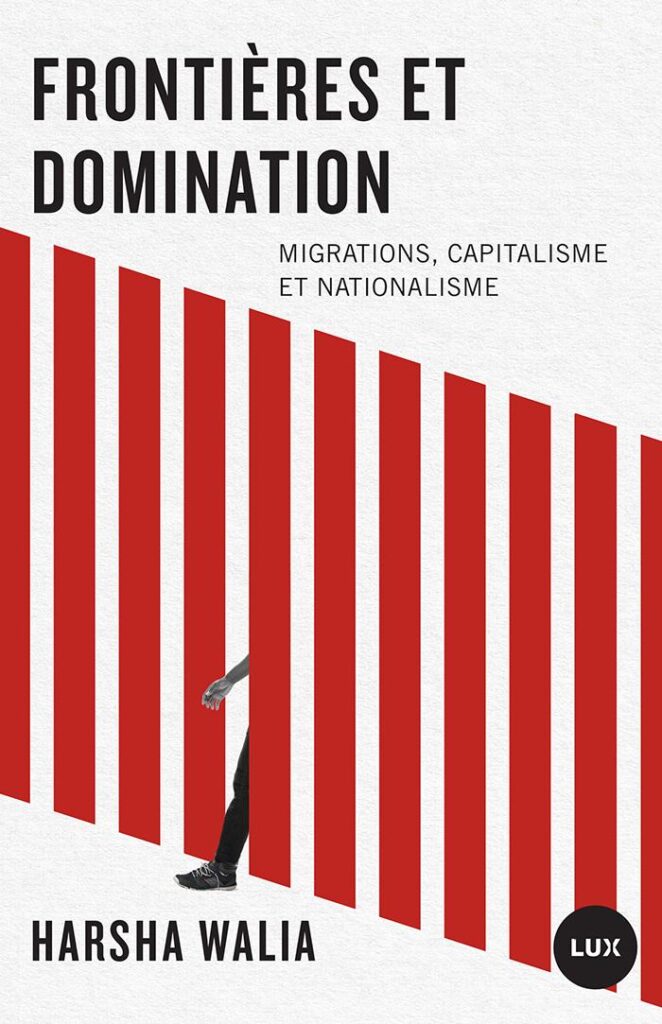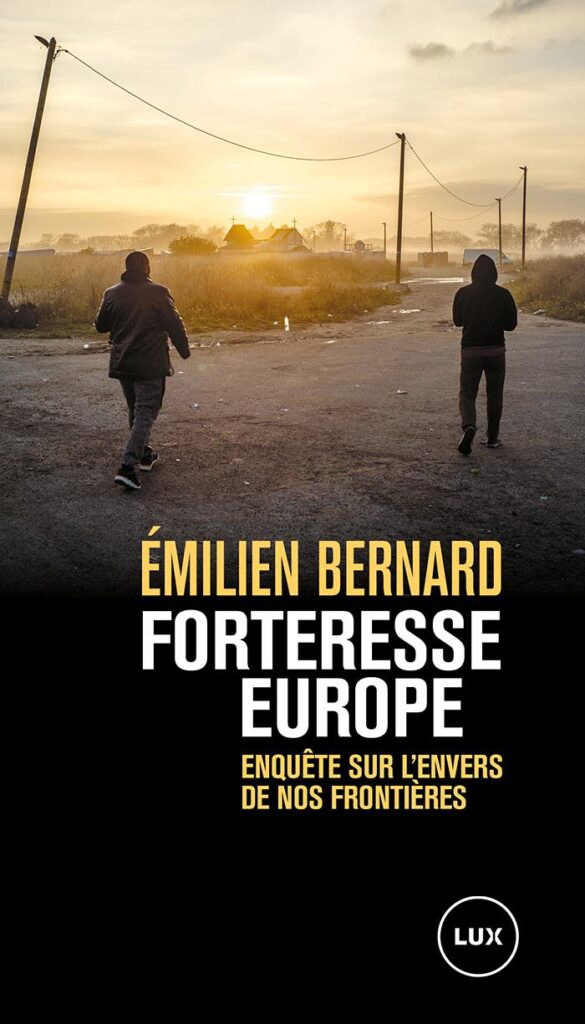Ilan Pappé, Le Nettoyage ethnique de la Palestine, La Fabrique éditions, 2023
Ilan Pappé, Le Nettoyage ethnique de la Palestine, La Fabrique éditions, 2023
« Saviez-vous qu’un professeur d’histoire âgé de 70 ans pouvait constituer une menace pour la sécurité nationale américaine ?
« J’ai atterri lundi à l’aéroport de Detroit et j’ai été soumis à un interrogatoire de deux heures mené par le FBI, qui a également pris mon téléphone. Je dois dire que les deux enquêteurs n’ont pas été trop rudes ou impolis mais leurs questions étaient invraisemblables ! Suis-je un partisan du Hamas ? Est-ce que je considère les actions israéliennes à Gaza comme un génocide ? Quelle est la solution au “conflit” ? (Sérieusement, c’est ce qu’ils m’ont demandé !) Qui sont mes amis arabes et musulmans aux États-Unis ? Depuis combien de temps je les connais, quel type de relation ai-je avec eux. Dans certains cas, je les ai renvoyés à mes livres, et dans d’autres, j’ai répondu laconiquement par oui ou par non… (j’étais assez épuisé après un vol de 8 heures, mais j’imagine que cela fait partie du jeu). Ils ont eu une longue conversation téléphonique avec quelqu’un… les Israéliens ? Et après avoir copié l’intégralité du contenu de mon téléphone, ils m’ont autorisé à entrer aux États-Unis. Je sais que beaucoup d’entre vous ont vécu des expériences pires encore […] Après que la France et l’Allemagne ont refusé l’entrée au recteur de l’université de Glasgow parce qu’il était Palestinien… Dieu seul sait ce qui peut encore se produire. La bonne nouvelle c’est que les actions de ce type menées par les États-Unis ou les pays européens sous la pression du lobby pro-israélien ou d’Israël rendent palpables la grande panique et le profond désarroi devant le fait qu’Israël est sur le point de devenir un État paria, avec tout ce qu’implique un tel statut. » Ilan Pappé, le 15 mai 2024 (sur Facebook, cité par son éditeur français, La Fabrique[1]).
[…] il y a deux mouvements très différents dans le capitalisme. Tantôt il s’agit de tenir un peuple sur son territoire, et de le faire travailler, de l’exploiter, pour accumuler un surplus : c’est ce qu’on appelle d’ordinaire une colonie. Tantôt au contraire, il s’agit de vider un territoire de son peuple, pour faire un bond en avant, quitte à faire venir une main-d’œuvre d’ailleurs. L’histoire du sionisme et d’Israël comme celle de l’Amérique est passée par là : comment faire le vide, comment vider un peuple ? Gilles Deleuze[2]
Tous ceux qui, à ce jour, ont obtenu la victoire, participent à ce cortège triomphal où les maîtres d’aujourd’hui marchent sur les corps de ceux qui aujourd’hui gisent à terre. Walter Benjamin[3]
— Qu’est-ce qu’un réfugié, mon Père ? — Rien, rien, tu ne comprendrais pas. — Que signifie être un réfugié grand-père, je voudrais savoir ? — Être un réfugié signifie que tu ne seras plus un enfant désormais. Mahmoud Darwich[4]
Né le 13 mars 1941[5], Mahmoud Darwich disait encore :
J’avais six ans lorsque je suis parti vers ce que je ne connaissais pas. […] Je ne suis plus un enfant. Depuis peu. Depuis que j’ai appris à distinguer la réalité du rêve, à faire la différence entre ce que je vis et ce que je vivais il y a quelques heures. Le temps se brise-t-il comme le verre ? Je ne suis plus un enfant depuis que je sais que les camps de réfugiés au Liban sont la réalité et que la Palestine habitera désormais le rêve[6].
Ilan Pappé retrace l’histoire de cet exode ponctué de massacres et d’exactions dignes de celles perpétrées par d’autres armées moins d’une décennie plus tôt et que l’on a pris l’habitude de nommer la « Nakba[7] ». Même s’il utilise lui aussi ce terme, il lui préfère, me semble-t-il, celui de « nettoyage ethnique ». D’abord parce que Nakba, que l’on traduit communément par « catastrophe », porte une connotation quelque peu fataliste, imprévisible et quasi surnaturelle – telle une apocalypse.
Aussi surprenant que cela puisse paraître, les premiers utilisateurs du terme « Nakba » (catastrophe) en référence au désastre palestinien sont les militaires israéliens. En juillet 1948, l’armée israélienne s’adresse, par tract, aux habitants arabes de Tirat Haifa qui résistaient à l’occupation. Dans un arabe excellent, elle les exhorte à se rendre en ces termes : « Si vous voulez échapper à la Nakba, éviter un désastre, une inévitable extermination, rendez-vous[8]. »
Et puis, Nakba ne correspond à aucune catégorie juridique qualifiant les crimes qu’elle a recouverts. Or, il existe un crime reconnu comme tel par la communauté internationale (à travers ses instances judiciaires) et qui correspond à ce qui a été perpétré entre 1947 et 1949 par les forces armées israéliennes et leurs supplétifs : c’est le nettoyage ethnique. Cette appellation est apparue au grand jour au moment de la guerre de désintégration de la Yougoslavie.
L’aspect le plus brutal du conflit dans l’ex-Yougoslavie a été le « nettoyage ethnique », dont l’objectif est d’expulser des minorités, par la force, de régions occupées par une majorité différente. Auparavant, des populations différentes vivaient ensemble dans le même village, et il n’y avait aucune division en groupes ethniques et aucun nettoyage ethnique. Les causes de la situation sont donc clairement politiques[9].
On note cependant une différence, et de taille, avec la situation en Palestine au moment de sa partition en deux États et de la reconnaissance de l’État d’Israël par les Nations unies (résolution 181 de L’Assemblée générale en date du 29 novembre 1947).
Il est clair qu’en votant la résolution de la partition, écrit Ilan Pappé, les Nations unies ont totalement ignoré la composition ethnique de la Palestine. Si elles avaient décidé que la superficie du futur État juif correspondrait au territoire où s’étaient installés les Juifs, ces derniers auraient eu droit à 10% du pays, pas davantage. Mais les Nations unies ont admis la revendication nationaliste du mouvement sioniste sur la Palestine ; et elles ont aussi cherché à indemniser les Juifs pour l’Holocauste nazi en Europe. Voilà pourquoi le mouvement sioniste s’est vu « donner » un État qui recouvrait plus de la moitié du territoire[10] (p. 63).
Or, ce territoire était essentiellement habité par des Palestiniens… Il faut ajouter à cela que les Palestiniens eux-mêmes, ou plus exactement les « notables » qui les « représentaient », ainsi que leurs alliés arabes (la Ligue arabe, organisation régionale des États arabes, et le « Haut comité arabe » que Pappé qualifie d’« embryon de gouvernement palestinien ») refusèrent tout net de participer aux négociations préparatoires sur la partition puis, lorsque celle-ci fut approuvée par l’Assemblée générale, à toute concertation sur les modalités de son application sur le terrain. En quoi on peut les comprendre, puisqu’il ne s’agissait de rien de moins que de créer un nouvel État souverain ex nihilo sans tenir compte des populations ni des structures politiques déjà existantes. Un vrai « grand remplacement », en quelque sorte. Cette « politique de la chaise vide » fut mise à profit par les dirigeants du jeune État israélien qui se retrouvèrent ainsi dans un tête-à-tête plutôt confortable avec les représentants de la « communauté internationale », soit les héritiers des puissances blanches coloniales. De plus, Ben Gourion (une sorte de « père fondateur » d’Israël) comprit immédiatement tout le profit qu’il pourrait tirer de la situation. En effet, d’une part, le refus par les « Arabes » du plan de l’Onu lui permettait de considérer que les frontières du pays, que le mouvement sioniste considérait comme trop étriquées (elles correspondaient alors à 56% du territoire), n’étaient pas définitivement fixées, puisqu’une des deux parties les refusait. Et, comble du cynisme, la partie israélienne en profita par la suite pour prétendre que si les choses ne s’étaient pas tout à fait bien passées après la partition, c’était de la faute de ces méchants Arabes qui n’avaient pas voulu discuter raisonnablement… (Cynisme renouvelé par la suite à chaque grande étape de négociations israélo-palestiniennes, particulièrement au moment du refus par Arafat du soi-disant plan de paix présenté en 2000 à Camp David par Ehoud Barak, alors Premier ministre pour la partie israélienne, fortement appuyé par le Président Clinton – Arafat et les Palestiniens, pour avoir refusé d’approuver un accord léonin, furent l’objet de l’opprobre unanimes des politiques et des médias du camp occidental[11].)
Bref, restait à se mettre « au travail » afin de disposer d’un « État juif », non seulement sur le papier, mais en réalité, sur le terrain. Et cela tout en niant la réalité précédente, soit que ce pays était habité par des gens qui s’appelaient les Palestiniens, et la réalité de ce qui fut entrepris pour le « purifier », le « nettoyer » de ces habitants que la propagande sioniste considérait comme des squatteurs, des occupants sans droit ni titre qui s’étaient installés là sans aucune légitimité à le faire après l’exode des Juifs consécutif à la destruction du Temple par les Romains. Vu ainsi, les Juifs, en s’installant en Palestine, ne faisaient rien d’autre que rentrer chez eux. Et si vous revenez chez vous et que vous trouvez votre maison occupée par des étrangers, vous avez le droit de les chasser, n’est-ce pas ? C’est ce qu’ils firent. Cependant, l’affaire n’était pas si simple, et il fallut s’organiser. C’est cette histoire que raconte en détail Ilan Pappé. Une histoire violente, mieux vaut en prévenir les âmes sensibles. On sait qu’elle avait commencé bien avant la date fatidique du 29 novembre 1947.
Dès l’instant où Lord Balfour, secrétaire au Foreign Office britannique, a promis au mouvement sioniste, en 1917, de créer un foyer national pour les Juifs en Palestine, il a ouvert la porte au conflit sans fin qui finirait par engloutir le pays et sa population, écrit Ilan Pappé (p. 43)
Par la suite, les plans proposés par l’administration britannique étaient si scandaleusement favorables aux colonies sionistes[12] qu’ils provoquèrent au moins deux insurrections palestiniennes, en 1929 et 1936.
[…] en 1936, les rebelles se battirent avec une telle détermination qu’ils obligèrent la Grande-Bretagne à cantonner davantage de troupes en Palestine que dans le sous-continent indien. Au bout de trois ans d’attaques d’une implacable brutalité contre la Palestine rurale, l’armée britannique brisa la révolte. La direction palestinienne fut exilée. Les unités paramilitaires qui avaient animé la guérilla contre les forces du Mandat furent dissoutes. Au cours de ces événements, beaucoup de villageois engagés furent arrêtés, blessés ou tués. L’absence de la plupart des dirigeants palestiniens et de groupes de combat palestiniens viables allait beaucoup faciliter les choses en 1947 dans les campagnes de Palestine (IP, p. 43).
On voit bien, ici, qu’il y a eu transmission du flambeau colonial des Britanniques aux Israéliens. Et cela est illustré très concrètement par le rôle qu’a joué dans cette transmission un officier britannique, Orde Charles Wingate.
[Celui-ci] a contribué à faire pleinement comprendre aux dirigeants sionistes que l’idée d’un État juif devait être étroitement liée au militarisme et à une armée, d’abord pour protéger les enclaves et colonies juives qui se multipliaient dans la Palestine intérieure, mais aussi – c’est le point crucial – parce que les actes d’agression armée étaient un moyen de dissuasion efficace contre une possible résistance des Palestiniens locaux. À partir de là, le cheminement vers le projet de transfert forcé de toute la population indigène allait se révéler très court. […]
Wingate a transformé la principale organisation paramilitaire de la communauté juive de Palestine, la Haganah. Elle avait été créée en 1920, et son nom en hébreu signifie littéralement « Défense », ce qui indiquait clairement son objectif principal : protéger les communautés juives. Sous l’influence de Wingate et de l’esprit belliqueux qu’il a inspiré à ses chefs, la Haganah est vite devenue le bras armé de l’Agence juive, l’organisation dirigeante du sionisme en Palestine, qui a fini par élaborer puis mettre en œuvre des plans pour la conquête militaire de l’ensemble de la Palestine et le nettoyage ethnique de sa population. (IP, p. 44-45)
De plus, Wingate a permis aux troupes de la Haganah de commencer à se former sur le terrain en les faisant accepter comme auxiliaires des forces britanniques pendant la révolte arabe de 1936.
Mais il y avait encore d’autres conditions à réunir avant de commencer réellement les opérations. Tout d’abord, et en parallèle de l’armée, créer un début de corps diplomatique qui allait être chargé de maintenir de bonnes relations avec les pays occidentaux dont l’appui en termes financiers, d’armement et d’image était décisif. Cette mission fut réussie au-delà de toute espérance – c’est seulement aujourd’hui que la campagne génocidaire à Gaza et la « Nakba continuée » en Cisjordanie commencent à susciter quelques doutes dans l’opinion publique mondiale…
Autre domaine dans lequel Israël devait se montrer extrêmement efficace : le renseignement. En effet, avant de lâcher ses miliciens sur les villes et villages palestiniens, la direction sioniste devait disposer d’un certain nombre d’informations, à la fois sur le potentiel économique de ces quartiers et villages, mais aussi sur les opposants à leur politique, ceux qui avaient résisté en 1929 et 1936, et recruter à cette fin tout un réseau de collaborateurs.
Enfin, il fallait une direction centralisée et une planification minutieuse des opérations. L’architecte de cette organisation fut David Ben Gourion.
[Il] a dirigé le mouvement sioniste des années 1920 jusque tard dans les années 1960. […] S’il a joué un rôle central dans la décision quant au sort des Palestiniens, c’est à cause du contrôle complet qu’il exerçait sur toutes les questions de sécurité et de défense dans la communauté juive en Palestine. Il avait accédé au pouvoir en tant que dirigeant syndical, mais il œuvra vite fiévreusement à construire les mécanismes de l’État juif en gestation. […] il aspirait à la souveraineté juive sur la plus grande partie possible du territoire palestinien. […] il amena la direction sioniste à accepter à la fois son autorité suprême et une idée fondamentale : la future création d’un État signifierait une domination juive absolue. Comment concrétiser ce type d’État purement juif ? On en discuta aussi sous son égide vers 1937 [date de la proposition britannique de partition]. Deux mots magiques émergèrent alors : Force et Moment propice. L’État juif ne pourrait être obtenu que par la force, mais il fallait attendre une conjoncture historique favorable pour pouvoir traiter « militairement » la réalité démographique du terrain : la présence d’une population indigène majoritaire non juive. (IP, p 52-53)
Le « Moment propice » intervint fin 1947, avec la résolution 181 de l’Assemblée générale des Nations unies. Tout de suite après commencèrent les agressions contre des villages palestiniens, et ce alors même que les soldats britanniques étaient encore présents en Palestine, puisque leur départ définitif était fixé au 15 mai 1948 (on a vu plus haut que la famille de Mahmoud Darwich, par exemple, fut chassée de chez elle au tout début de l’année 1948 – il n’avait pas encore sept ans, alors qu’il était né en mars 1942). D’ailleurs, que ce soient les Britanniques ou les observateurs de l’Onu chargés de surveiller l’application de la résolution 181, nul ne trouva rien à redire sur l’énorme opération de nettoyage ethnique qui s’enclencha alors. Cela dit, il faut relever que des plans organisant ce nettoyage avaient déjà été mis au point depuis quelques années. Celui qui fut finalement appliqué se nommait le plan « Daleth » (le nom de la lettre D en hébreu). Il succédait aux plans A (élaboré en 1937), B (1946) et C (fusion de A et B, fin 1946). Ce dernier
visait à préparer les forces militaires de la communauté juive de Palestine aux campagnes offensives qu’elles allaient mener contre la Palestine rurale et urbaine sitôt les Anglais partis. L’objectif de ces actions serait de « dissuader » la population palestinienne d’attaquer les implantations juives et de riposter à toute agression contre des routes, des véhicules et des lieux d’habitation juifs. Le plan C énumérait clairement les composantes de ce type d’actions punitives :
Tuer les dirigeants politiques palestiniens. Tuer les agitateurs palestiniens et leurs soutiens financiers. Tuer les Palestiniens qui ont agi contre des Juifs. Tuer les officiers et fonctionnaires palestiniens haut placés [dans l’administration du Mandat]. S’en prendre aux moyens de transport palestiniens. S’en prendre aux moyens de subsistance palestiniens : puits, moulins, etc. Attaquer les villages palestiniens proches qui pourraient aider de futures agressions. Attaquer les lieux de réunion palestiniens, clubs, cafés, etc.
[…] quelques mois plus tard, un autre plan fut rédigé […]. C’est lui qui a scellé le destin des Palestiniens sur les territoires que les dirigeants sionistes avaient en vue pour leur futur État juif. Sans distinguer les cas où ces Palestiniens pourraient décider de collaborer avec l’État juif ou le combattre, le plan Daleth prévoyait leur expulsion totale et systématique de leur patrie. (IP, p. 58, c’est moi qui souligne.)
De fait, l’objectif de ce plan D était la destruction de la Palestine rurale et urbaine. Il fut mis en œuvre à partir du 10 mars 1948. Ce jour-là était réunis onze hommes, qui formaient ce qu’Ilan Pappé appelle le Conseil consultatif, sous la direction de Ben Gourion. C’est ce collectif, dont Pappé a réussi à reconstituer la liste des membres, malgré le fait qu’il y a eu très peu de comptes rendus de ses réunions, qui a décidé et supervisé le nettoyage ethnique. Ce 10 mars, donc, les onze mirent la dernière main au plan Daleth et « le soir même, des ordres [furent] envoyés aux unités sur le terrain […] ».
Ces ordres s’accompagnaient d’une description détaillée des méthodes à employer pour évacuer les habitants de force : intimidation massive, siège et pilonnage des villages et des quartiers, incendie des maisons, des biens, des marchandises, expulsion, démolition et pose de mines dans les décombres pour empêcher les expulsés de revenir. Chaque unité [reçut] sa propre liste de villes et de villages et de quartiers cibles, dans le cadre du plan global. […]
Une fois la décision prise, il a fallu six mois pour l’appliquer. Quand tout a été fini, près de 800 000 personnes – plus de la moitié de la population indigène de Palestine – avaient été déracinées, 531 villages détruits, 11 quartiers vidés de leurs habitants. (IP, p. 18-19)
Et comme dans les autres cas de nettoyage ethnique (en ex-Yougoslavie par exemple) ces « méthodes » criminelles n’ont pas été les seules employées : il était probablement difficile de recommander par écrit les massacres, les viols, ou même les cas d’empoisonnement de l’alimentation en eau d’une ville entière par le virus de la typhoïde, comme ce fut le cas à Acre, et c’est pourquoi il n’en existe pas ou peu de traces écrites. Par contre l’histoire orale, naturellement plus du côté palestinien qu’israélien, mais aussi du côté israélien, regorge de ces histoires de massacres et autres. Ces dernières années, l’historiographie a tout de même fait des progrès, envers et contre les efforts de l’État d’Israël pour imposer une chape de silence sur ces crimes. Ainsi, par exemple, on a pu voir récemment sur les écrans un documentaire poignant sur le nettoyage ethnique du bourg de Al-Tantoura – et sur la façon dont les autorités académiques et politiques israéliennes ont lutté contre un historien qui en avait fait son sujet de thèse[13]. Et ce n’est qu’une histoire parmi beaucoup d’autres.
Il faut absolument lire ce livre si l’on veut comprendre ce qui a été infligé aux Palestiniens. Ilan Pappé ne l’a pas écrit dans un esprit de vengeance, loin de là. Mais comme il l’explique parfaitement, il n’y aura jamais de paix, encore moins de réconciliation possible tant que ces crimes n’auront pas été reconnus – sans même parler de « réparations[14] », qui devraient commencer par appliquer le droit au retour des réfugiés. Personne ne prétendra que c’est facile à réaliser, surtout pas après ce que nous avons vu, et voyons encore, ces derniers mois à Gaza et en Cisjordanie. Pourtant, il n’existe pas d’autre solution, à moins de penser, comme ont pu le penser les nazis dans les années 1940, qu’il est possible d’effacer complètement des peuples de la surface de la Terre. Je sais bien qu’à avancer des platitudes pareilles, on peut se voir aujourd’hui, en France, accuser d’« apologie du terrorisme[15] ». Mais il faudra bien que cela finisse un jour. En attendant il faut remercier les éditions de La Fabrique d’avoir réédité ce titre, sauvant ainsi « l’honneur de l’édition française », comme j’ai pu le lire quelque part (je crains qu’il n’y ait encore du boulot…).
franz himmelbauer, pour Antiopées, ce lundi matin 20 mai 2024.