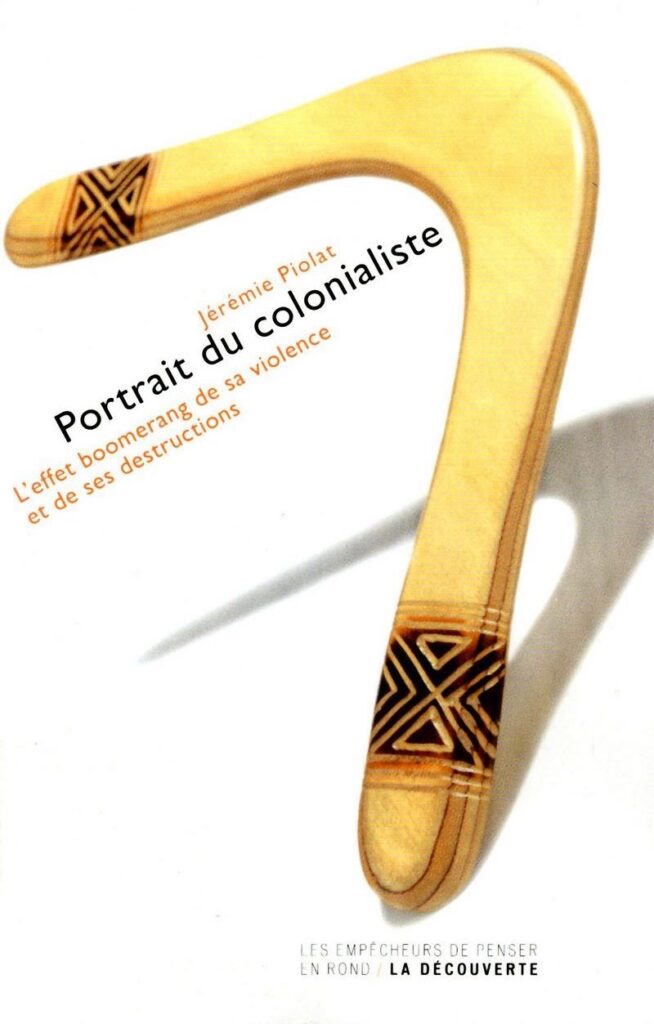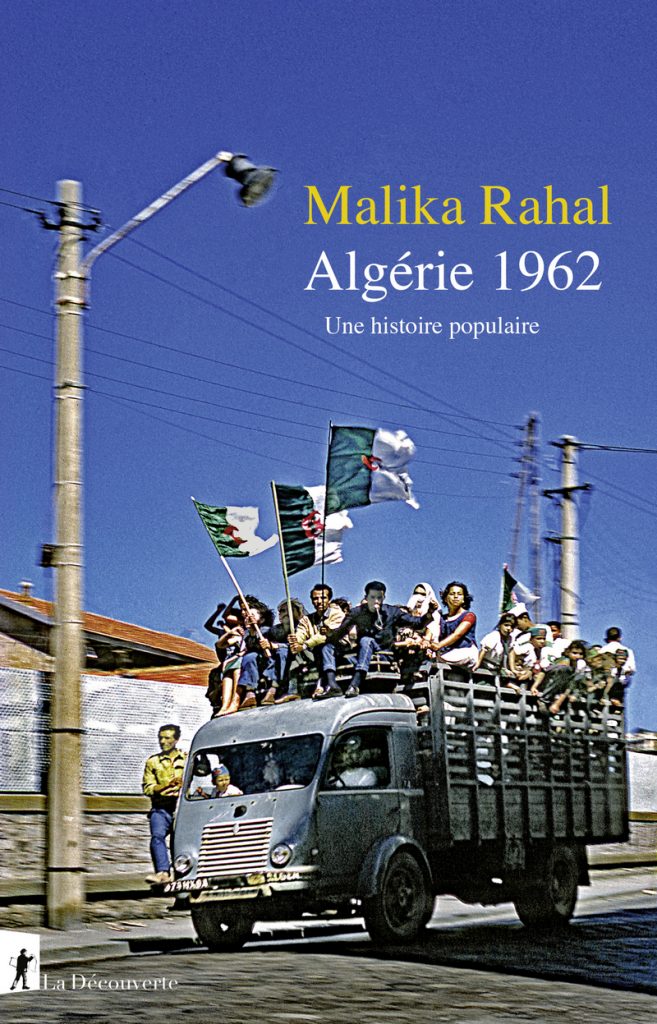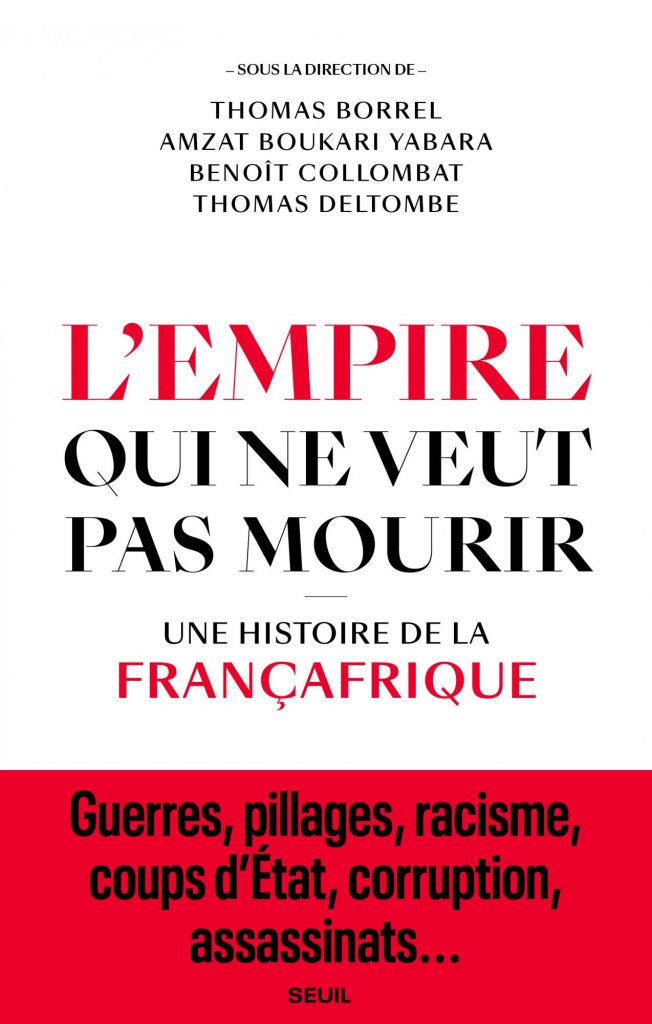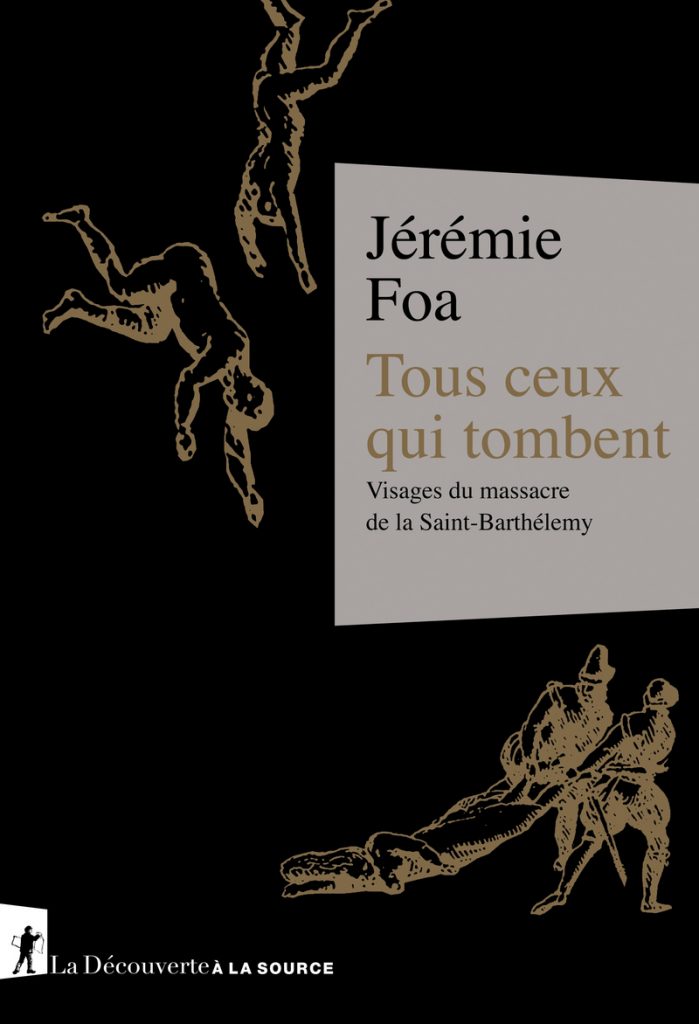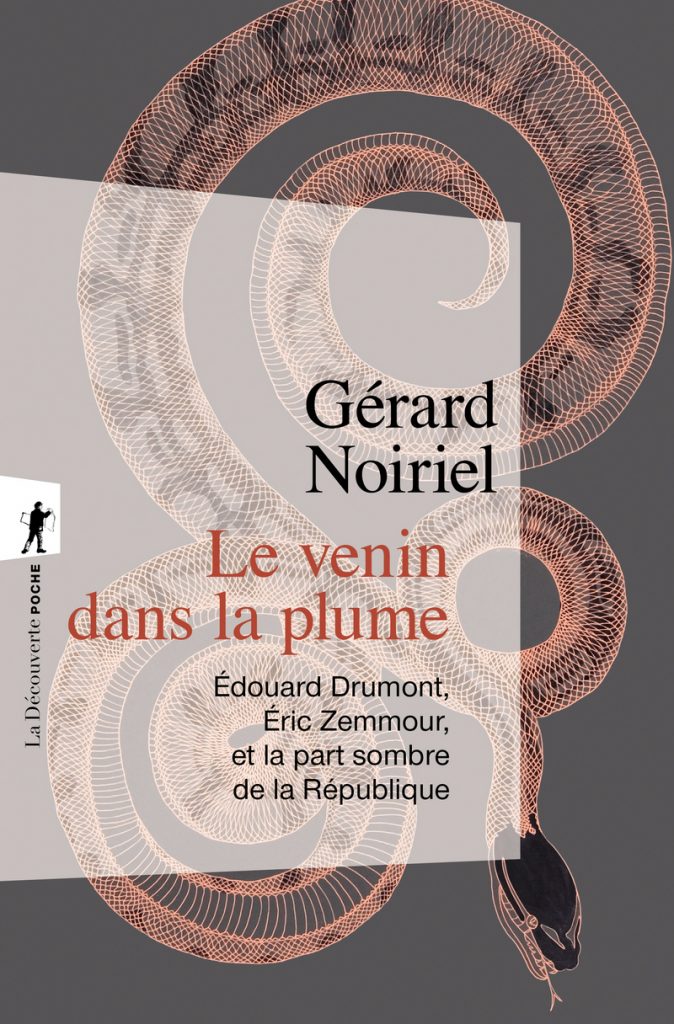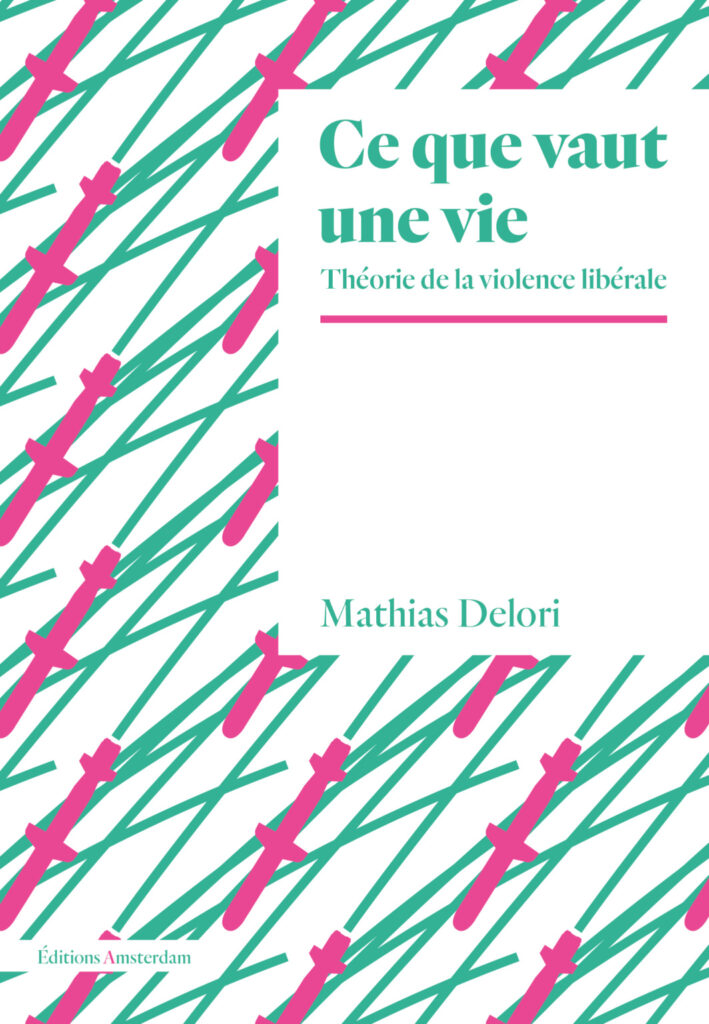 Mathias Delori, Ce que vaut une vie. Théorie de la violence libérale, Éditions Amsterdam, 2021
Mathias Delori, Ce que vaut une vie. Théorie de la violence libérale, Éditions Amsterdam, 2021
« Du côté de la France et des États-Unis, il y eut en tout quatre cent mille morts, si l’on compte les tirailleurs, les supplétifs indochinois, troupes coloniales qui formaient l’essentiel de notre armée. Du côté vietnamien, la guerre fit au moins trois millions six cent mille morts. Dix fois plus. Cela fait autant que de Français et d’Allemands pendant la Première Guerre mondiale[1]. »
« […] si l’on ne veut comparer que les victimes de violences organisées et de caractère international, le terrorisme a causé autant de morts occidentaux en vingt ans que la Première ou la Seconde Guerre mondiale… en une journée[2]. »
Après bientôt deux mois de guerre en Ukraine, on a peut-être tendance à oublier les guerres quasi permanentes que mène l’Occident dans les pays du Sud. Je ne prétends en aucune façon minorer la violence déchaînée par le régime russe contre ses voisins. Cependant, comme nous l’a rappelé un texte signé de la Cantine syrienne de Montreuil[3], il ne faudrait pas « faire des pays occidentaux l’axe du bien ». « Rappelons, s’il le faut, poursuivent-ielles, que l’Occident a lui-même basé sa puissance (et continue de le faire) sur le colonialisme, l’impérialisme, l’oppression et la spoliation des richesses de centaines de peuples dans le monde entier. » C’est bien de cela que parle Mathias Delori dans ce livre.
Plus précisément, il propose une « théorie de la violence libérale ». Qu’est-ce à dire ? Il s’agit de « la guerre contre le “terrorisme” engagée en 2001 par les États-Unis, avec le soutien de leurs alliés ». « On a pris une mitrailleuse pour tirer sur un moustique », selon un ancien responsable des services extérieurs français cité dès le début de l’introduction. Le même ajoutait dans la foulée que « si l’on avait évidemment raté le moustique, on avait fait, au passage, beaucoup de dégâts ». En effet, confirme Delori, « le “terrorisme” a causé la mort d’environ 4 000 civils en Europe et en Amérique du Nord depuis 2001, attentats du 11 septembre compris ». Or, « d’après des estimations prudentes, la barre des 4 000 victimes civiles (afghanes) fut atteinte après seulement trois mois de guerre en Afghanistan ». On sait que cette guerre a duré vingt ans, durant lesquels d’autres conflits ont été déclenchés contre de soi-disant « terroristes » et/ou États « complices de », etc. : Afghanistan, Irak, Mali, Syrie, sans parler des frappes aériennes (de drones) au Pakistan, au Yemen, en Somalie… Pour rester un instant dans les statistiques, on peut lire ceci dans la conclusion de Ce que vaut une vie : « Le réseau diplomatique Geneva Declaration a conduit une étude sur les “violences armées” entre 2000 et 2007. Le terrorisme n’était la cause que de 2% des 400 000 victimes civiles causées par ce type de violence. Ce chiffre s’explique facilement : les États, libéraux ou non, tuent beaucoup plus de personnes innocentes que les organisations terroristes. » Et pour terminer cette séquence d’arithmétique macabre, on ajoutera, toujours d’après Delori (dans sa conclusion, cette fois), que « les féminicides ont fait environ dix fois plus de morts » que le terrorisme en vingt ans (2001-2021) dans l’espace euro-atlantique[4].
On pourrait se demander pourquoi la guerre n’a pas été déclarée aux assassins de femmes, et comparer les montants des investissements consentis par les États dits libéraux dans la lutte contre les féminicides avec ceux de leurs interventions militaires à l’étranger… Mais le propos de Mathias Delori n’est pas exactement celui-ci. Il est plutôt d’explorer les mécanismes, les rouages de cette « violence libérale », les mythes qui la justifient et l’entretiennent, et les discours que tiennent ceux-là même qui l’administrent. Et cela concerne pas mal de monde. Peut-être, comme moi, avez-vous sursauté en entendant ces dernières semaines à la radio ce genre de phrase : « Poutine envahit l’Ukraine », « Poutine a fait ci, Poutine a fait ça ». Bien sûr, je ne veux pas minimiser sa responsabilité, mais il me semble tout de même que c’est parler trop vite et trop simple : même si cela ne m’enchante guère, je dois bien admettre que toute une armée lui obéit et que « son » opinion publique a minima, le laisse faire – sachant la censure, la répression impitoyable et tout le reste, mais.
Par « chez nous » (Europe-États-Unis) c’est pareil : il y a bien un appareil militaire et policier qui applique les décisions des chefs d’États à travers le monde entier. Et là, j’en vois qui se récrient : mais ce n’est pas pareil, nous somme civilisés, nous ! Et il est vrai que si « notre » discours est probablement plus policé (à nos propres oreilles, du moins – il faudrait demander aux « autres » ce qu’ielles en pensent, enfin, avant qu’ielles soient victimes « collatérales » d’un bombardement aérien par drone ou avion de chasse[5] ou qu’ielles soient noyée·e·s en Méditerranée[6]…), il n’en recouvre pas moins des choses pas jolies jolies…
Mathias Delori a enquêté sur les agissements (plus exactement sur la manière dont ils les justifient et dont ils sont légitimés par le discours dominant) de deux groupes de personnes bien différentes – en tout cas dans nos imaginaires : ceux qui conduisent des « interrogatoires renforcés » (à Guantánamo, Abu Ghraib et autres lieux de détention secrets de la CIA) sur des prisonniers suspects de terrorisme et ceux qui bombardent ces mêmes suspects (avant qu’ils soient arrêtés) depuis leur avion de chasse. Il a pu s’entretenir avec un certain nombre de pilotes français de bombardiers. Par contre, concernant les « interrogateurs » (on pourrait dire les tortionnaires, mais ils ont tendance à réfuter l’appellation, allez savoir pourquoi), il a dû se contenter de la littérature normative produite par l’administration américaine (ce que l’on peut ou ne peut pas faire en interrogeant un prisonnier) et quelques autres sources « indirectes ». Les uns sont très loin de leurs cibles – à plusieurs dizaines de kilomètres s’ils larguent leurs bombes depuis un avion, voire à des milliers s’ils pilotent un drone armé depuis le désert du Nevada[7]. Les autres sont tout près du prisonnier qu’ils ou elles[8] interrogent. Mais les un·e·s et les autres disposent du même répertoire moral et politique afin de justifier ce qu’ils font, à leurs propres yeux comme à ceux des autres. Il s’agit des déclinaisons de ce que Mathias Delori identifie comme les trois grands principes de la violence libérale.
- La violence libérale est non intentionnelle et doit le rester. Plus exactement : on n’exerce pas la violence “pour le plaisir”, par sadisme en quelque sorte. En ce qui concerne les « interrogatoires renforcés », il s’agit d’obtenir des informations, des renseignements sur l’ennemi. On ne torture pas un prisonnier pour lui faire mal, mais on lui impose un certain niveau de stress, de pression, afin de le faire craquer psychologiquement et de le faire parler. Il y a eu, semble-t-il, pas mal de débats, principalement entre militaires et agents des services secrets états-uniens, les premiers protestant contre le principe des interrogatoires de plus en plus « renforcés », les seconds, au contraire, s’y livrant d’autant plus qu’ils étaient couverts par le secret de centres de détention sans aucune existence légale et discrètement dispersés à travers le monde. Chez les aviateurs, la non-intentionnalité s’exprime plutôt dans le cadre d’une certaine bureaucratisation, à travers toute une chaîne hiérarchique et une série de procédures d’engagement que Mathias Delori détaille dans son livre. Elle est également facilitée par une euphémisation du langage (comme, dans le cas précédent, « interrogatoire renforcé » pour « torture »). « [Les aviateurs] ne “tuent” pas d’autres êtres humains. Ils “bombent” (du néologisme “bomber”) des objectifs, “neutralisent” des ennemis, “traitent” des cibles et “délivrent des armements”. » Chez les uns comme chez les autres, il s’agit de concilier « humanité » et « efficacité ». Ce qui, finalement, n’est pas très éloigné du langage d’un ministre de l’Intérieur (« d’ici », comme La Provence est d’ici, voir note 5) justifiant les yeux crevés et les mains arrachées par les « forces de l’ordre »[9].
- La violence libérale doit être maîtrisée. Ou proportionnée. En ce qui concerne les interrogatoires renforcés, les manuels précisent par exemple qu’ils doivent s’arrêter avant de (risquer de) provoquer la mort du prisonnier. Hum… Voilà qui peut donner prétexte à interprétation. Et qui a donné prétexte à interprétation : ainsi par exemple un interrogateur en Afghanistan a-t-il soutenu que les conventions de Genève [qui protègent en principe les prisonniers de guerre] n’interdisent pas d’infliger des souffrances aux prisonniers. Mieux (enfin, mieux pour lui, devrais-je dire, et pire aux oreilles de toute personne sensée) : il prétendait que le thème central de ces conventions serait que l’on « ne peut jamais traiter un prisonnier plus mal qu’on ne traite ses propres hommes ». C’est pourquoi, selon lui, on pouvait trouver une marge de manœuvre dans ces textes, qu’il définissait ainsi : « Ce serait de la triche si l’on interrogeait le prisonnier à plusieurs. Mais pourquoi ne pas adopter la règle selon laquelle les interrogatoires peuvent se poursuivre tant que l’interrogateur peut les supporter? » (Je souligne. No comment.)
Mais du côté des aviateurs, ce n’est pas beaucoup mieux. Ici, la maîtrise de la violence, ou sa proportionnalité, se mesure à la « valeur » de la cible. Cette « valeur » détermine à son tour une « valeur seuil des victimes non combattantes » – soit des victimes « collatérales ». Ainsi, une cible de grande valeur augmente cette « valeur seuil » : lors de la guerre en Irak, elle était de trente pour ce type de cible : « En d’autres termes, écrit Delori, les aviateurs états-uniens qui avaient identifié une telle cible pouvaient ouvrir le feu si leur estimation du nombre de dégâts collatéraux était comprise entre zéro et vingt-neuf. » Il faut ajouter ici que les avions postmodernes embarquent des logiciels qui permettent ces évaluations… Le pilote entre différentes données, environnement (urbain ou pas), nombre d’habitants dans la zone, type et puissance de la bombe ou du missile, distance et angle de tir, etc. et la machine l’informe du nombre probable de victimes de son tir. Ce genre de dispositif fait partie de ce que Delori appelle les « technologies morales de la guerre aérienne », qui permettent à leurs utilisateurs (les pilotes) de tenir à distance, en quelque sorte leurs propres responsabilités.
- La violence libérale doit être légale, soit encadrée par des textes législatifs et/ou réglementaires. Il faut lire à ce propos comment l’administration américaine a rédigé les manuels de torture… en prenant soin tout d’abord de l’« expatrier », en premier lieu à Guantánamo, ce qui a permis d’autoriser des procédures qui auraient été interdites sur le territoire des États-Unis. Et lorsque Guantánamo ne suffisait pas, il y avait encore les prisons secrètes de la CIA ailleurs dans le monde. Je n’ai ni le goût ni l’envie de détailler ici les prescriptions officielles en matière d’interrogatoires renforcés. Vous les découvrirez en lisant Delori, c’est l’horreur[10].
Quant aux pilotes, leur respect de la légalité n’a d’équivalent que leur inconscience des conséquences potentielles de leurs actes (ou peut-être, plus exactement, leur « indifférence » à ces conséquences, l’un d’eux utilisant précisément ce terme) – actes, il est vrai, quelque peu « désincarnés » : appuyer sur un bouton qui déclenche un tir vers une cible très distante… de plus, ils doivent toujours demander l’autorisation de le faire et ne disposent finalement que de peu de capacité d’initiative personnelle. Par contre, ils ont déclaré à Thomas Delori que s’ils recevaient l’ordre de lâcher une bombe thermonucléaire au-dessus d’une ville, ils le feraient sans état d’âme[11]. Ils servent un pays (la France) dont le Président, qui a le pouvoir de donner de tels ordres, est démocratiquement élu, donc, ils ne voient pas de problème à les exécuter.
Il y aurait encore pas mal de choses à dire sur ce livre très instructif. Je voudrais seulement dire encore un mot de sa conclusion qui m’a beaucoup touché. Il s’agit de la toute dernière section, intitulée « Resignifications poétiques ». « Des détenus de Guantánamo, écrit Delori, ont commencé à écrire des poèmes dès leur arrivée au camp, en 2001-2002. Quand le ministère de la Défense a eu vent de cette histoire, il a fait interdire ces textes au motif qu’ils représentaient “un risque pour la sécurité nationale en raison de leur contenu et format”. La direction du camp a ensuite procédé à la destruction des poèmes. Par exemple, les 25 000 vers rédigés par Shaik Abduraheen Muslim Dost furent intégralement confisqués et détruits par les gardiens. Pour s’assurer que de nouveaux poèmes ne verraient pas le jour, la direction du camp a ensuite ordonné la fouille de toutes les cellules. Tous les objets pouvant servir de support à l’écriture de poèmes (stylos, feuilles de papier) furent confisqués ou détruits. Les détenus ont alors commencé à utiliser de nouveaux supports, comme des gobelets en plastique, pour écrire leurs poèmes. Ils sont parvenus à en faire sortir une vingtaine. La direction du camp a riposté en distribuant des gobelets n’absorbant plus l’encre des stylos. »
Pourquoi cet acharnement contre les poèmes des détenus ? Voici l’explication qu’en donne Delori, non sans avoir consacré quelques paragraphes à cette notion de « re-signification »[12]. Ce sont les dernières lignes de son livre et ce seront aussi les dernières de cette recension, bien insuffisante, je le crains, pour rendre compte de sa richesse de contenu. Une seule solution : lisez-le !
« La poésie n’est pas le seul médium de resignification, mais elle possède un pouvoir particulier. Ce pouvoir découle du fait qu’elle est le langage où l’énonciation de la subjectivité du locuteur est la plus importante. Si l’orientalisme et le discours techno-stratégique constituent les victimes de la guerre contre le terrorisme en purs objets du discours, la poésie de résistance à la guerre contre le terrorisme les resubjective de manière radicale. Cette resubjectivation fait des victimes de cette guerre l’équivalent des victimes du terrorisme : des vies dignes de chagrin. »
franz himmelbauer (17 avril 2022)
[1] « Note » finale dans Une Sortie honorable, d’Éric Vuillard (Actes Sud, 2022), qui parle de la fin des guerres française et américaine au Vietnam (c’est moi qui souligne). Le titre de ce livre est tiré d’une citation du président du Conseil (on est encore sous la Quatrième République) René Mayer. Recevant à Matignon, avant son départ, le général Navarre, qui vient d’être nommé (en mai 1953) commandant en chef des forces françaises en Indochine, il lui dit : « La situation […] est tout simplement désastreuse. La guerre est pour ainsi dire perdue. Tout au plus peut-on espérer lui trouver une sortie honorable. » Suite à quoi Navarre machina le désastre peu honorable de Diên Biên Phu.
[2] Mathias Delori, Ce que vaut une vie, p. 267 (Conclusion).
[3] « Guerre en Ukraine : dix enseignements syriens », cosigné par l’équipe des Peuples Veulent.
[4] Écoutant les infos sur France Culture ces jours-ci, j’entends le présentateur du journal annoncer un reportage sur le procès des attentats du 13 novembre 2015, qui a lieu en ce moment à Paris. Ce massacre, dit-il, qui a coûté la vie à 130 personnes, est le plus meurtrier en France depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Pourtant nous savons que ce nombre est du même ordre de grandeur que celui des femmes assassinées chaque année en France – depuis quand, je n’ai pas fait suffisamment de recherches pour le dire, mais disons, au moins depuis le début des années 2000… Il ne s’agit pas ici de « banaliser » la violence, les conséquences et les victimes des attentats comme ceux du 13 novembre. Je trouve tout aussi indécent d’invisibiliser en permanence les tueries bien plus massives perpétrées par nos États occidentaux. C’est pourtant ce que fait ce présentateur de France Culture, comme ce que font en permanence la plupart de ses confrères et consœurs des médias mainstream.
[5] Lire par exemple cet article d’Afrique XXI : « Bounti. Bavure française, complicité américaine » consacré à la « frappe-signature » qui a tué vingt-deux personnes participant… à une noce dans ce village malien, le 3 janvier 2021. Pour un cas bien documenté comme celui-là, combien d’autres passent-ils totalement inaperçus des médias et des opinions euro-atlantiques ?
[6] Alors que je termine cette recension, je lis dans le journal d’ici (La Provence, qui n’a pas grand-chose « d’ici », à part son titre et les pages qu’elle consacre régulièrement à l’OM… bon, d’accord, je suis un peu de mauvaise foi, là, je devrais dire que ce sont ses pages d’actualités générales qui n’ont pas grand-chose d’ici, vu que l’on y trouve, répétées comme par un perroquet, les mêmes que partout ailleurs) qu’un nouveau naufrage a eu lieu hier au large de la Libye. On a retrouvé les corps de neuf personnes, tandis que vingt et une autres restent disparues.
[7] À propos des drones en particulier, on lira Théorie du drone, de Grégoire Chamayou, que je tiens pour le meilleur ouvrage sur le sujet (éd. La fabrique, 2013).
[8] Je précise « elles » car l’armée des États-Unis a utilisé les « compétences » spécifiques des femmes dans les interrogatoires des prisonniers, en particulier à la prison d’Abou Ghraib en Irak, afin d’humilier et de choquer des Arabes forcément plus « fragiles » face à des provocations sexuelles féminines, selon les représentations orientalistes des Américains. On peut lire là-dessus Coco Fusco, Petit manuel de torture à l’usage des femmes-soldats, Les Prairies ordinaires (aujourd’hui Amsterdam), 2008.
[9] Voire les niant complètement, à la suite de son Président, qui refusait, lors d’un « débat » par lui-même qualifié de « grand », à la suite du mouvement des Gilets jaunes, d’admettre qu’il puisse exister des « violences policières » dans notre État de droit, hein (coup de menton). L’argumentation du sinistre de l’Intérieur, à l’époque, était calquée sur celle de la guerre antiterroriste. Afin de justifier cette dernière, les États-Unis et leurs acolytes européens prétendent exercer un droit de légitime défense contre un ennemi qui serait venu les agresser chez eux sans crier gare. Mathias Delori montre bien dans son livre qu’il n’en est rien, et qu’il existe un lien de cause à effet entre « interventions extérieures » (genre Irak, Syrie, Sahel, Afghanistan, etc.) et attentats « terroristes » sur le sol des pays interventionnistes (« cet animal est très méchant, quand on l’attaque il se défend », disait Blanqui devant ses juges à propos du peuple, reprenant une vieille maxime issue d’une chanson populaire, semble-t-il). Or il me souvient d’avoir ouï le dit sinistre prétendre (au micro de je ne sais plus quelle radio, mais je puis certifier que je n’invente rien), dans un des accès de bouffonnerie dont il a le secret (que l’on se souvienne par exemple de la prétendue invasion par les méchants manifestants de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, le 1er mai 2019), prétendre donc que s’il arrivait parfois que les gentils CRS et autres gardes-mobiles fassent quelque peu (si peu !) usage de la force, c’est parce qu’ils avaient été agressés par les manifestants, pire, parce que les manifestants, justement, n’en étaient plus : ils étaient devenus des « émeutiers », et cela n’est pas compatible avec l’État de droit, comme chacun·e sait – et quand la foule l’oublie, tonfas, lacrymos et flash-balls se chargent de lui rappeler, au prix parfois de « regrettables erreurs », mais elle l’avait bien cherché, hein !
[10] Je précise cependant qu’il n’y a nul voyeurisme dans le texte de Delori. Pas de scènes gore, encore moins de jets d’hémoglobine. C’est justement son propos, de montrer comment les démocraties occidentales invisibilisent leur propre violence. Ainsi, lorsqu’il décrit des procédés d’interrogatoire renforcés, il le fait seulement sur la base des « mémos-torture » de l’armée états-unienne, lesquels ont commencé à « fuiter » dès 2005 (sachant que le premier de cette série « antiterroriste » a été diffusé dans l’armée et les services secrets en 2002, soit au tout début de la guerre lancée par George Bush après le 11 septembre).
[11] Ce qui a de quoi nous inquiéter alors que, ces dernières semaines, Poutine (oui, cette fois, c’est bien lui) a donné l’ordre de mettre en état d’alerte les capacités nucléaires de l’armée russe. Il existe très probablement là-bas aussi des aviateurs dont le rapport à leur métier n’est certainement pas très différent de celui des aviateurs français rencontrés par Delori, qui rapporte que ceux « qui opèrent dans les forces stratégiques expliquent qu’ils n’auraient aucune hésitation à larguer une bombe sur une ville ennemie (sic) si le président de la République leur en donnait l’ordre. Ils justifient cette attitude en expliquant que celui-ci est démocratiquement élu [Poutine aussi] et que “pour que la dissuasion nucléaire fonctionne, il faut que le personnel fasse preuve d’obédience (sic) et d’abnégation”. L’un d’eux dit avoir “la naïveté de croire que nos politiques sont capables de faire la part des choses et de nous amener à l’utiliser qu’en dernier recours ». Hum…
[12] Il me semble important d’en citer ici un extrait, d’autant plus qu’il y est question, entre autres, de Judith Butler dont les éditions Amsterdam viennent de publier La Vie Psychique du pouvoir, peu après avoir publié Judith Butler. Race, genre et mélancolie, une étude de Hourya Bentouhami, deux ouvrages sur lesquels j’espère revenir prochainement :
« Judith Butler s’est interrogée sur les raisons de l’attitude de l’administration Bush à l’égard de ces poèmes : pourquoi dépenser autant d’énergie contre des textes en apparence si inoffensifs ? Selon elle, la réponse à cette question ne réside pas dans le contenu des poèmes. Les images de la prison d’Abu Ghraib témoignaient aussi de la torture. Or le magazine Salon n’a eu aucun mal à en collecter plus de 1 300. Par ailleurs, les mémos-torture ont fuité à partir de 2005 sans que cela place l’administration Bush dans un état aussi prononcé d’excitation. Pourquoi cet acharnement contre les poèmes et contre les poèmes seulement. ?
« La théorie des actes de langage de John Austin apporte un élément de réponse. Dans Comment faire des choses avec des mots ?, cet auteur souligne que les textes n’ont pas seulement ou pas toujours une fonction descriptive. À l’instar des jugements prononcés par les juges, des déclarations de mariage et plus généralement des promesses, ils instituent des réalités qui n’existent pas avant leur illocution. Les spécialistes des sciences sociales qui ont repris à leur compte cette théorie soulignent que tous les textes n’ont pas le même pouvoir et que celui-ci dépend grandement de la position des locuteurs. Pendant les années 1950, par exemple, de nombreux militants ont évoqué la “réconciliation” de la France et de l’Allemagne. Ces discours n’ont pas eu le même poids que ceux prononcés par de Gaulle et Adenauer au début des années 1960. Dès lors, on comprend que les poèmes aient irrité l’administration du camp de Guantánamo, mais on revient au point de départ. La position des poètes était faible. Les poèmes ne constituaient pas “un risque pour la sécurité nationale” assez important pour justifier une telle énergie destructrice.
« La notion de “resignification” amende ce schéma en y ajoutant une touche poststructuraliste. S’inspirant de Derrida, Butler souligne que les matrices de savoir-pouvoir ne nous sont pas seulement données en héritage. Elles sont constamment reproduites ou traduites au travers de pratiques signifiantes. Par exemple, la binarité masculin/féminin n’est pas seulement inscrite dans la biologie. Elle est en permanence jouée, répétée et récitée à travers les pratiques vestimentaires, les manières de se coiffer, les habitus genrés, etc. Si tout le monde participe à la signification du monde, tout le monde peut aussi le « re-signifier » et, par conséquent, subvertir les significations établies. Cette notion permet donc de penser la critique et la subversion par le bas de l’ordre établi, qu’il s’agisse des normes de genre, des rapports de forces géopolitiques ou de la frontière entre violence légitime et illégitime. »