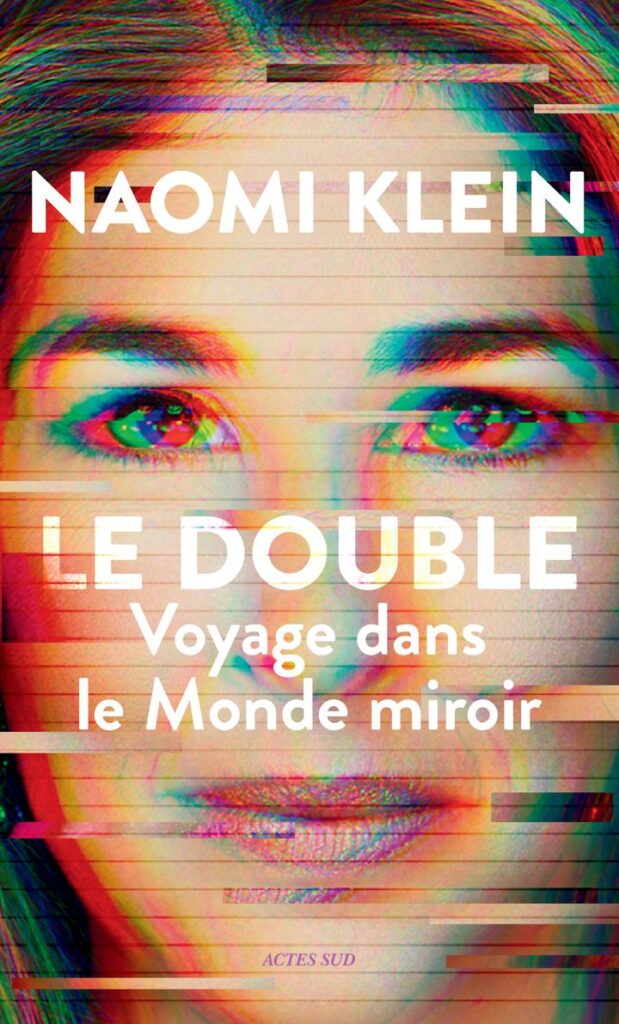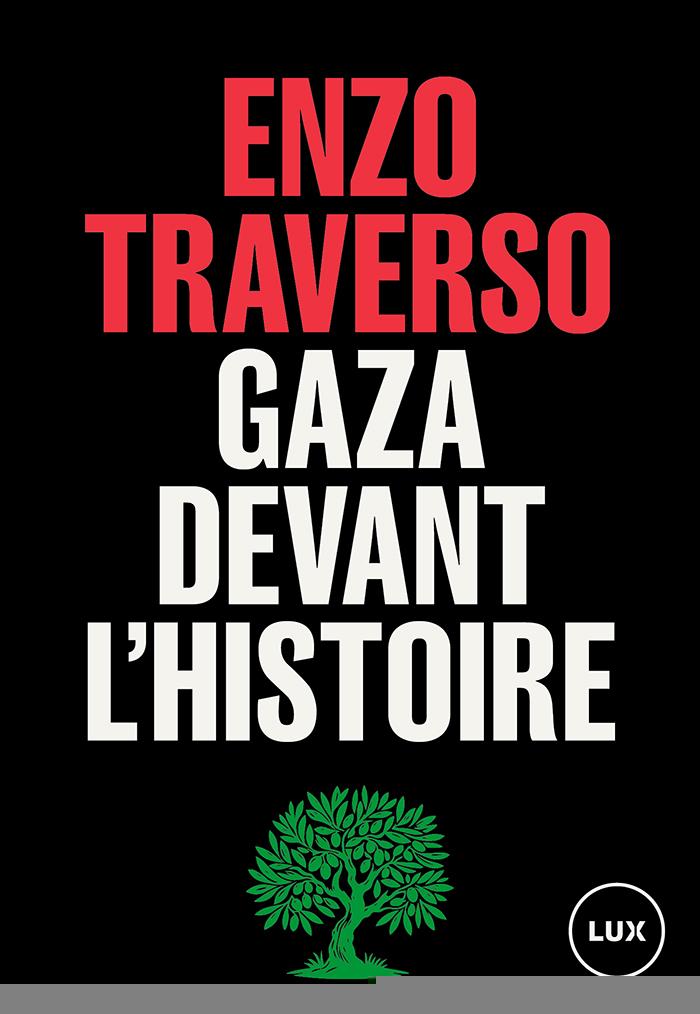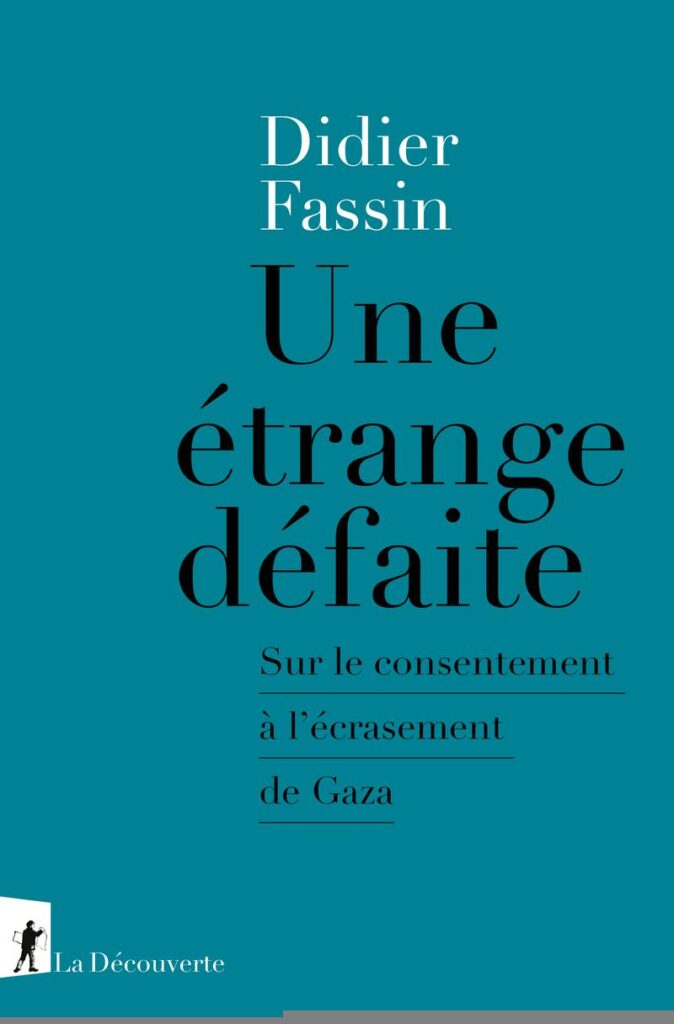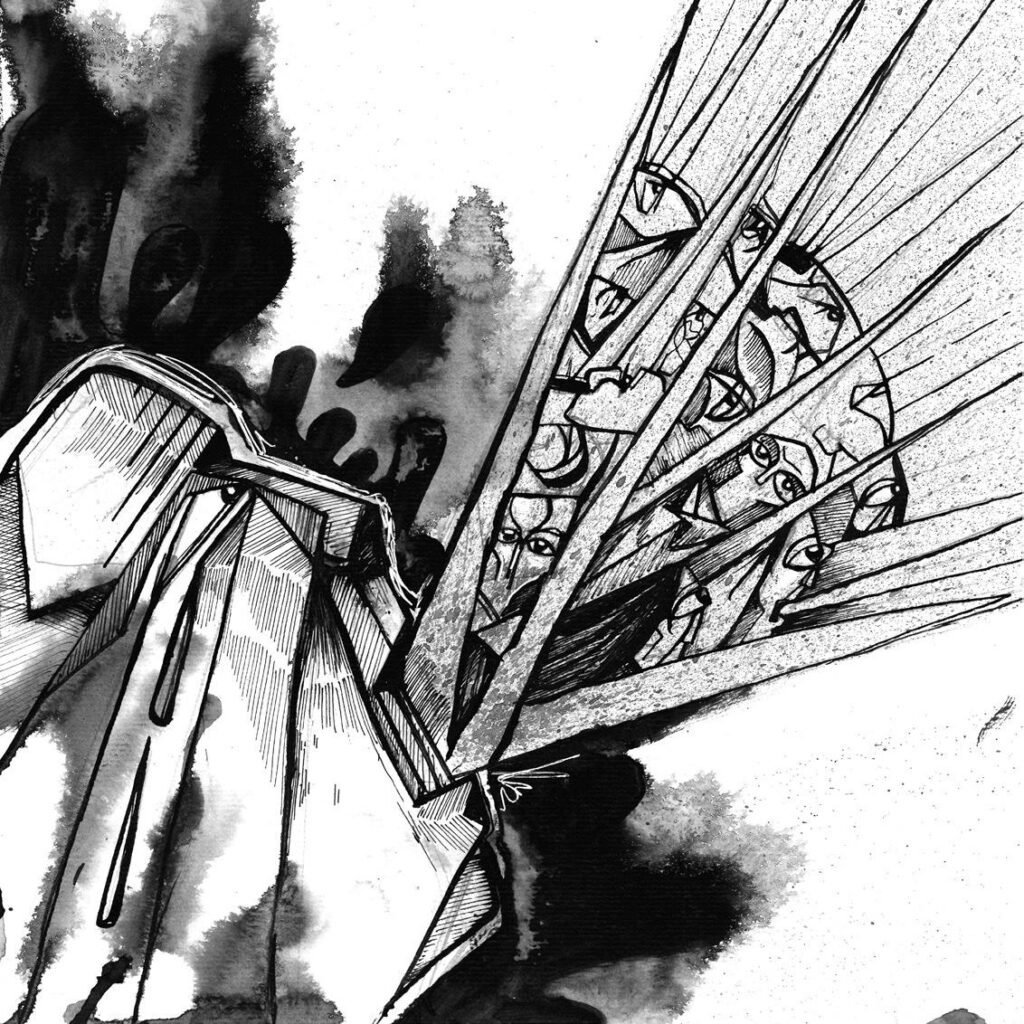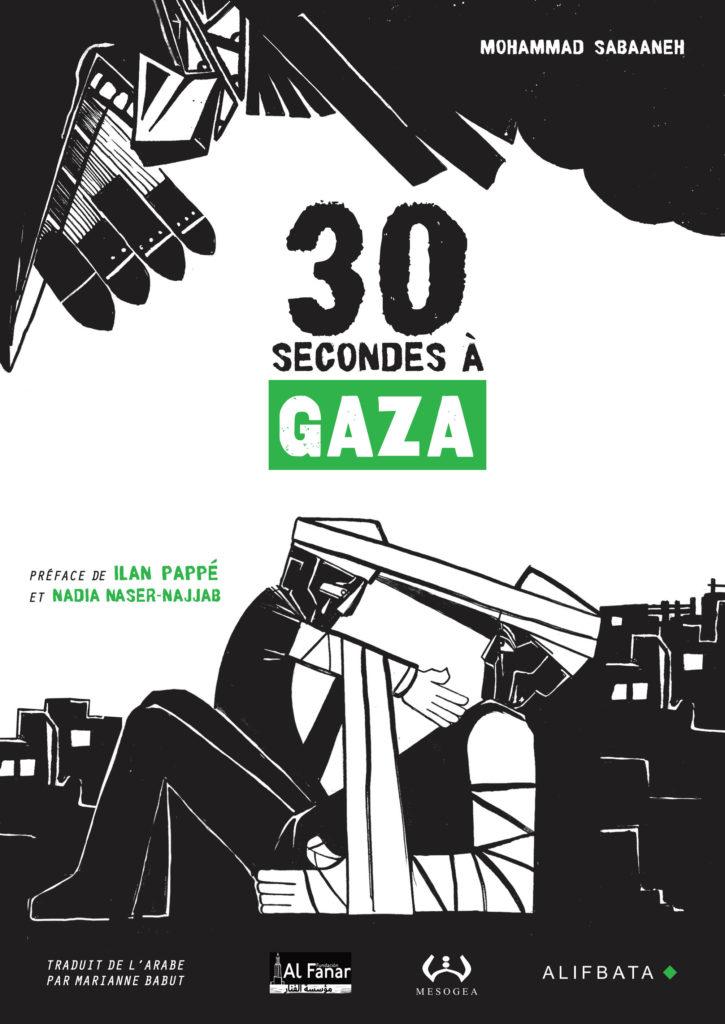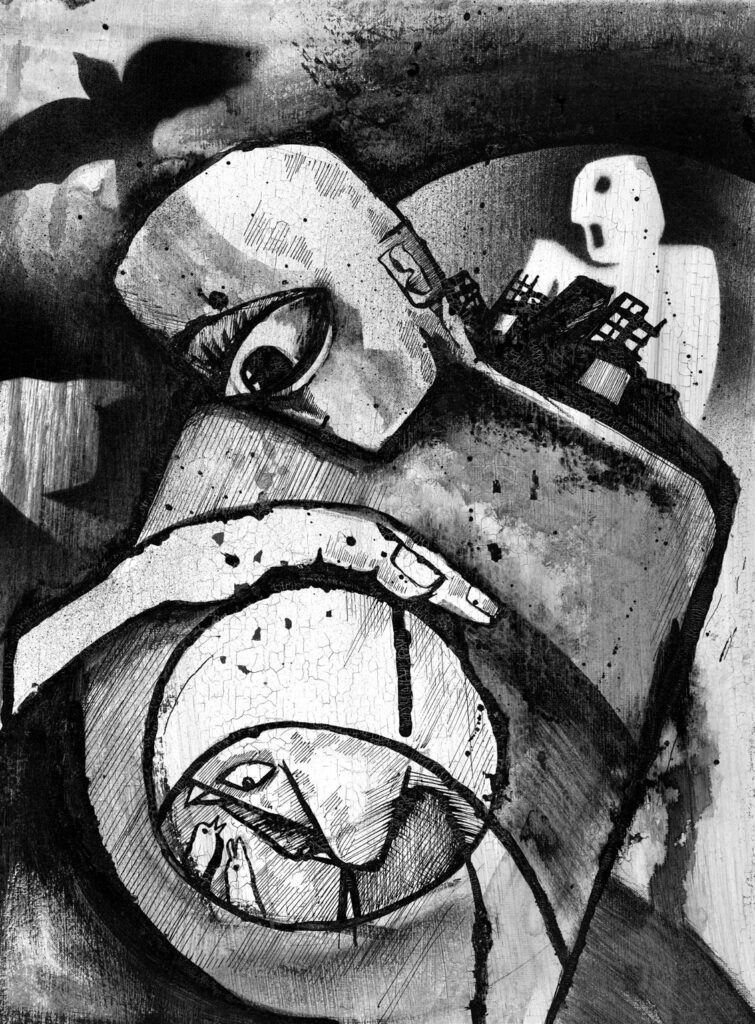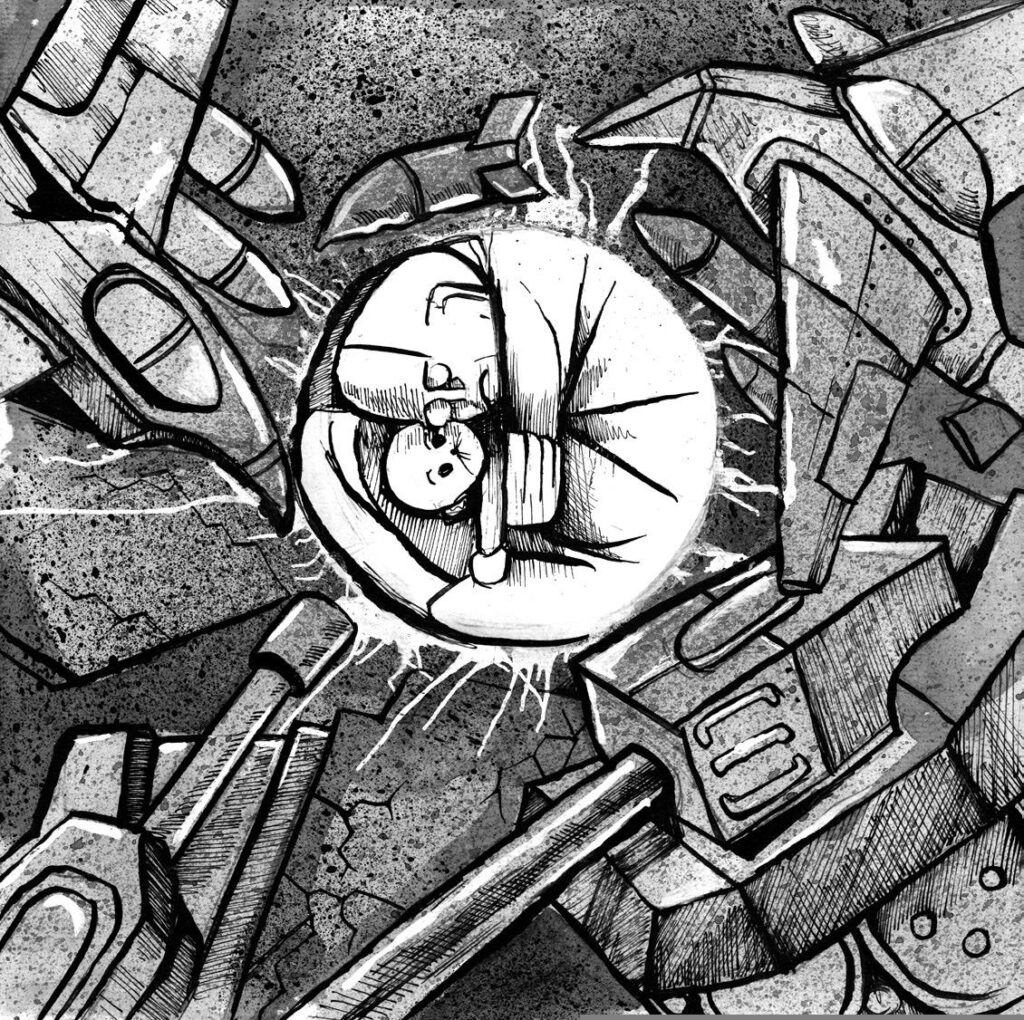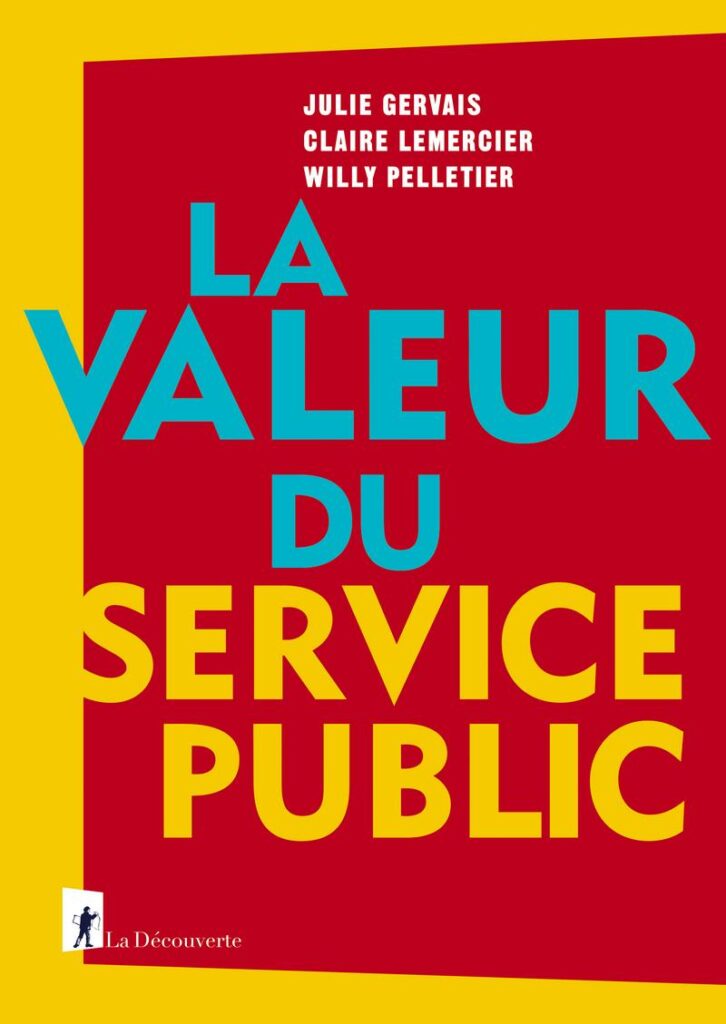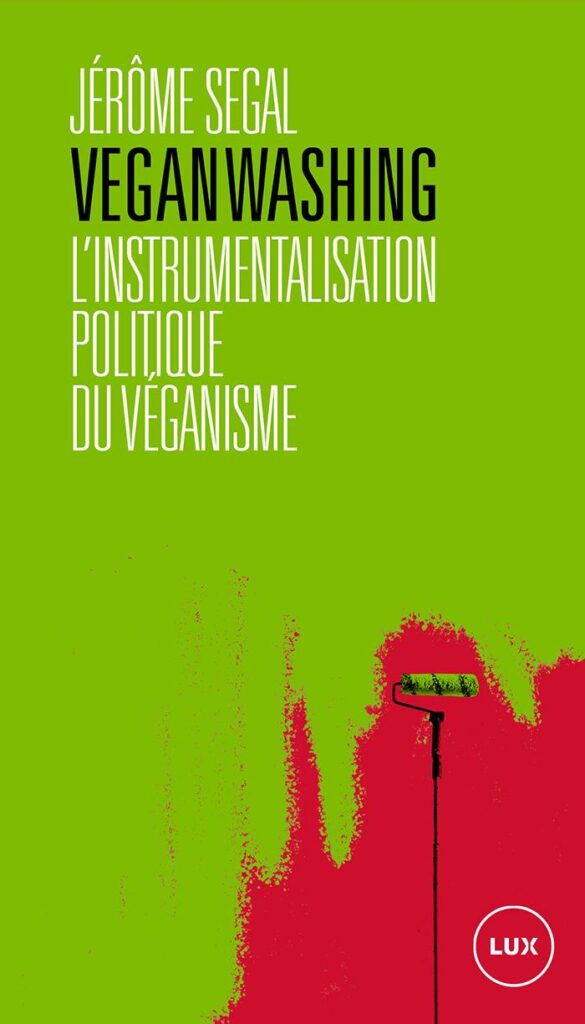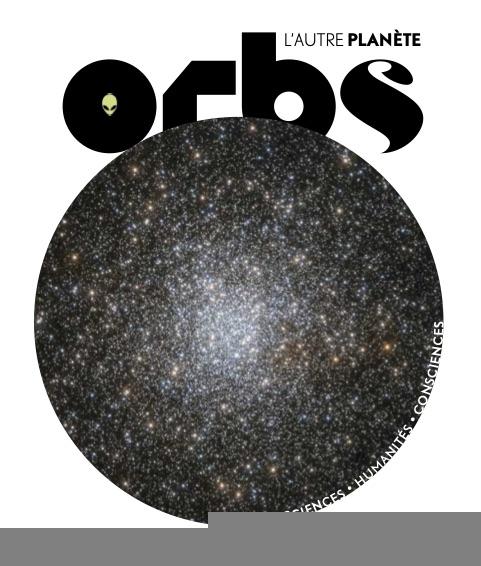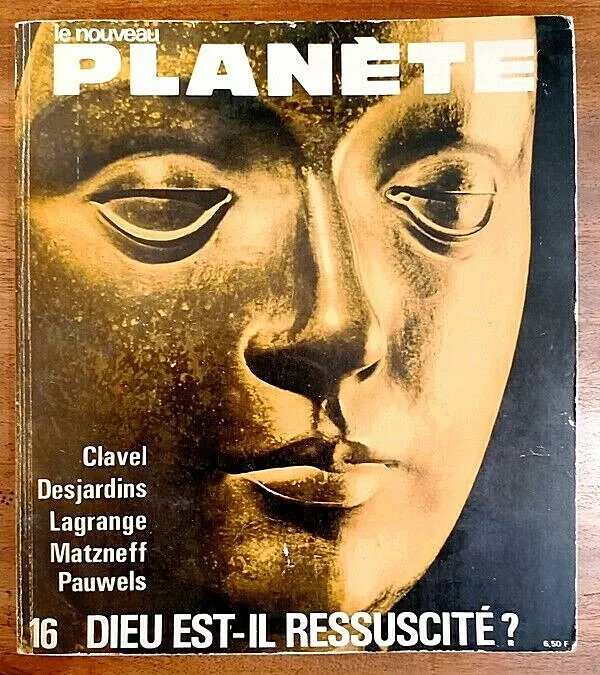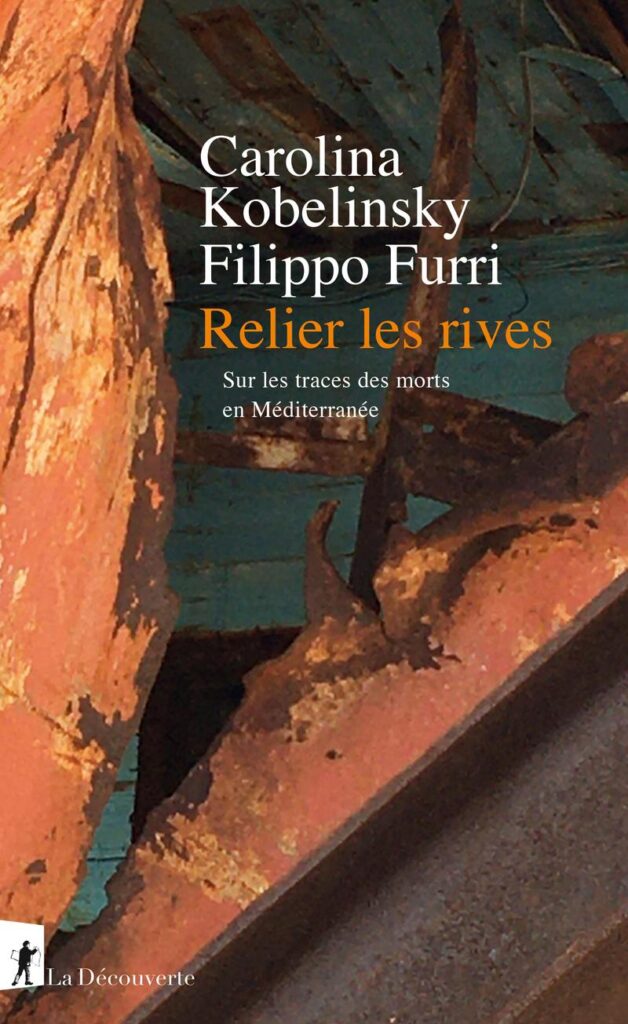Max Liboiron, Polluer, c’est coloniser. Traduit de l’anglais par Valentine Leÿs. Préface d’Isabelle Stengers et Alexis Zimmer. Éditions Amsterdam, 2024.
Max Liboiron, Polluer, c’est coloniser. Traduit de l’anglais par Valentine Leÿs. Préface d’Isabelle Stengers et Alexis Zimmer. Éditions Amsterdam, 2024.
À mon avis, c’est un grand livre. Je dis « grand », j’aurais pu dire « très bon », « excellent » – le mieux serait peut-être de dire que c’est un livre qui fera référence[1] dans les domaines qu’il aborde, soit la pollution et son rapport avec la colonisation, mais aussi (surtout ?) en épistémologie. Pardon d’utiliser les grands mots ; disons plutôt, comme me le suggère mon dictionnaire à l’entrée « épistémologie » : 1. (Philo.) Étude des sciences (la connaissance), de leurs principes, de leur validité et de leur portée, et 2. (Méd.) Science des rapports entre des méthodes scientifiques et la philosophie de la connaissance. En l’occurrence, j’opterais d’abord pour la seconde définition, même si Max Liboiron ne parle pas spécifiquement de médecine – sauf peut-être si l’on considère qu’il vise une médecine de la T/terre (oui, T/terre, j’insiste, voyez plutôt cette note de bas de page[2]).
C’est aussi un livre singulier, en ce qu’il se présente comme un essai scientifique et un manuel anticolonial (ou l’inverse : manuel scientifique et essai anticolonial). Il faudrait tout un abécédaire pour expliquer de quoi il traite. Plus que jamais, c’est le cas de le dire, les mots sont importants[3]. Les mots sont importants non seulement par leur signification « propre », si je puis dire, mais aussi par la façon dont ils sont utilisés, dont ils participent à un récit, dont ils accueillent le lecteur. Voici pour commencer un extrait des remerciements placés en tête du texte de Liboiron (après l’« Avertissement » qui sert de préface, rédigé par Isabelle Stengers et Alexis Zimmer – et qui, je le dis au passage, présente le livre de façon synthétique bien mieux que je ne saurais le faire) :
Le territoire sur lequel ce texte a été écrit est la patrie ancestrale des Beothuk. L’île de Terre-Neuve est la patrie ancestrale des Mi’kmaq et des Beothuk. Je souhaite aussi reconnaître les Inuits de Nunatsiavut et NunatuKavut et les Innu de Nitassinan, ainsi que leurs ancêtres, comme population originelle du Labrador. Nous nous efforçons d’entretenir des relations respectueuses avec toutes les populations de cette province, dans notre ambition d’accéder à une guérison collective et à la réconciliation véritable, et d’honorer ensemble cette belle terre[4].
Taanishi. Max Liboiron dishinihkaashoon. Lac La Biche, Treaty siz, d’ooshiin. Métis naasyoon, niiya ni : nutr faamii Woodman, Turner, pi Umperville awa. Ni papaa (kii ootinikaatew) Jerome Liboiron, pi ni mamaa (kii ootinikaatew) Lori Thompson. Ma paraan et Richard Chavolla (Kumeyaay). Je viens de Lac La Biche, territoire du traité 6 dans le nord de l’Alberta, Canada. Les parents qui m’ont élevé·e sont Jerome Liboiron et Lori Thompson. Je suis en lien avec ma famille métis à travers une lignée de Woodman, Turner et Umperville qui remonte à la Rivière Rouge. Rick Chavolla de la Nation Kumeyaay est mon parrain. Telles sont les relations qui me guident[5]. […]
On comprend de suite que l’on est pas en train de lire un texte académique comme les autres… Mais suivons le fil de ces remerciements (un peu plus loin) :
« Beaucoup de personnes ont contribué à construire ce livre. Nombre d’entre elles sont identifiées ici et au fil du texte dans les notes de bas de page, afin que les lecteurs·rices puissent identifier les personnes sur les épaules desquelles je me tiens. »
Oui, me direz-vous, c’est la moindre des choses, pour un·e intellectuel·le, que de reconnaître ses dettes envers ses prédécesseur·euses. Sauf que, précisément, Liboiron évite soigneusement ce terme de « dette » (peut-être d’ailleurs ne lui est-il jamais venu à l’esprit…) :
Je considère ces notes comme la mise en action d’une éthique reposant sur la gratitude, la reconnaissance de leur travail et la réciprocité. Tout cela fait qu’il est difficile de considérer que ces mots ne sont que les miens, qu’il s’agit d’un monologue ininterrompu. Ces notes ne sont pas compilées à la fin du livre : elles interrompent physiquement le texte pour appuyer et montrer mes relations[6]. Ces notes bâtissent un monde fait de penseurs et de penseuses que je respecte. En insérant les notes sur la page, je veux refléter le fait que les citations sont « des techniques de filtrage : comment certains corps occupent certains espaces en filtrant/excluant les autres », mais aussi des « technologies de reproduction : une manière de reproduire le monde autour de certains corps[7] ». Citer les savoirs de penseurs et penseuses noir·es autochtones, de couleur, de genre féminin, LGBTQAI+, bispirituel·les ou jeunes n’est qu’un aspect parmi d’autres d’une méthodologie anticoloniale qui refuse de reproduire le mythe selon lequel les savoirs, et plus particulièrement les sciences, sont le domaine réservé des hommes d’un certain âge à visage pâle. […]
Écrire un livre d’une manière queer et bispirituelle, c’est (je le pense et je le sens) un acte de coming in : une progression par cercles concentriques vers un sentiment d’appartenance, de partage, en gardant à l’esprit les comptes que l’on a à rendre – ce que j’opère en grande partie par le biais de mes notes de bas de page. »
Un peu plus loin Liboiron revient encore sur le rôle des notes de bas de page… dans la première note de bas de page de son Introduction :
Ami·e lecteur·rice, merci de lire ce livre. Ces notes de bas de page sont un espace pour accueillir la nuance et la politique. Je les utiliserai pour déployer des protocoles de gratitude et de reconnaissance (que l’on pourrait aussi appeler des citations), pour communiquer des avertissements, pour prendre soin de mes lecteur·rices (notamment en les prenant à l’écart pour bavarder ou échanger quelques blagues), mais aussi pour contextualiser, élaborer et situer mon travail. Les notes de bas de page soutiennent le texte au-dessous duquel elles sont placées, elles incarnent à la fois les épaules sur lesquelles je m’élève et les liens que je veux construire. Elles participent d’une volonté d’établir de bonne relations dans le texte et par le texte. L’un des principaux objectifs de Polluer, c’est coloniser est de montrer que la méthode est une manière d’être dans le monde, et que de telles manières sont intimement liées à des obligations : ces notes de bas de page sont une mise en action de cette idée. Merci à Duke University Press pour ces notes.
Vous aurez probablement compris que c’est moi qui souligne. Je trouve assez renversante cette façon d’exposer « l’un des principaux objectifs » du livre ainsi, au détour de cette première note de bas de page. Ce que Liboiron (j’ai déjà envie de l’appeler Max tout court tant iel nous accueille simplement et chaleureusement dans son livre, mais je ne sais pas s’il apprécierait, aussi je m’en abstiendrai) nous dit là, c’est que faire de la science comme iel l’entend, ce n’est pas se contenter de travailler au sein d’un laboratoire, d’un centre de recherche, d’une université ou même d’un « terrain » (terme qu’il récuse fortement – et justement ! – un peu plus loin dans le livre), mais c’est aussi prendre en compte toutes les relations qui forment le monde des chercheurs et chercheuses – autrement dit, ne pas considérer ce monde comme une collection d’objets à étudier/mesurer – ne pas « objectiver » ce que l’on étudie, sans souci des conséquences de pareille réification – mais nouer des rapports de coopération avec lui, ou mieux, peut-être, le « faire exister » et exister avec lui. Ne pas considérer qu’il était là, qu’il reposait là, voire qu’il gisait là de toute éternité, mais qui est vivant, qu’il bouge et que nous (y compris les chercheur·euses) bougeons avec lui. « World matters », en quelque sorte.
Or la question de la pollution, ou plus exactement, la question des études sur la pollution et de leurs conséquences – principalement, ici, la colonisation – fournit un exemple flagrant de la perspective mortifère des sciences dominantes. Je vous vois sinon sursauter, du moins froncer les sourcils : comment ça, la colonisation serait une conséquence de la pollution ? Bon, d’accord, cela mérite d’être précisé – disons que ce livre nous enseigne que pollution et colonisation sont intimement associées. Son auteur·e le démontre dès l’introduction. Iel s’appuie à cette fin sur la théorie des « seuils de pollution » apparue dans les années 1930 aux États-Unis :
[…] c’est sur les rives de l’Ohio que fut élaborée la conception dominante de la pollution environnementale aujourd’hui considérée comme un standard. Deux ingénieurs œuvrant dans le domaine [alors] tout récent du génie sanitaire, Earle B. Phelps et H. W. Streeter, (tous deux d’appartenance non marquée[8]), créèrent un modèle mathématique et scientifique pour décrire les conditions et les niveaux en deçà desquels l’eau (ou du moins, l’eau de cette partie de l’Ohio) serait capable de s’épurer par elle-même des polluants organiques qu’elle contenait[9]. Après avoir effectué des tests sous diverses conditions de température, de débit, de concentration de polluants et autres variables, les auteurs définirent l’autoépuration comme « un phénomène mesurable gouverné par des lois spécifiques et fonctionnant selon certaines réactions physiques et biochimiques fondamentales. Du fait du caractère fondamental de ces réactions et de ces lois, il [était] évident que les principes qui sous-tend[ai]ent le phénomène [de l’autoépuration] dans son ensemble [étaient] applicables virtuellement à toutes les masses d’eau polluées[10] ».
En plus de fournir une référence dans l’étude et la régulation des pollutions de l’eau, l’équation de Streeter-Phelps, comme on la désigne aujourd’hui, porte en elle-même une théorie de la pollution : il existerait un moment à partir duquel l’eau ne peut plus s’épurer par elle-même, et ce moment peut être mesuré, prédit et désigné sous le terme de pollution. La notion d’épuration sera plus tard remplacée par celle de « capacité d’assimilation », qui deviendra le terme consacré à la fois en sciences environnementales et dans les politiques publiques : on l’utilise pour désigner « la quantité d’effluents pouvant être déversée dans une masse d’eau sans occasionner d’effets écologiques délétères[11] ». Depuis les années 1930, les réglementations fixées par les États du monde entier en matière d’environnement reposent sur cette logique de la capacité d’assimilation, selon laquelle une masse – d’eau, d’humains ou autre – est capable d’assimiler une certaine quantité de contaminants avant que ne se produisent des dommages scientifiquement détectables. C’est ce que j’appelle la théorie du seuil de pollution.
Il est peut-être temps ici de dire que Max Liboiron et ses collègues (et ami·es, si je comprends bien) mènent des recherches sur le plastique ingéré par les oiseaux et les poissons dans la province canadienne de Terre-Neuve-et-Labrador.
Les plastiques, eux, ne peuvent être assimilés dans l’Ohio à la manière des polluants organiques décrite par le modèle de Streeter et Phelps. Au moment où j’extrais de petits morceaux de plastique brûlé du gésier d’un mergule nain[12] dans mon laboratoire de sciences de la mer, le Laboratoire civique pour la recherche sur les mesures environnementales (CLEAR), la théorie du seuil de pollution tout autant que la pensée selon laquelle l’avenir du plastique réside dans les déchets m’apparaissent comme la manifestation de mauvaises relations. Je ne veux pas parler des mauvaises relations qui sont à l’œuvre quand une personne prise individuellement jette ses détritus dans la nature (pratique qui ne génère qu’une faible quantité de déchets en comparaison des autres flux de plastiques dans les océans, surtout ici, à Terre-Neuve-et-Labrador, un territoire pollué par le matériel de pêche et les eaux usées non traitées). Je ne parle pas non plus des mauvaises relations sur lesquelles repose le capitalisme, qui fait passer la croissance et le profit avant les coûts environnementaux (même s’il s’agit évidemment de relations déplorables). Je pense plutôt aux mauvaises relations à l’œuvre dans une théorie scientifique qui tolère l’existence d’une certaine quantité de pollution, et qui prend pour acquis l’accès aux Terres nécessaires à l’assimilation de cette pollution. Je parle donc de colonialisme.
Les structures qui rendent possible la distribution mondiale des plastiques et leur complète intégration dans les écosystèmes et le quotidien des humains reposent sur une relation coloniale au territoire – c’est-à-dire sur le présupposé que les colons et les projets coloniaux ont accès aux terres autochtones pour mener à bien leurs objectifs coloniaux et d’occupation.
C’est moi qui souligne. Ici est formulé l’argument essentiel du livre, résumé dans son titre. Et sans aucun doute (selon moi), il faut étendre ces « mauvaises relations à l’œuvre » non seulement aux terres colonisées au sens historique et politique du terme, mais aussi, à l’évidence, aux terres des pays colonisateurs – ainsi, si les îles antillaises ont été empoisonnées au chlordécone, il est tout aussi avéré qu’un certain nombre de cours d’eau, de nappes phréatiques, de terres sont empoisonnées en France « métropolitaine » – preuve menace d’en être donnée de nouveau ces jours-ci, si j’en crois les annonces de mobilisations tractorisées par les syndicats agricoles dominants (et dominés par l’industrie agroalimentaire) qui ne cessent de réclamer – et d’obtenir ! – des ajournements de mesures antipesticides, insecticides, fongicides et j’en passe, bref qui veulent continuer à empoisonner en rond.
Les lecteur·rices attentif·ves auront peut-être sursauté en découvrant que l’auteur travaille dans un « laboratoire des sciences de la mer ». J’avais pourtant dit du mal auparavant des milieux fermés où s’exerce l’activité des sciences dominantes. Ce à quoi Max Liboiron répond que ses collègues et lui, au sein de CLEAR, s’efforcent « de pratiquer les sciences différemment en privilégiant une relation anticoloniale au territoire ». « Anti » (souligné dans le texte) plutôt que dé. Ce qui mériterait toute une explication. Elle vient au chapitre 3 de Polluer, c’est coloniser, auquel je vous renvoie. Je pense que ce serait trop long de m’aventurer encore dans ce développement-là. J’en donnerai seulement un aperçu à travers une citation qui vous donnera, j’espère, envie d’aller découvrir le reste de l’argumentation :
À la différence de l’anticolonialisme, qui peut revêtir diverses formes, « la décolonisation implique spécifiquement la restitution aux autochtones de leurs terres et de leurs vies. La décolonisation n’est pas une métonymie de la justice sociale[13][…]. Est-ce que CLEAR fait un travail décolonial ? Est-ce que nous restituons des Terres et des Vies ? Parfois/peut-être, mais ce n’est pas la version que j’adresserais au grand public. Pour ce que j’en comprends, la majeure partie de l’action de CLEAR n’est pas décoloniale.
Effectivement, les travaux de CLEAR, même s’ils présentent différents aspects anticoloniaux (bien décrits dans le chapitre 3), comme, entre autres exemples, le fait de soumettre les projets de recherche, puis de publications, aux communautés concernées par ces projets à travers leurs relations avec les animaux visés par ces recherches (ainsi des pêcheurs et des poissons) et surtout de respecter leur avis, leur consentement ou leur refus, explicite ou non, ces travaux donc s’inscrivent aussi dans un cadre institutionnel – universitaire, académique. Il s’agit de poser les bonnes questions et de chercher à soigner les relations dans leur milieu, et cela est déjà de l’anticolonialisme. Quant à décoloniser, c’est encore une autre paire de manches…
Vous aurez compris, en tout cas, que j’ai été enthousiasmé par ce « discours de la méthode » qui m’en a plus appris, je crois, sur ce que c’est que la pollution, la science (ou les pratiques scientifiques) et encore plus sur les relations coloniales que bien d’autres livres savants. J’ajoute qu’il est écrit simplement, dans un langage très accessible et qu’il est plein d’humour. On ne s’ennuie pas une seconde en le lisant. Un grand merci à Max Liboiron ! (Iel dit souvent : « maarci ! » à celles et ceux qui l’inspirent et/ou avec qui iel travaille[14]) C’est pourquoi je vous le recommande chaudement.
franz himmelbauer, pour Antiopées, ce 10 novembre 2024.
[1] J’ai parlé au futur mais, de fait, le livre ou les articles précédents de Max Liboiron font déjà référence – je les ai vus cités dans plusieurs bouquins excellents eux aussi comme Exploiter les vivants, de Paul Guillibert (Amsterdam 2023), Nous ne sommes pas seuls, de Léna Balaud et Antoine Chopot (Seuil, 2021), La Malédiction de la muscade, d’Amitav Gosh (Wildproject, 2023 [2021])…
[2] [Note de Max Liboiron, dans l’Introduction] Vous remarquerez à travers ce livre que le mot « Terre » (Land, en anglais, NdlT) reçoit certaines fois une capitale, et d’autres fois non. Je suis en cela le modèle de Styres et Zinga (respectivement autochtone et colon [pour comprendre cette caractérisation, allez ci-dessous à la note 8]) qui « capitalisent le mot Terre lorsqu’il est utilisé comme un nom propre indiquant une relation primaire, et non lorsque le mot est utilisé en un sens plus général. Pour nous, la terre au sens général désigne les paysages comme espaces géographiques et physiques fixes qui comprennent le sol, les roches et les masses d’eau ; tandis que le nom propre “Terre” excède dans sa portée l’espace matériel fixe. La Terre est un lieu imprégné de spiritualité, ancré dans des relations d’interconnexion et d’interdépendance, dans un positionnement culturel, et elle est hautement contextualisée » (Sandra Styres et Dawn Zinga, « The Community-First Land-Centred Theoretical Framework », p. 300-301). De même, lorsque j’écris « Terre » avec une capitale, je convoque l’entité unique qui est l’esprit vivant combiné des plantes, des animaux, de l’air, de l’eau, des humains, des histoires et des événements reconnu par de nombreuses communautés autochtones. Lorsque j’utilise « terre », sans capitale, je fais référence à ce concept dans le cadre d’une vision du monde coloniale, dans laquelle les paysages sont communs, universels et présents partout, même avec de grandes variations. Pour la même raison, j’écris aussi « Nature » et « Ressource », et occasionnellement « Science », avec une capitale. Plutôt que d’utiliser un n, un r ou un s minuscules qui pourraient indiquer que ces mots sont communs ou universels, la capitalisation signale qu’il s’agit de noms propres qui sont hautement spécifiques à un lieu, un moment et une culture. Autrement dit, la Nature n’est pas universelle ni commune, mais unique à une vision du monde particulière, qui est apparue à un moment particulier pour des raisons spécifiques. Utiliser des noms propres pour nommer les choses en propre prolonge une tradition dans laquelle le fait d’utiliser le nom d’une personne ou d’une chose permet de la sortir de l’ombre et d’établir avec elle un rapport – de force, de questionnement, de reconnaissance, de parenté. C’est pour cette raison que je ne crains pas de me faire taxer d’universitaire élitiste ou de naïve quand j’utilise des majuscules. […] Sur la politique de la capitalisation dans les sciences féministes, voir Banu Subramaniam et Angela Willey, « Introduction ». Voir aussi Sandra Harding, Science and Social Inequality.
[3] Cher·e lecteur·ice, au cas où tu ne l’aurais pas déjà découvert, rends-toi sur le site Les mots sont importants. Merci à vous, Sylvie Tissot et Pierre Tévanian, pour la qualité de vos analyses et votre ténacité.
[4] [Note de Max Liboiron] Cette formule de reconnaissance de la Terre a été produite collectivement avec les leaders de la majeure partie des organes de gouvernement autochtones de la province. Ces mots ne sont pas de moi : ce sont des mots choisis pour les personnes accueillies sur cette terre. Il ne m’appartient pas de les modifier.
[5] [Note de Max Liboiron] Cher·e lecteur·ice : merci de ta présence. Les présentations sont importantes parce qu’elles montrent d’où provient mon savoir, envers qui j’entretiens des obligations et comment je me suis construit·e. Certaines de ces choses ne sont pas destinées à une consommation publique et volatile, tandis que d’autres le sont. [Suit une adresse « à l’attention des jeunes penseur·euses autochtones sur la façon de se présenter, très intéressante, mais qui ne touchera ici pas beaucoup de monde (même si l’on peut la trouver « touchante »). C’est pourquoi je tronque le texte de cette note.]
[6] « Éthique », ce terme ne peut que me renvoyer à une lecture dans laquelle je me suis plongé après celle de Polluer, c’est coloniser : celle des cours de notre cher Gilles Deleuze Sur Spinoza. Cours novembre 1980-mars 1981, que vient d’éditer David Lapoujade aux Éditions de Minuit (ils existaient déjà, grâce, essentiellement, aux enregistrements et retranscriptions de Richard Pinhas, « auditeur régulier et proche ami » du philosophe, dixit Lapoujade dans sa présentation – on peut retrouver ce matériel sur https//www.webdeleuze.com et sur YouTube). Or, dans le cours du 2 décembre 1980, Deleuze revient sur un point qu’il avait déjà soulevé dans ses deux ouvrages sur Spinoza (Spinoza et le problème de l’expression et Spinoza – philosophie pratique) et dans Critique et Clinique : soit les différentes « vitesses » du texte, et particulièrement celle des scolies, par rapport à celle de la démonstration more geometrico : « […] il me semble […] qu’il y a, dans L’Éthique, cette chose insolite que Spinoza appelle des scolies, à côté, en plus des propositions, démonstrations, corollaires. Il écrit des scolies, c’est-à-dire des espèces d’accompagnement des démonstrations. Je disais : si vous les lisez à haute voix – il n’y a pas de raison de traiter un philosophe plus mal qu’on ne traite un poète –, vous serez immédiatement sensible à ceci : c’est que les scolies n’ont pas la même tonalité, pas le même timbre, que l’ensemble des propositions et démonstrations et que, là, le timbre se fait, comment dirais-je, pathos, passion. Spinoza y révèle des espèces d’agressivité, de violences auxquelles un philosophe aussi sobre, aussi sage, aussi réservé ne nous avait pas forcément habitués. Il y a une vitesse des scolies qui est vraiment une vitesse de l’affect, par différence avec la lenteur relative des démonstrations, qui est une lenteur du concept. Comme si, dans les scolies, des affects étaient projetés alors que, dans les démonstrations, des concepts sont développés. » Il y a quelque chose comme ça dans une bonne partie des longues notes de Liboiron. Même s’il s’agit plus ici d’affects de reconnaissance et de gratitude, comme il le dit lui-même, on les ressent bien « physiquement », comme il dit aussi. Et c’est probablement un des charmes (au sens fort) de ce livre.
[7] [Note de Max Liboiron] Sarah Ahmed, « Making Feminist Points ». Sur la politique de la citation, voir Carrie Mott et Michael Cockayne, « Citation Matters » ; et Eve Tucks, K. Wayne Yang et Rubén Gaztambide-Fernández, « Citation Practices ».
[8] [Note de Max Liboiron] On a coutume de présenter les auteur·ices autochtones en indiquant leur nation/affiliation, tandis que l’on ne marque jamais celleux qui sont blanc·hes et colons […].Cette absence de marquage est un acte parmi beaucoup d’autres qui placent l’identité de colon blanc comme norme majoritaire, tandis que toute déviation par rapport à cette norme doit être marquée et nommée. C’est cette même positionnalité que Simone de Beauvoir (française) décrit comme constituant « à la fois le positif et le neutre, au point qu’on dit en français “les hommes” pour désigner les êtres humains ». Pas cool. Ce qui m’a conduit·e à un dilemme méthodologique. Me fallait-il marquer ainsi tout le monde ? Personne ? J’ai hésité à laisser la question de côté parce que c’est une décision difficile, voire inconfortable, mais puisque c’est justement de méthode qu’il s’agit dans ce livre, j’ai compris que je devais arrêter de tortiller du cul et prendre une décision. Les théories féministes du point de vue, de même que les processus de paix et de réconciliation, soutiennent que le placement social et les différents collectifs auxquels nous appartenons ont une influence sur nos relations, nos obligations, notre éthique et nos savoirs. Les colons occupent dans la réconciliation une place différente de celle des peuples autochtones ou des Noir·es qui ont été arrachés à leur Terre. Comme l’écrit la paperson (colon racisé issu des diasporas), « “colon” n’est pas une identité ; c’est un espace juridique idéalisé habité par les droits exceptionnels accordés aux citoyen·nes colons conformes à la norme, et un exceptionnalisme idéalisé par lequel l’État colon exerce sa souveraineté. Le “colon” est un espace d’exception duquel émerge la blanchité […]. La norme anthropocentrique est inscrite dans son image. » c’est ce droit « normal » présumé neutre et positif qui se manifeste quand on omet de présenter les colons comme tels, comme si la présence de ces derniers sur une Terre, et plus particulièrement sur une Terre autochtone, représentait la norme stable et ordinaire. C’est le colonialisme de peuplement qui par réflexe dispense les colons de déclarer leur relation à la terre et aux systèmes coloniaux. Voir la paperson, A Third University Is Possible et Simone de Beauvoir, Le Deuxième Sexe.
[9] [Note de Max Liboiron] Les polluants organiques peuvent être aussi des polluants industriels. « Organique » n’est pas ici l’équivalent de « d’origine naturelle » : l’arsenic, le radon et le méthylmercure, bien qu’étant des composés « d’origine naturelle », ne se rencontrent pas dans la « nature » dans des volumes correspondant aux échelles de toxicité sans la présence d’installations industrielles.
[10] [Note de Max Liboiron] H. W. Streeter et E. B. Phelps, « A Study of the Pollution », p. 59.
[11] [Note de Max Liboiron] Parmi les termes savants utilisés pour décrire les seuils de dommages dans des pays et des contextes variés, on rencontre aussi : capacité porteuse (carrying capacity, en anglais, NdlT), charge critique (critical load), seuil acceptable (allowable threshold) et dose maximale permissible (maximum permissible dose). Ces termes ont des déclinaisons variées selon les disciplines scientifiques : dose de référence (reference dose, RfD), dose sans effet négatif observé (no observed adverse effect level, NOAEL), dose minimale avec effet négatif observé (lowest observed adverse effect level, LOAEL), dose létale médiane (lethal dose 50 per cent, LD50), concentration efficace médiane (median effective concentration, EC50), concentration maximale acceptable (maximum acceptable concentration, MAC) et dose dérivée avec effet minimum (derived minimal effect level, DMEL) (une unité de mesure très problématique, qui évalue le niveau d’exposition dans le cadre duquel le niveau de risque associé à une substance cancérigène sans valeur-seuil reste « tolérable », ce qui a pour effet de créer un seuil social quand il n’existe pas de seuil toxicologique). Chacune de ces notions a ses particularités, mais elles reposent toutes sur une même théorie. [Max Liboiron conclut cette note en disant qu’il revient sur cette idée dans son chapitre 1. Si vous voulez creuser, vous savez ce qu’il vous reste à faire…]
[12] [Note de Max Liboiron] Le mergule nain (little auk ou dovekie, en anglais, NdlT), ou Alle alle, selon l’interlocuteur auquel vous avez affaire, ressemble à un macareux moine en miniature, mais sans le bec rigolo. On peut observer ces oiseaux quand ils volent en ligne au-dessus de l’eau. Certaines personnes, à Terre-Neuve-et-Labrador, les mangent, mais l’oiseau a des os minuscules, fins et difficiles à décortiquer.
[13] C’est une citation d’Eve Tuck et K. Wayne Yang, dont Max Liboiron nous recommande chaudement de lire La décolonisation n’est pas une métaphore, « si vous avez déjà revendiqué de décoloniser quelque chose, ou simplement si l’idée vous semble attrayante » (trad. fr. j.-B. Naudy, Sète, Rot-Bo-Krik, 2022).
[14] Ou même à d’autres, comme dans cet extrait de ses remerciements (au passage, je dois dire que je n’ai jamais lu d’aussi beaux – et pertinents – remerciements, bien loin de l’exercice quasi obligatoire et un peu sec que l’on rencontre trop souvent – et plutôt à la fin – des livres de « non-fiction ») : Les leçons concernant les relations s’apprennent dans un lieu précis. Toute ma gratitude à Lac La Biche, Edmonton, New York et la provine de Terre-Neuve-et-Labrador pour avoir partagé leurs leçons et régulièrement corrigé mon ignorance et ma présomption. Maarsi. »