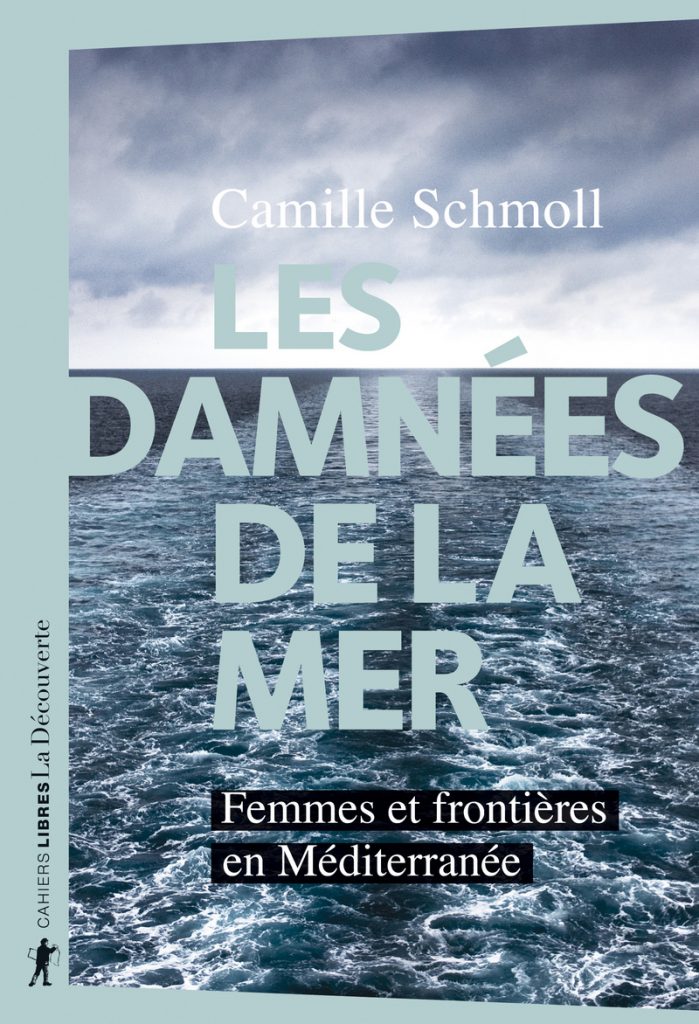 Camille Schmoll, Les Damnées de la mer. Femmes et frontières en Méditerranée, La Découverte, novembre 2020
Camille Schmoll, Les Damnées de la mer. Femmes et frontières en Méditerranée, La Découverte, novembre 2020
Camille Schmoll est géographe et elle travaille avec des équipes de recherches sur les migrations au sein d’institutions académiques et du Groupe international d’experts sur les migrations (GIEM) dont elle est cofondatrice. Dans son annexe méthodologique intitulée « L’ethnographie au temps de la frontière », elle dit d’abord qu’elle a commencé le travail de terrain qui a abouti à ce livre en 2010 et qu’elle l’a interrompu en 2018. « Durant cette enquête au long cours, dit-elle, qui peut être vue comme une enquête “dans” et “sur” la frontière, j’ai articulé trois stratégies de recherche : des observations de “lieux-frontières”, le recueil des récits de trajectoires, des suivis de femmes migrantes. »
Une enquête « dans » et « sur » la frontière : en effet , il ressort de la condition des femmes en déplacement, essentiellement depuis l’Afrique, qu’elle a rencontrées en Italie et à Malte principalement, que les frontières ne sont pas seulement ces lignes pointillées que l’on nous apprend à l’école à considérer comme telles – de simple limites plus ou moins barricadées que l’on pourrait, ou pas, franchir d’un seul bond, tel Remus sautant par-dessus le sillon creusé par son frère Romulus autour de la future cité de Rome (on sait d’ailleurs le sort de Remus, assassiné par Romulus furieux que l’on n’ose point prendre au sérieux son fantasme de confinement, sort emblématique de celui réservé de tout temps aux nomades et autres personnes « déplacées »). Non, les frontières sont épaisses, plus que cela, elles sont profondes : en l’occurrence, depuis l’Afrique subsaharienne et l’Afrique de l’Est jusqu’aux rivages européens de Mare nostrum (comme la nommaient, bien sûr, les héritiers des fils de la louve, mais aussi nom donné par les autorités italiennes à une opération de sauvetage en mer lancée en 2013 suite à deux naufrages au large de Lampedusa, au cours desquels périrent noyées 366 personnes, le 3 octobre 2013 et 268 une semaine plus tard, le 11 octobre ; cédant aux pressions xénophobes, les autorités italiennes et européennes l’ont remplacée en novembre 2014 par l’opération Triton, menée par Frontex – unité militaro-policière chargée de faire respecter le confinement de la forteresse Europe, et qui emploie des moyens un peu plus sophistiqués que Romulus, mais qui aboutissent au même résultat, soit des dizaines de milliers de mort·e·s en Méditerranée). Frontières profondes et périlleuses, donc. Et frontières longues, interminables au sens temporel : qui durent1. En effet, les voyages des femmes qu’a rencontrées Camille Schmoll durent des années. Il y a d’abord la traversée de l’Afrique – souvent des mois durant lesquels il faut parfois s’arrêter pour travailler un moment, afin de trouver l’argent nécessaire à la poursuite du voyage. Ensuite, pour une très grande partie d’entre elles – et ici, il faut bien se rendre compte que l’on parle des survivantes et pas seulement des rescapées de la traversée en mer, mais aussi de la traversée du désert et là, personne ne sait combien de personnes sont mortes, abandonnées par leurs convoyeurs, agressées, violées, dévalisées de leurs maigres biens – elles ont encore subi la détention en Libye, qui peut durer elle aussi très longtemps dans des conditions effroyables (c’est d’ailleurs une des raisons qui expliquent que les migrant·e·s n’hésitent pas à s’embarquer dans d’infâmes rafiots afin de tenter la traversée à tout prix). Et finalement, une fois qu’elles ont enfin mis le pied sur la terre européenne, où se retrouvent-elles ? Dans différentes sortes de camps qui vont du centre d’« accueil » (les guillemets sont de moi) au centre de rétention. Soit : « dans » la frontière . Je suis passé du pluriel – les frontières – au singulier – la frontière – sans y prendre garde ; Camille Schmoll montre bien, d’ailleurs, que les migrantes vivent dans la frontière. Plus tard, si elles sortent des camps, elles continueront à la trimballer avec elles, ou plus exactement, c’est le regard des Blancs européens « autochtones », plus ou moins bienveillant, paternaliste ou hostile, qui la leur collera à la peau.
« Trois stratégies de recherche », écrit donc Camille Schmoll. D’abord les « observations de “lieux-frontières” ». Elle y a parlé avec les personnels employés et les cadres dirigeants mais aussi et avant tout avec les femmes migrantes. Dans les centres d’accueil (relativement ouverts), elle a « cuisiné, fait des courses, langé des enfants et raconté des histoires, dansé et organisé des jeux […] accompagné des femmes à leurs visites médicales ou à la questura (préfecture) ». Dans les centres fermés, c’était évidemment plus compliqué et elle a dû se contenter d’entretiens de quelques heures à chaque fois, avec des femmes qu’elle ne revoyait pas d’une visite à l’autre, car elles avaient la plupart du temps changé de camp. Ces différents “lieux-frontières” étaient tous situés en Italie et à Malte.
Le « recueil des récits de trajectoires », ensuite. Camille Schmoll a mené des entretiens avec quatre-vingts femmes dont le seul point commun, finalement, était d’avoir traversé la Méditerranée. Les « damnées de la mer », donc. Référence évidente à Frantz Fanon dont le nom n’apparaît cependant guère dans le texte (une seule fois, me semble-t-il). Le livre doit-il son titre à l’éditeur ? Cela ne lui enlèverait rien. Si l’on voulait faire un parallèle avec Fanon, on pourrait dire que Schmoll cherche à dresser des portraits qui rendent justice à ces femmes migrantes, montrant que si elles ont subi toutes sortes d’avanies, elles n’en ont pas moins gardé leur capacité d’initiative, leur force et leur courage. Il est vrai que les médias européens, lorsqu’ils ne se montrent pas ouvertement racistes et xénophobes, font souvent preuve de commisération envers ces pauvres gens qui ne peuvent être autre chose que des victimes – envers et contre l’évidence : ce sont bien plutôt des héros et des héroïnes qui ont affronté des dangers au moins aussi graves (et en tout cas moins mythiques, hélas) qu’Ulysse en son odyssée. Les femmes font encore plus l’objet de cette assignation à la condition de victimes passives. De ce point de vue, ce livre est vraiment très précieux, en ce qu’il les donne à voir autrement que du point de vue réducteur qui est celui de trop (la plupart ?) d’Européens blancs. Bien sûr, en tant que « chercheuse », et même si elle est restée au plus près du « terrain », c’est-à-dire de l’observation in situ et de l’écoute des femmes migrantes, elle voulait aussi comprendre quels étaient les points communs, autres que la traversée de la Méditerranée, entre les expériences vécues par ses interlocutrices. Ainsi, elle a articulé son livres en chapitres thématiques, convoquant chaque fois des morceaux de récits à l’appui de ses observations et de ses suppositions. Elle a cependant tenu à ce que son premier chapitre soit constitué par le seul récit d’une femme camerounaise, Julienne, qu’elle a rencontrée à plusieurs reprises, d’abord en Sicile en 2016 et 2017, puis à Paris (au domicile de l’auteure) en 2018 et enfin en 2019 dans le village français ou vit désormais Julienne. La présentation que fait Camille Schmoll de ce récit constitue me semble-t-il une bonne introduction à l’ensemble des chapitres qui suivent. C’est pourquoi je conclus cette note en la citant, non sans recommander chaudement la lecture de ce livre.
« À l’instar des récits d’immigrés que l’on trouve dans l’œuvre du sociologue Abdelmalek Sayad, l’histoire de Julienne est tout aussi exemplaire que singulière. Elle pourrait très probablement fa ire l’objet de multiples interprétations, nous amener à réfléchir à la violence au temps des crises2, ou encore aux structures de genre en Afrique subsaharienne. Dans ce livre, elle sert d’introduction à une géographie politique de la vie au temps de la frontière et me permet d’illustrer la vulnérabilisation des femmes, tout au long de la route, sans l’essentialiser. Elle me permet de penser la frontière comme épreuve pour celles qui sont dans l’entre-deux, ni tout à fait expulsables ni tout à fait installables ou installées, celles qui sont parties mais ne sont pas encore arrivées3.
L’alternance, dans le récit de Julienne, entre forme active et passive, reflète la tension dans laquelle se trouvent les femmes aux frontières, prises dans des jeux d’acteurs qui les dépassent, piégées dans l’univers des réseaux et des politiques migratoires et, pourtant, toujours actrices à la première personne de leur destinée et de leurs trajectoires.
Ce récit, sur le mode de l’expérience vécue, est ponctué de nombreux épisodes de violence, sa lecture peut être choquante ou lourde. J’espère qu’il aidera malgré tout, au-delà de l’émotion qu’il peut susciter, à mieux comprendre la question migratoire en Méditerranée. L’histoire de Julienne me permet, en effet, d’introduire les différents thèmes qui seront explorés au fil des chapitres qui suivront : les motivations mixtes qui président au départ des migrantes, et les difficultés de la migration « seule » quand elle se fait, comme c’est le cas de Julienne, sans la bénédiction ou l’aide des proches ; le continuum entre les différentes formes de violences genrées ; leur imbrication avec la violence des politiques de contrôle, les ambivalences et la lenteur des politiques d’accueil des personnes demandeuses d’asile ; le décalage entre la gestion politique des flux et les projets migratoires ; la rencontre avec une société d’accueil tantôt chaleureuse, tantôt distante, souvent paternaliste ; la tension entre structures de pouvoir et autonomie qui s’exprime tout au long du parcours ; les réorientations constantes de la politique migratoire, qui se font au fil des opportunités et des obstacles, des bonnes et mauvaises rencontres ; les multiples renoncements, aussi : en premier lieu, pour Julienne, le renoncement à son fils, mais aussi le renoncement à une certaine idée de l’Europe, telle qu’elle l’avait imaginée avant de traverser la mer. »
1 À ce propos, je reprends le texte d’une des notes du livre : « On peut ici rappeler la critique faite par la géographe Doreen Massey au concept de “compression spatio-temporelle” proposé par David Harvey. Pour Harvey, la compression spatio-temporelle correspond au rétrécissement du temps lié à un “capitalisme de l’instantanéité”, à une forme d’accélération des rythmes du quotidien. Mais, lui oppose Doreen Massey, la compression spatio-temporelle n’est pas vécue de la même façon par toutes et tous, et elle dépend de “géométries du pouvoir complexes”. Les lieux d’hébergement sont en effet, à l’inverse de l’accélération décrite par Harvey, des lieux d’étirement temporel.
2 (Note du lecteur) Ici je me permets de renvoyer à une de mes lectures précédentes, dont de nombreux passages font écho à celle des Damnées de la mer : Une théorie féministe de la violence, de Françoise Vergès.
3 (Note du lecteur) C’est moi qui souligne.
