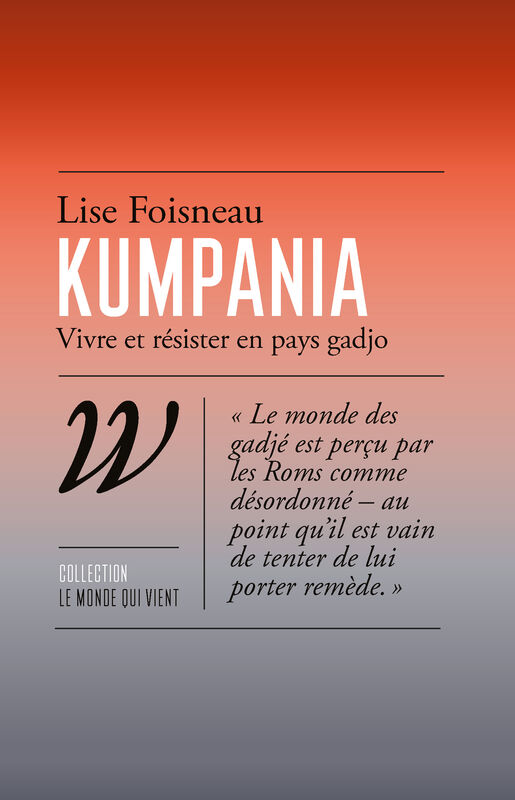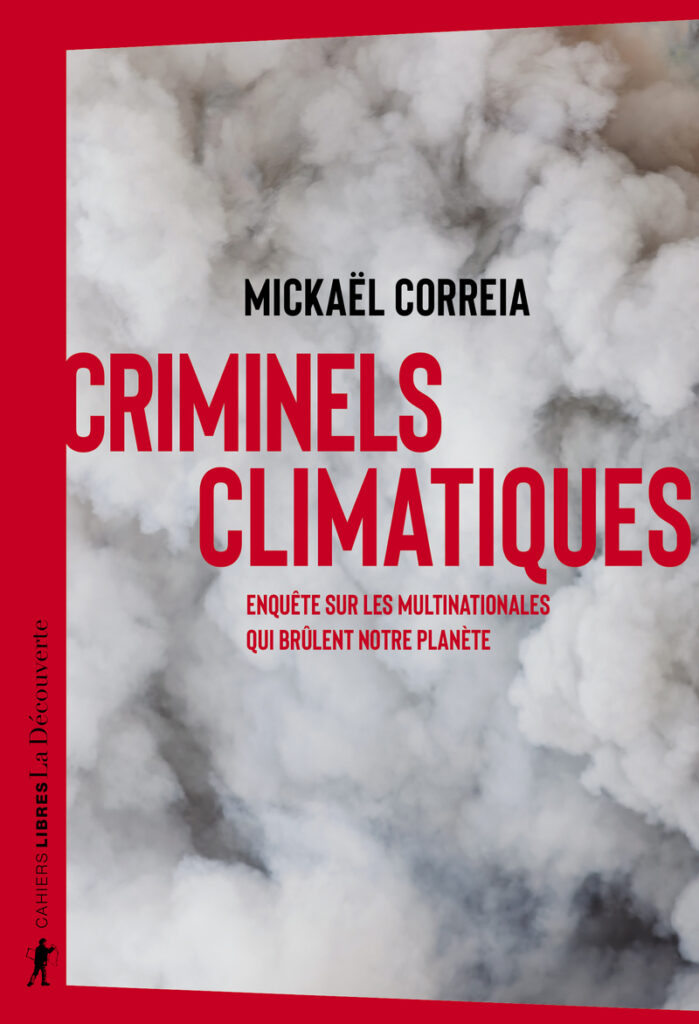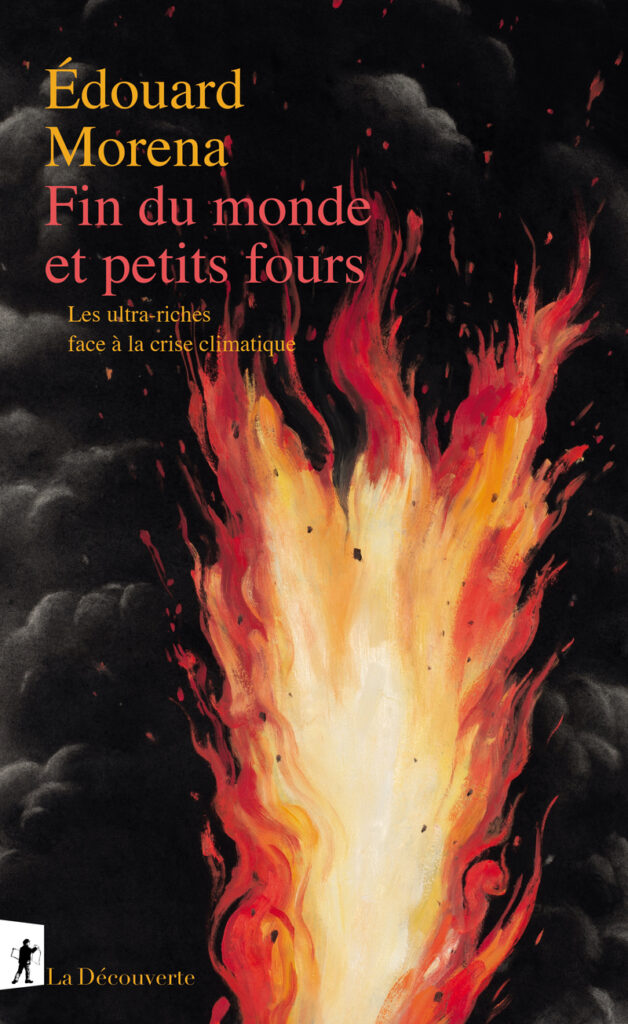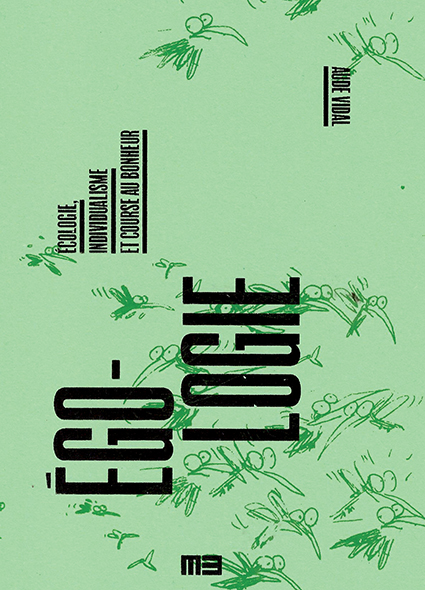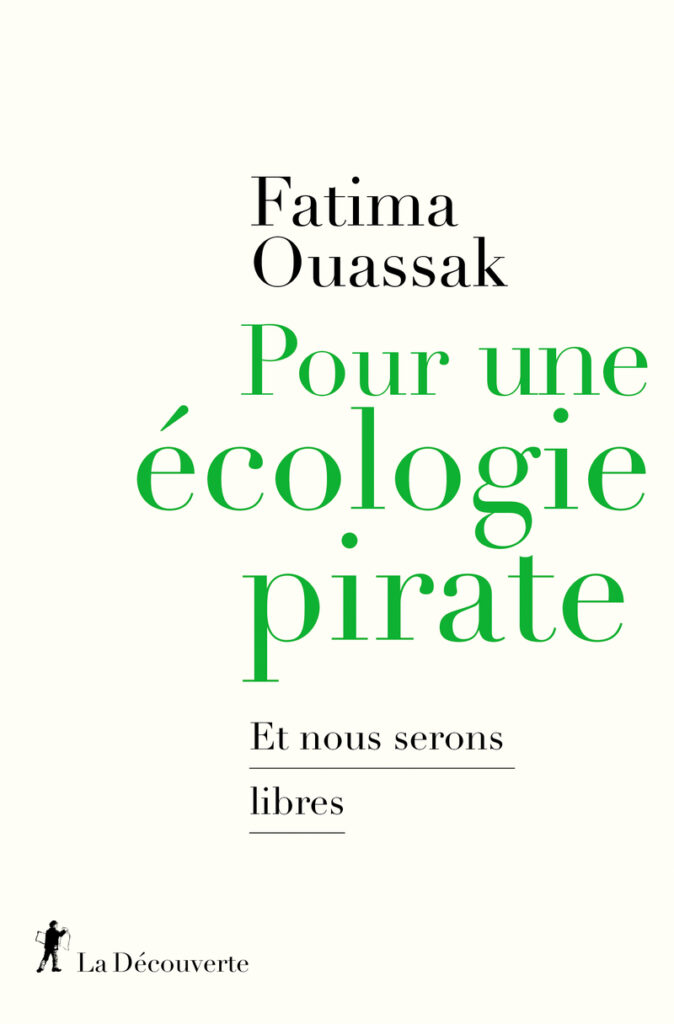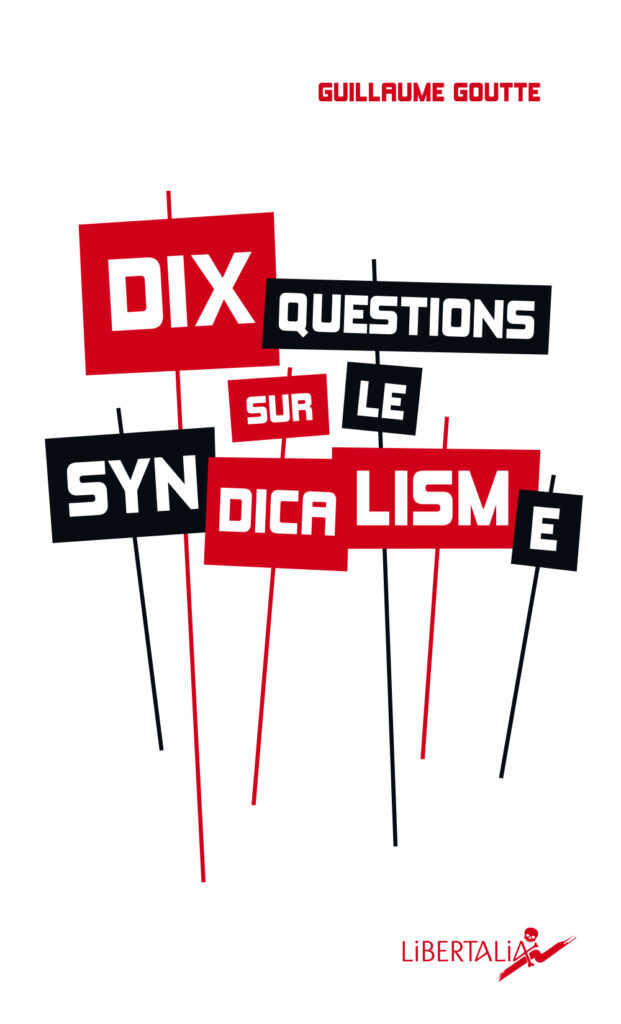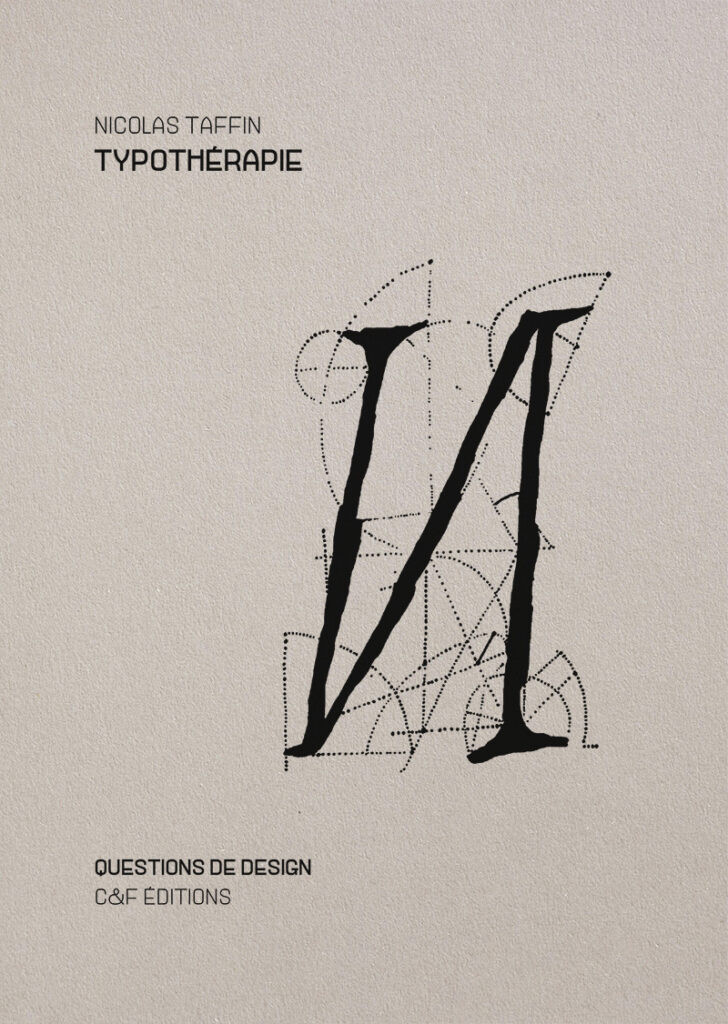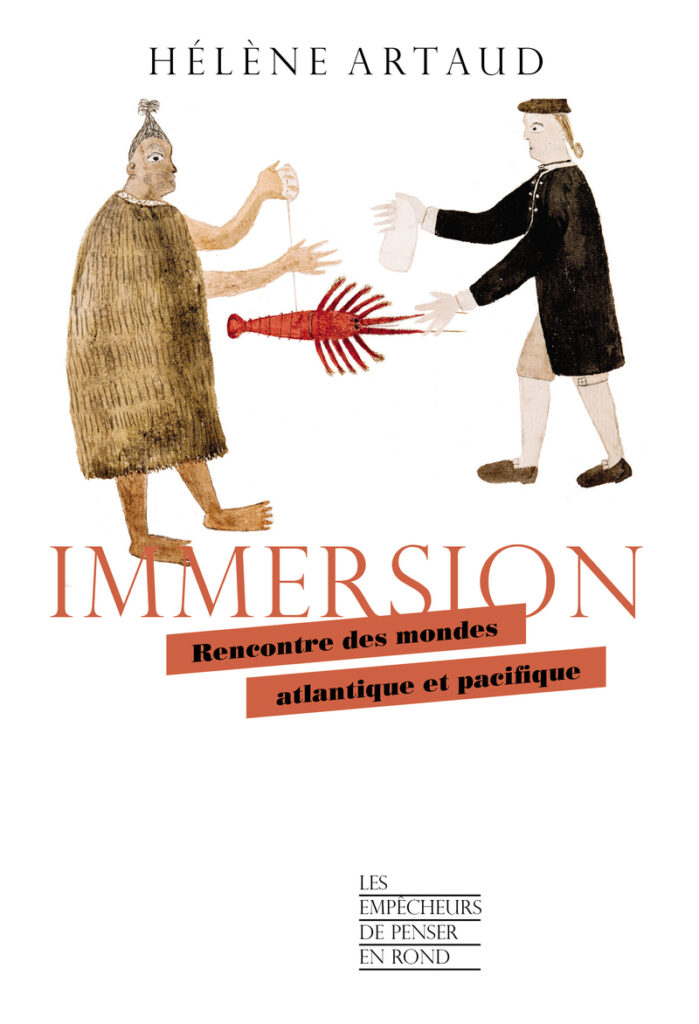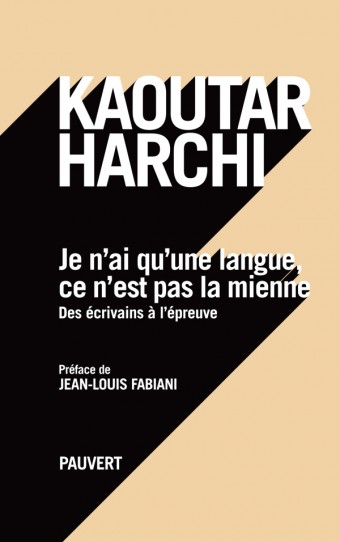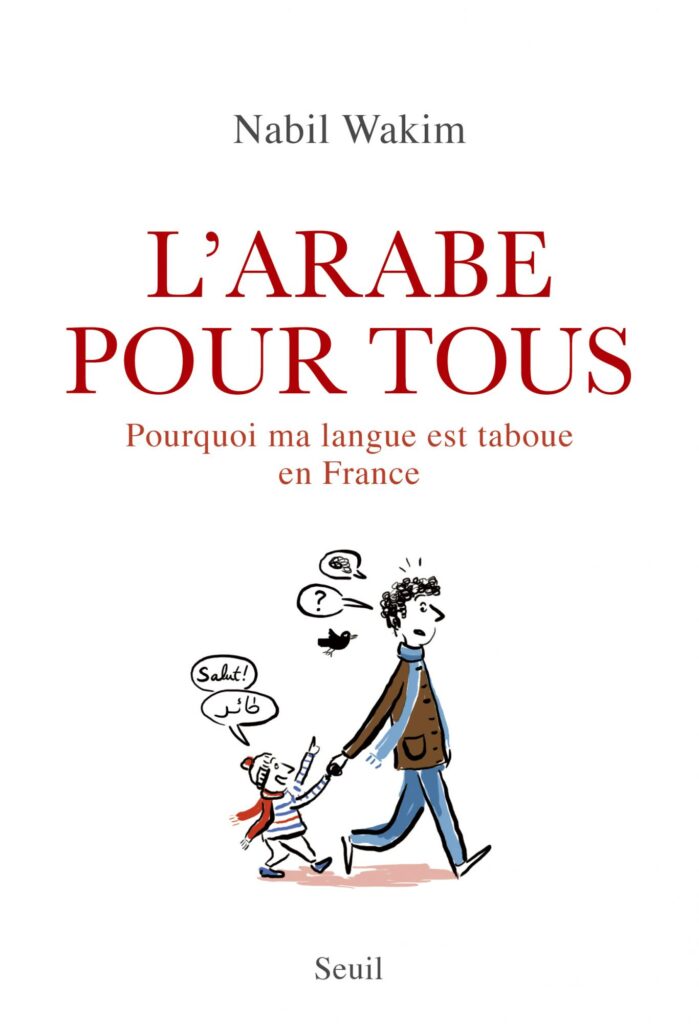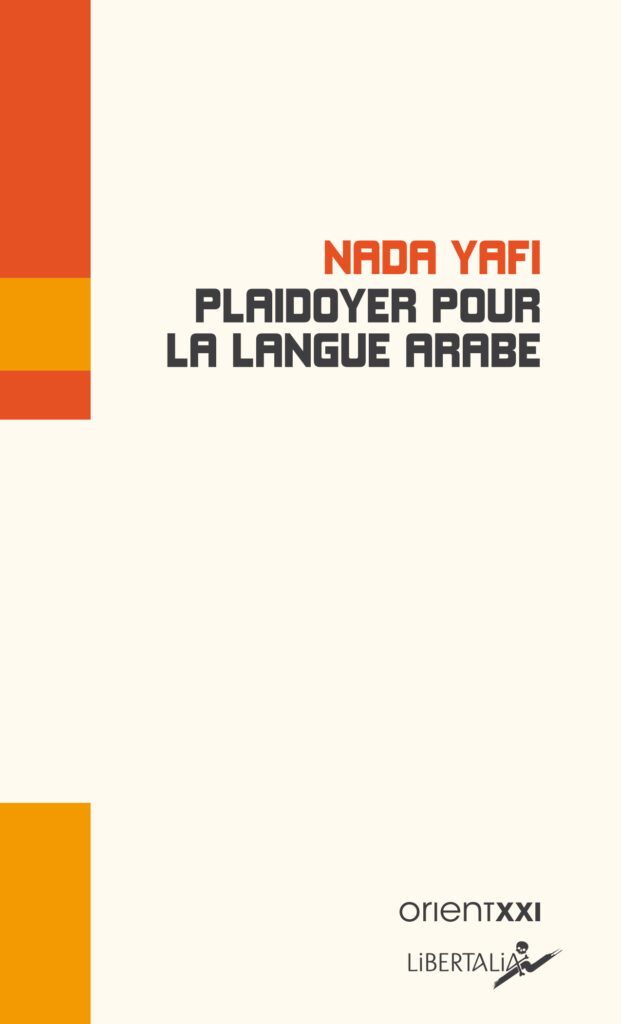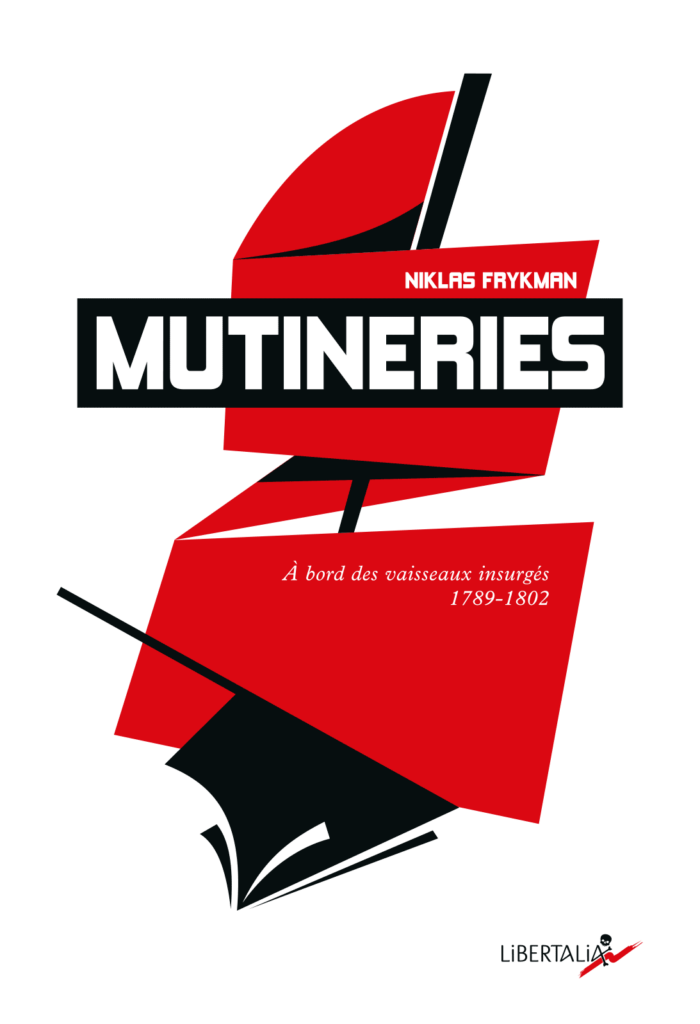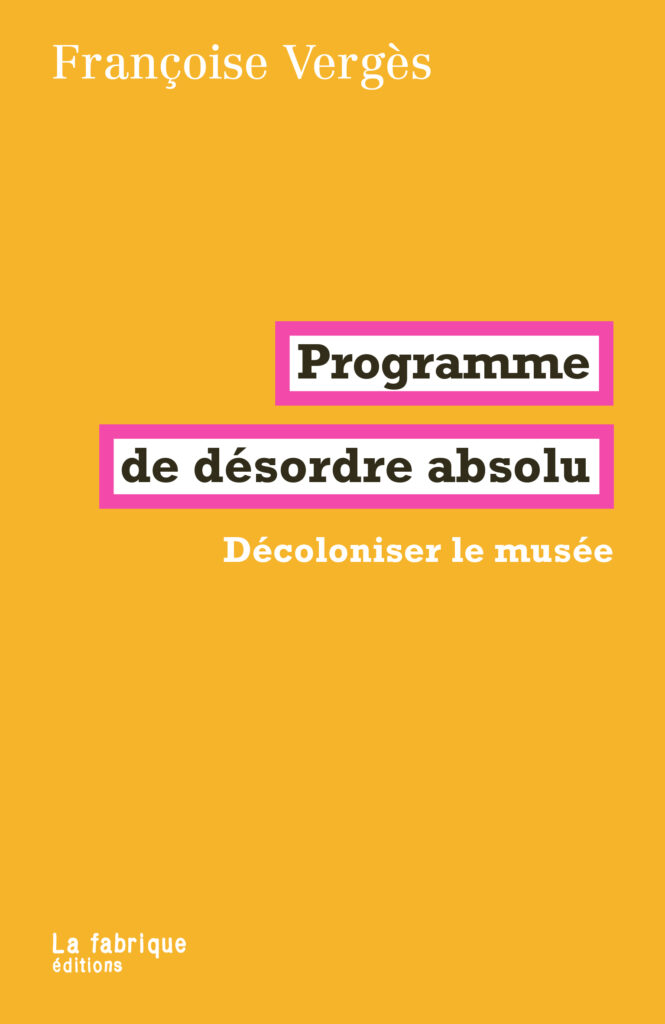 Françoise Vergès, Programme de désordre absolu. Décoloniser le musée, éd. La Fabrique, 2023
Françoise Vergès, Programme de désordre absolu. Décoloniser le musée, éd. La Fabrique, 2023
C’est à une œuvre paradoxale que nous convie Françoise Vergès : en effet, comment « décoloniser » une institution, le musée, qui s’avère, au fil de l’essai, constituer l’un des piliers – et solide ! – de l’ordre colonial ?
Elle-même a essayé. C’était à La Réunion, au début des années 2000. Elle le raconte dans le chapitre « Un musée sans objets ». La Maison des civilisations et de l’unité réunionnaise (MCUR) était un très beau projet, initié grâce à un contexte politique plutôt favorable. Une coalition de forces de gauche étant à la tête de la Région Réunion, celle-ci apporte son soutien qui emporte avec lui celui de l’Europe. Sortir enfin de l’imagerie coloniale et de l’invisibilisation des dominés, en premier lieu des esclaves, promouvoir un récit centré sur l’Océan Indien et non plus sur la seule métropole, se départir du fétichisme des objets et de la culture visuelle, d’autant plus quand on sait qu’objets et images sont ceux et celles des colonisateurs (ceux des colonisés, et a fortiori des esclaves, y compris leurs dépouilles mortelles, ayant tout simplement disparu) et réhabiliter l’art de l’oralité et des contes, critiquer en acte la séparation nature-culture en concevant une architecture ouverte, tels étaient quelques-unes des lignes de force de cette MCUR. Las, une élection, en 2010, qui renversa la majorité à la Région, suffit à l’enterrer… Retour au business as usual, c’est-à-dire, en l’occurrence, au multiculturalisme et à l’antiracisme libéral de l’État français[1].
Fanon avait prévenu : « La décolonisation, qui se propose de changer l’ordre du monde, est, on le voit, un programme de désordre absolu. Mais elle ne peut être le résultat d’une opération magique, d’une secousse naturelle ou d’une entente à l’amiable », écrivait-il en 1961 dans Les Damnés de la terre[2]. Or, et sans vouloir un seul instant dévaloriser cette initiative de la MCUR, il faut bien reconnaître qu’elle relevait un peu des trois (opération magique, secousse naturelle, entente amiable) et qu’une issue favorable n’aurait, comme le relève pertinemment Françoise Vergès, débouché que sur une neutralisation, un « musée du multiculturalisme à la réunionnaise dans le cadre de la célébration de la République française ». Précisément, un des apports de ce livre très instructif (en tout cas de mon point de vue d’ignorant en histoire de l’art) consiste à nous rappeler que c’est cette même République française, dans ses premières versions, si j’ose dire, qui a créé de toutes pièces (volées, pillées, rapportées) le modèle du « musée universel », c’est-à-dire le musée du Louvre, que le monde entier nous envie, paraît-il – enfin, non, pas le monde entier, plutôt Abou Dhabi, où a été inauguré en 2017 le Louvre Abu Dhabi, « le plus grand projet culturel de la France à l’étranger », dixit le site du musée[3].
Françoise Vergès consacre donc un chapitre au musée du Louvre : « Le Louvre, Napoléon, la saisie, l’esclave ». Elle commence par rappeler qu’« il reste le musée le plus visité au monde, un musée de référence abritant des chefs-d’œuvre – dont évidemment La Joconde – et qu’il n’est pas spontanément associé, comme le musée du quai Branly-Jacques Chirac, au vol et au pillage[4]. » En effet, sa création était partie d’une bonne intention – ce genre de bonnes intentions dont on sait que l’enfer est pavé. Il ne s’agissait de rien de moins que de rendre « au peuple » les œuvres d’art jusqu’alors (jusqu’à l’enfumage nommé « abolition des privilèges ») enfermées dans les châteaux et autres demeures princières, à l’abri des regards salissants de la plèbe[5]. Pourquoi pas, après tout, même si cela révélait une absence complète d’esprit critique sur l’art et ses conditions de (re)production et d’exposition[6]. Bref : « Le 10 août 1793, la Convention décide la création d’un “Museum central des arts” où seront mises à disposition du peuple les collections royales, enrichies des biens nationalisés du clergé et des nobles émigrés. » Puis vint Napoléon… Non tutti i francesi sono ladri, ma Buonaparte sì. « Tous les Français ne sont pas des voleurs, mais la plupart, si. » (Jeux de mots sur Buonaparte – une bonne part…) Et en effet, « les saisies des armées révolutionnaires [au cours des guerres européennes] puis celles, massives, ordonnées par Napoléon, se feront au nom du peuple français »… et de la Révolution : « En saisissant des objets d’arts, les armées françaises révolutionnaires les libèrent d’un joug tyrannique. » Écoutez donc ce qu’en dit par exemple le lieutenant de hussards Barbier, chargé de l’opération militaire en Belgique : « Trop longtemps ces chefs d’œuvre avaient été souillés par l’aspect de la servitude. […] Ces ouvrages immortels ne sont plus en terre étrangère ; ils sont aujourd’hui déposés dans la patrie des arts et du génie, dans la patrie de la liberté et de l’égalité sainte, de la République française. » Et aussi Boissy d’Anglas[7] : « Que Paris soit donc la capitale des arts […], l’asile de toutes les connaissances humaines et le dépôt de tous les trésors de l’esprit. […] Il doit être l’école de l’univers, la métropole de la science humaine et exercer sur le reste du monde cet empire irrésistible de l’instruction et du savoir [c’est moi qui souligne]. […] C’est à Paris sans doute qu’il faut établir le dépôt sacré de toutes les connaissances humaines […], qu’il faut rassembler tous les monuments de la science et des arts, dont l’ensemble est si nécessaire à leur perfectionnement et dont l’étude peut seule former le dernier degré de l’instruction publique. » Voilà qui légitime par avance, comme le souligne justement Françoise Vergès, « l’idéologie interventionniste coloniale post-esclavagiste », tout en lui donnant « sa phraséologie : libérer des peuples de la tyrannie en s’appropriant leurs biens pour les rapporter en France, pays de la liberté. Les peuples sont dépouillés au nom du progrès : ils pourront venir admirer leurs trésors dans les musées de la France, qui les garde et les préserve au nom d’un principe plus grand que l’égoïsme d’un seul peuple : le principe de l’universel. » « L’idée que les objets d’art ne peuvent demeurer la propriété des puissants et des tyrans, commente Françoise Vergès, et qu’ils doivent revenir aux peuples, apparaît généreuse. Mais dans les faits, les peuples sont écartés, et seul le peuple français est reconnu dépositaire légitime pour toute l’humanité. Il est conçu comme une entité au-dessus de tous les autres peuples, même si en réalité jamais le peuple ne fut le réel propriétaire de ces objets. » Il en va des œuvres d’art comme de la souveraineté : en théorie, comme le font remarquer Graeber et Sahlins dans Sur les rois[8], la souveraineté est bien passée du roi au peuple au gré des révolutions – mais son exercice effectif demeure quelque peu mystérieux[9]…
Donc, le Louvre devint un modèle pour tous les « grands » pays européens (les « puissances » de l’époque) qui tous, voulurent l’imiter en se dotant de leur musée universel dont le seul critère semble être le nombre et la diversité d’origine géographique des œuvres accumulées, prouvant de visu la supériorité civilisationnelle des États propriétaires… Et bien sûr, ces institutions reçurent en dépôt un très grand nombre d’œuvres et d’objets provenant du pillage colonial – j’ai failli écrire « produits par », et je pense que la formulation serait passable, à condition d’entendre par « production » un processus non pas de création, mais bien de réduction de ces œuvres et objets à des « natures mortes », soit des choses coupées des rapports sociaux et symboliques qui leur avaient donné vie[10]. Pire, depuis la colonisation, « la plupart des grands musées européens conservent des restes humains. Le musée de l’Homme, à lui seul, aurait en sa possession près de 18 000 [!] restes humains provenant du monde entier, dont des crânes de chefs d’Afrique de l’Ouest, de rebelles cambodgiens et d’Amérindiens[11] ». Quant aux esclaves et à la mémoire de l’esclavage, n’en parlons même pas. Françoise Vergès en traite dans une section significativement intitulée : « Le musée (impossible) de l’esclavage ». Cette impossibilité est double. D’une part, Achille Mbembe l’avait expliquée en 2011, lors d’un colloque international, par le fait que, selon lui, « l’esclave ne doit pas rentrer au musée, iel doit rester un·e marron·ne, une fugitive/ un fugitif, la garante/ le garant du combat pour la liberté. S’iel entre au musée, iel perdra l’énergie qu’il lui faut dans sa lutte pour l’abolition totale du racisme et de l’exploitation ». C’était donc le point de vue de l’esclave – ou de ses descendant·e·s en lutte. Et du point de vue du négrier – et de ses descendant·e·s qui profitent aujourd’hui encore de leur position dominante, comment consentiraient-ils à concevoir une réelle exposition, un récit honnête et finalement les réparations dues aux victimes de l’esclavage ? « L’exposition de front de l’origine de l’accumulation du capital et de l’invention de la blanchité ferait toucher du doigt la responsabilité d’institutions et d’organisations ayant pognon[12] sur rue : banques, compagnies d’assurances, sociétés capitalistes. Elle démythifierait l’histoire telle que figurée sur les monuments symboliques de la nation et en rendrait impossible la neutralisation. » Et de donner trois exemples (parmi beaucoup d’autres) de la présence spectrale de l’esclavage et de la traite dans Paris même. Le premier, et pas le moindre, c’est tout simplement le palais de l’Élysée. Hé oui, la résidence du président de la République française fut construite au XVIIe siècle par un certain Antoine Croizat, lequel « bâtit une fortune colossale en devenant le plus important négrier français sous le règne de Louis XIV, qui lui offrit la Louisiane. » Rien que ça ? Non. « La montée sur le trône d’Espagne d’un petit-fils de Louis XIV, en 1700, lui permit d’obtenir l’asiento, c’est-à-dire le monopole de la fourniture en esclaves de l’ensemble des colonies espagnoles, soit 48 000 pièces d’Inde en dix ans. » Je me demande si l’on raconte cela aux visiteurs durant les journées portes ouvertes (« du Patrimoine ») ou les « garden-partys » de l’Élysée. Je parie que non. Autre symbole assez dégueulasse, pardonnez-moi l’expression : la statue de Colbert devant l’Assemblée nationale. Celui dont on a donné le nom au colbertisme, une doctrine économique basée sur (dixit mon dictionnaire) « le développement des manufactures [dont un certain nombre fournissaient, entre autres, les marchandises exportées vers les côtes africaines à destination des partenaires fournisseurs de « bois d’ébène », première étape, donc, du commerce triangulaire] et de la marine marchande [également indispensable à la traite] afin d’accroître la richesse intérieure de l’État au détriment de la concurrence [au détriment des Africain·e·s, oui !] » fut probablement le principal rédacteur du Code noir, ce texte infâme « encadrant » l’esclavage. Déjà, le fondé de pouvoir d’un roi « absolu » devant le bâtiment censé abriter la démocratie représentative, ça la foutait mal. Avec l’esclavage par-dessus le marché, qu’ajouter de plus ? Et pour finir, (grosse) cerise sur le gâteau (capitaliste) : la tour Eiffel ! Cet énorme tas de ferraille qui représente la France aux yeux du monde a été financé par qui ? Et bien, par le Crédit industriel et commercial (en partie au moins). Et ce CIC, d’où tirait-il son argent ? De la dette haïtienne, pardi ! La France des droits de l’homme n’a jamais accepté que d’anciens esclaves (ses « biens meubles », donc) lui retournent ses principes en pleine gueule en créant la première république noire. Saint-Domingue était, et de loin, la plus profitable des colonies sucrières de l’époque. Les héritiers de Crozat et autres Colbert l’avaient mauvaise. Et ils s’arrangèrent (comme d’hab’ avec quelques complicités pourries sur place, mais surtout sous la menace des canonnières) pour se faire indemniser au centuple la perte irréparable de leurs plantations et de la main d’œuvre servile qui allait avec. Résultat : beaucoup, beaucoup, beaucoup, énormément d’argent siphonné sur Haïti, au point que la première République noire ne s’en remit jamais (le racket fut repris quelques décennies plus tard par les États-Unis[13]).
Mais il ne s’agit là que des pointes émergées de l’iceberg… Reconstituer une mémoire de l’esclavage, du point de vue de ses bénéficiaires directs et indirects, ce serait réécrire une bonne partie de l’histoire économique de la métropole. Ainsi, pour ne prendre que cet exemple, combien de petites manufactures textiles, dispersées à travers tout le pays au bord des cours d’eau, et jusqu’au fin fond du Massif central, et dont certaines existent encore et continuent à exporter vers l’Afrique, ont-elles fourni non seulement des voiles aux navires négriers, mais encore des « indiennes », ces cotonnades imprimées qui servaient (entre autres produits) de monnaie d’échange lors des transactions avec les vendeurs d’esclaves sur les côtes africaines[14] ? Et l’on n’évoquera pas ici tous les changements du mode de vie en métropole induits par les capitaux (on en a déjà un peu parlé) et les produits importés lors du retour en France des navires négriers – sucre, café, cacao et autres…
En somme, comme je le disais au début de cette note, « décoloniser » le musée est une entreprise paradoxale. Réfléchir aux enjeux de cette entreprise a cependant donné un livre très intéressant et instructif. Merci à Françoise Vergès et à son éditeur, La Fabrique.
Le 7 mai 2023, franz himmelbauer pour Antiopées.
[1] « La thèse de ce livre, écrit son auteure en introduction, s’inscrit dans le mouvement irrésistible de contestation du musée […] les luttes de Black Lives Matter, celles contre l’occupation de la Palestine, l’islamophobie, les féminicides, la transphobie et contre l’état de guerre permanente nourrissent les débats autour de la représentation. C’est un mouvement qui s’oppose à l’antiracisme libéral et aux politiques gouvernementales de diversité et d’inclusion [autrement dit, le « multiculturalisme »] selon lesquelles l’entrée d’objets et de récits de lutte au musée participe de la pacification. »
[2] Réédité à La Découverte en 2002 avec les préfaces de Jean-Paul Sartre (1961) et Alice Cherki (2002) et une postface de Mohammed Harbi (2002).
[3] Un petit mot supplémentaire à propos de cette grande institution – que je n’ai pas trouvé sur son site mais dans un papier de la Revue du Crieur n°7 (La Découverte/Mediapart, juin 2017) : « De Dubaï au Qatar, la culture asservie », par Antoine Pecqueur et Céline Portes : « Nous sommes en 2002. À ce moment-là, l’argent coule à flots dans les Émirats. Abu Dhabi souhaite officiellement acheter la marque du Louvre. Après des débats tendus en interne, le Louvre accepte de vendre la marque pour un milliard d’euros pendant dix ans […] » Au moment de la rédaction de cet article, c’était l’Agence France-Museums, « créée spécialement pour le Louvre Abu Dhabi, qui [était] l’opérateur du projet. » Son conseil d’administration était présidé par un certain Marc Ladreit de Lacharrière dont j’espère pour vous que vous avez oublié le nom. On en avait un peu parlé à l’époque puisque ce directeur de la Revue des deux mondes avait été impliqué dans l’affaire des emplois fictifs de Pénélope Fillon, qui avait fini par savonner la planche à son candidat de mari tout en ouvrant un boulevard au Macron que vous savez. D’ailleurs, les auteurs de l’article ajoutent que « derrière France-Museums se trou[vait] l’agence de communication Image Sept, dirigée par Anne Méaux, qui [était] la même agence que celle de… François Fillon ». Hum… peut-être pas le top en termes de com’, si l’on en juge par le résultat.
[4] Perso, j’ai visité une fois ce musée (du quai Branly). Une fois de trop. Je me suis senti vraiment mal, comme la personne qui m’accompagnait, devant ces vitrines présentant des objets, des coiffures, des costumes d’Amérindiens ramenés par tel scientifique et/ou tel galonné et généreusement « offerts » à la collectivité. Berk. Un peu la même nausée que j’avais éprouvée lors de mes rares voyages en Afrique subsaharienne, en tant que Blanc.
[5] D’ailleurs, aujourd’hui, on assiste aussi à quelque chose du même genre. Ainsi Antoine Pecqueur décrivait-il, dans un papier sur le marché de l’art (Le Crieur n°15, février 2020), les bunkers de stockage d’œuvres d’art qui se créent à proximité d’aéroports, tel celui du Bourget (en construction au moment de la rédaction de l’article, ce « centre de conservation » doit aujourd’hui couvrir 25 000 m2 !), et où des milliardaires entreposent leurs biens jusqu’à ce qu’ils changent éventuellement de mains, en toute discrétion. Il semble que cela facilite les échanges et aussi, j’imagine l’optimisation fiscale, puisque ces installations jouissent de statuts de « ports francs ». L’installation équivalente de Genève compte paraît-il environ un million d’œuvres d’art…
[6] En vérité, je simplifie un peu trop. Louis XVI, déjà, avait chargé le comte d’Angiviller de rassembler dans la Grande Galerie du Louvre les œuvres acquises par les souverains. Mais on était encore loin du « musée universel ».
[7] Surnommé « Boissy famine » dans les quartiers populaires de Paris, il fut l’un des liquidateurs thermidoriens de la Révolution. Voir « Aux origines de la république macronienne » sur Antiopées.
[8] https://antiopees.noblogs.org/post/2023/04/17/sur-les-rois-de-david-graeber-marshall-sahlins/
[9] Enfin, de moins en moins mystérieux au fur et à mesure de la montée des tensions entre opposants à la politique gouvernementale et pouvoir exécutif – ainsi que l’on peut le constater lors de la répression toujours plus brutale exercée par les détenteurs de la « violence légitime » depuis quelques années lors des mouvements sociaux (loi Travail, Gilets jaunes, retraites…) et écolos (Sivens, Sainte-Soline…).
[10] Ce qui me fait penser à la manière, décrite par Nastassja Martin dans À l’Est des rêves, dont l’URSS « préservait » et exposait la diversité culturelle des peuples qui la composaient : « Les traditions culturelles d[evai]ent être habilement triées : celles qu’il [était] possible de désolidariser de la praxis pour devenir exclusivement formelles [étaient] conservées, tandis que celles considérées comme trop “religieuses” et/ou relevant de modes d’organisation concrets des rapports au monde, d[evai]ent être éliminées. Une “bonne” tradition dev[enai]t une tradition potentiellement purifiable d’un contenu de pratiques incarnées produisant des effets concrets sur les êtres concrets peuplant un milieu particulier. » Ainsi l’État soviétique encourageait-il les manifestations folkloriques – ensembles de chants et danses, toujours richement costumés – des tous les peuples de l’empire, et l’on ne comptait pas les festivals, concours, etc. organisés partout afin de représenter la diversité culturelle du socialisme réel, ceci alors que les bases de la vie quotidienne (les « infrastructures ») avaient été uniformisées – et que l’on trouvait les mêmes sovkhoses et kolkhoses de la Baltique jusqu’à Sakhaline…
[11] « La collecte des restes humains, ajoute Françoise Vergès, met au jour une violence systémique dont les excès sont parfois difficiles à croire et où le déchaînement de la brutalité coloniale est crûment révélé. En 1906, à la suite du génocide des Héréro en Namibie par les armées allemandes, l’anthropologue autrichien Felix von Luschan exprime le désir d’acquérir des restes humains héréros pour les envoyer à Berlin afin de les étudier. Des femmes héréros, emprisonnées dans des camps de concentration, sont alors forcées de gratter la chair des cadavres de leurs proches avec des éclats de verre pour fournir à Luschan ce qu’il désire. » Voici qui préfigure les sinistres expériences nazies dans les camps de la Seconde Guerre mondiale, établissant un lien direct entre colonisation et nazisme, lien que Sven Lindqvist, entre autres auteurs, avait déjà bien mis en évidence dans son ouvrage Exterminez toutes ces brutes (rééd. française Les Arènes, 2014).
[12] Oups, c’est pignon, bien sûr. Je ne l’ai pas fait exprès – mais je le garde, c’est trognon !
[13] On peut consulter à ce propos le webdoc sorti par le New York Times (en français) ou, si l’on préfère le papier : Haïti-France. Les chaînes de la dette. Le rapport Mackau (1825). Édition intégrale annotée et commentée par Marcel Dorigny, Jean Marie Théodat, Gusti-Klara Gaillard et Jean-Claude Bruffaerts. Préface de Thomas Piketty. Introduction de Fritz Alphonse Jean. Éditions Maisonneuve & Larose et Hémisphères, 2021.
[14] Autre exemple : l’exploitation des forêts qui servit à la construction des navires. Je suis tombé récemment sur le beau travail de Salomé Aurat, qui évoque les chênes abattus en forêt de Tronçais à cette fin : « La Forêt qui cachait les arbres », in Wild Rumors. Moby Dick, Détroit et autres récits, Antoine Barrot, Cédric Loire et Sarah Ritter (dir.), éditions Loco/ École supérieure d’Art de Clermont Métropole, 2023.