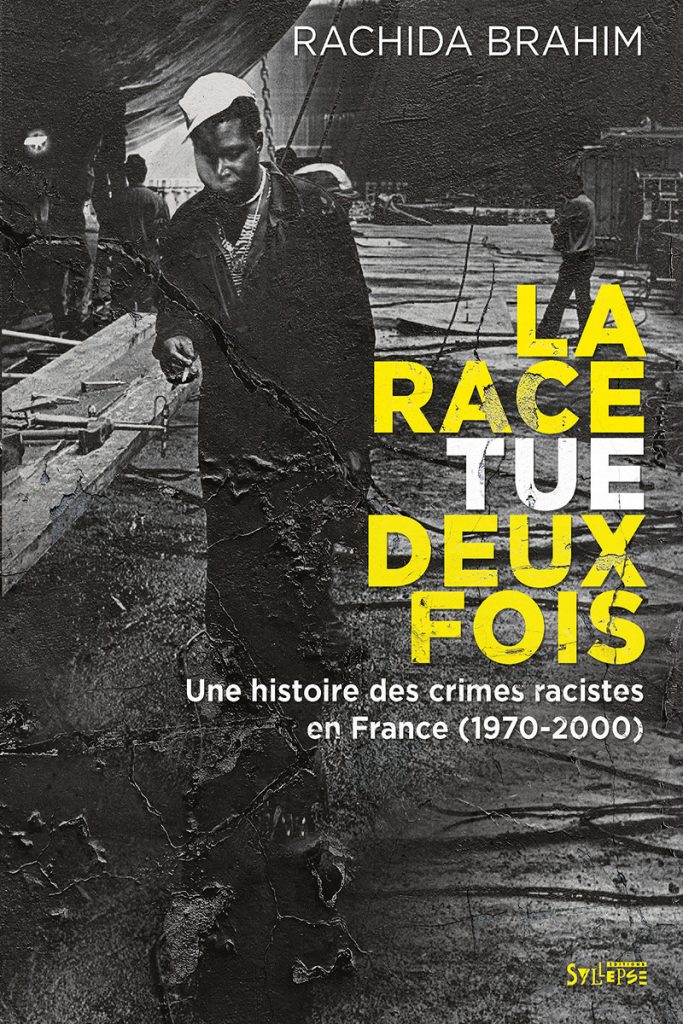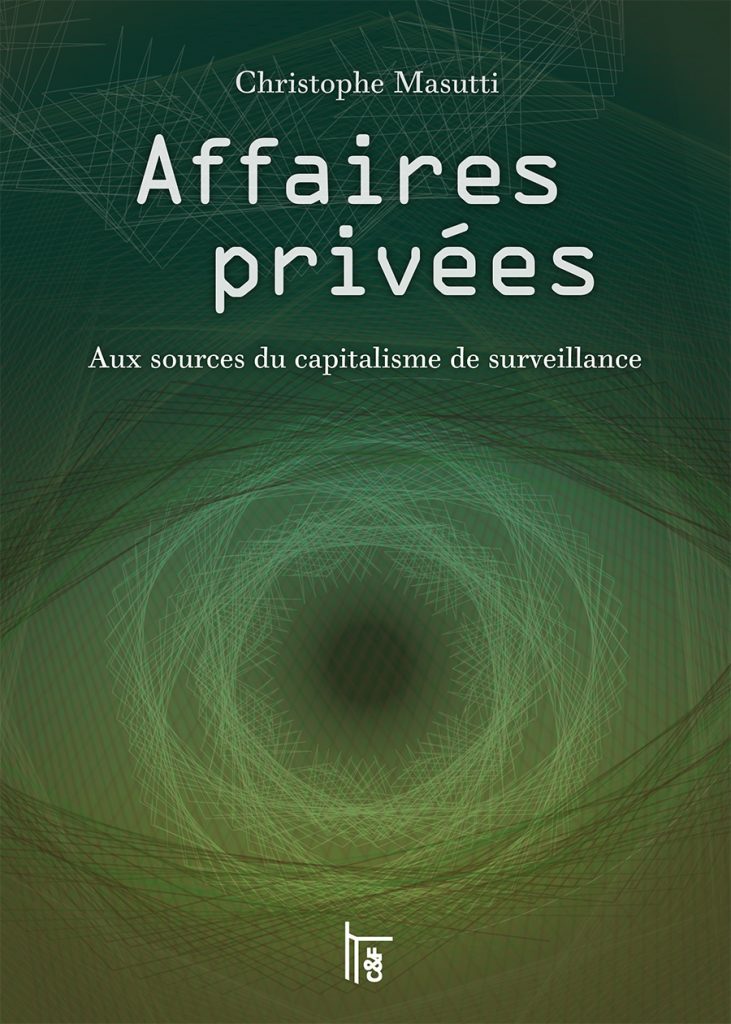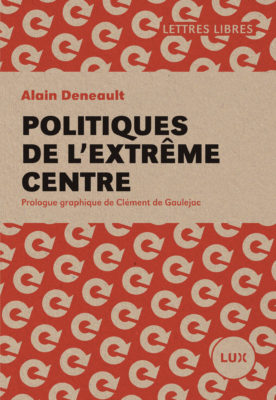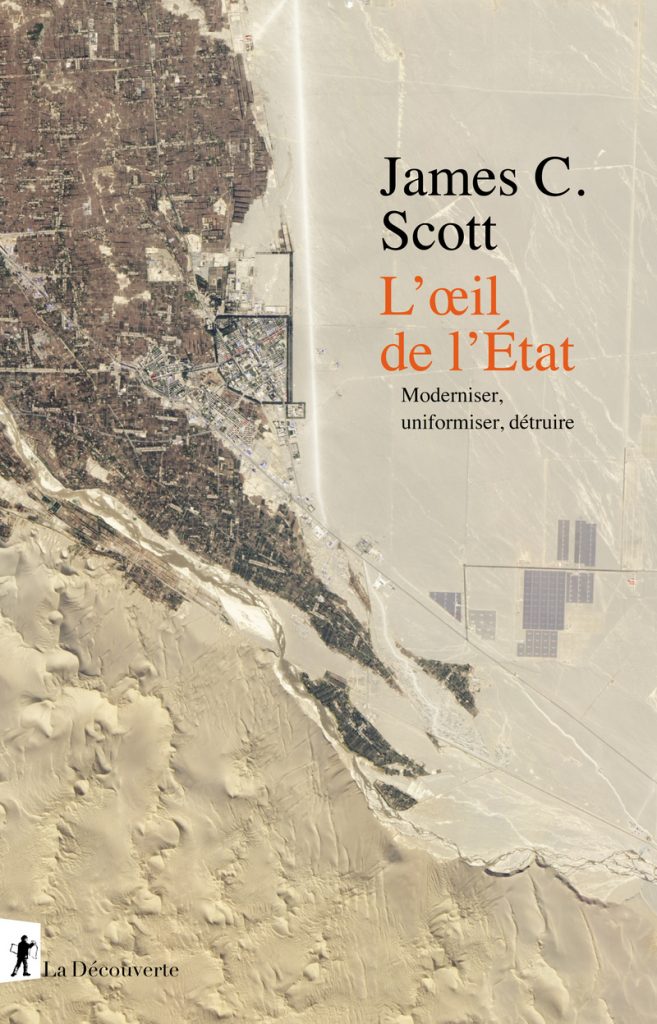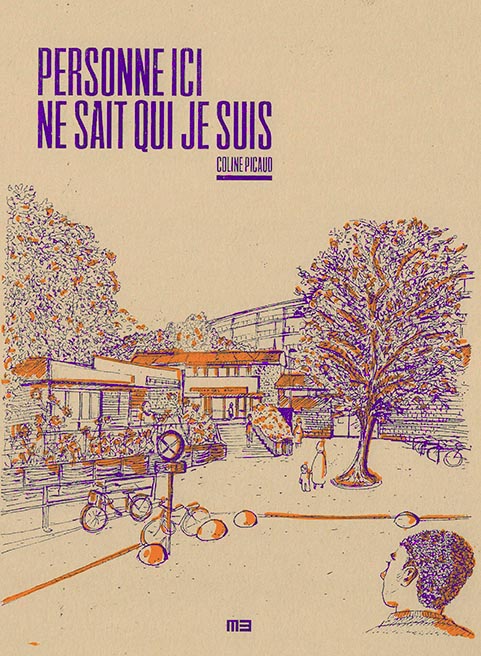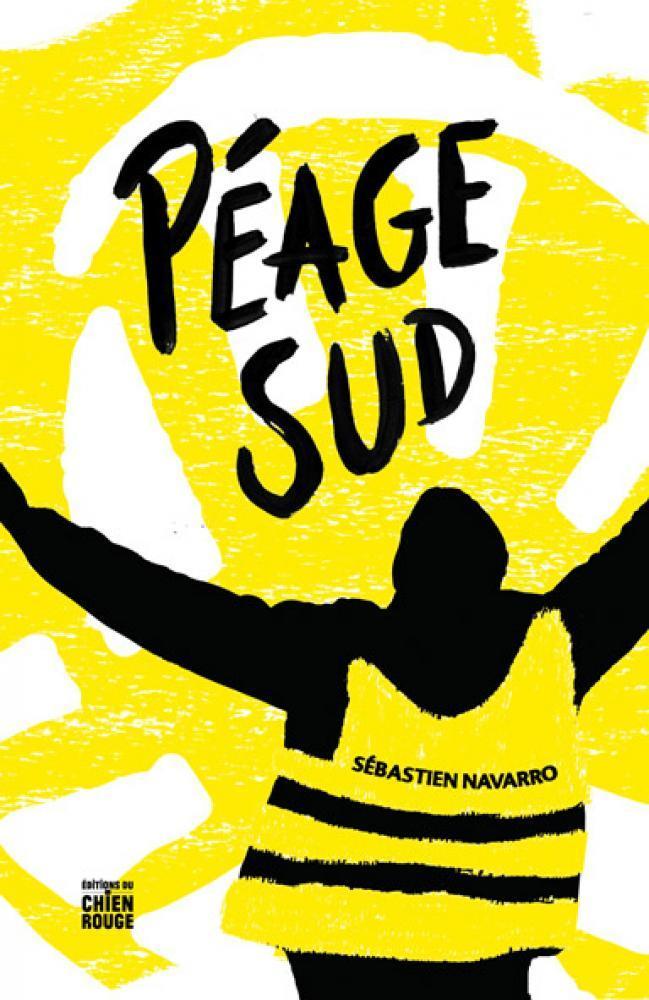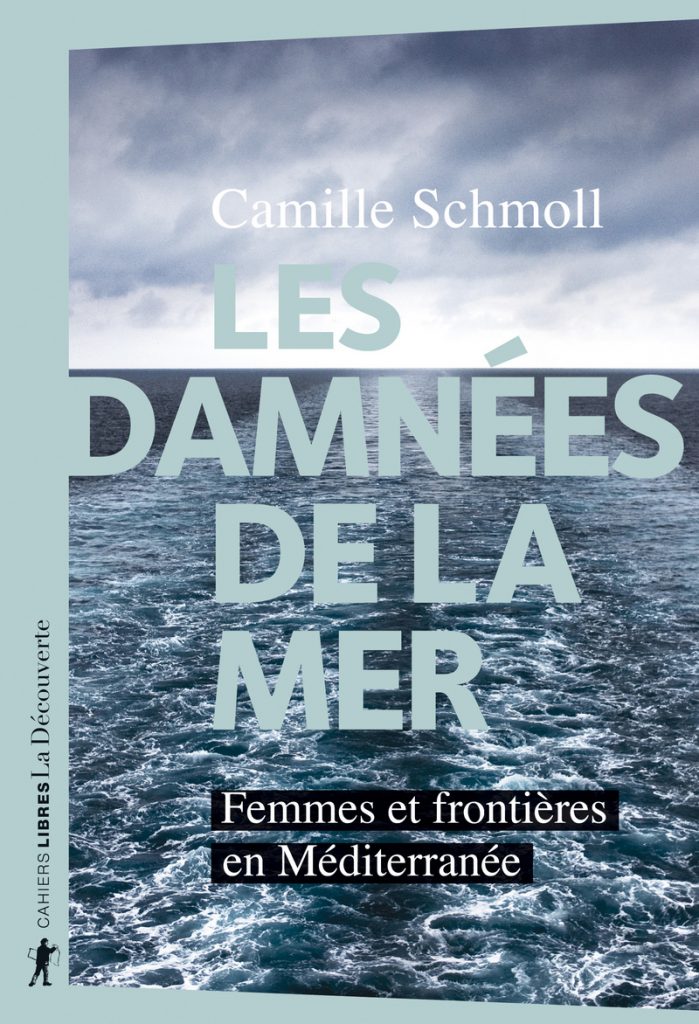Jean-Paul Gaudillère, Caroline Izambert et Pierre-André Juven, Pandémopolitique. Réinventer la santé en commun, Paris, éditions La Découverte, 2021.
Jean-Paul Gaudillère, Caroline Izambert et Pierre-André Juven, Pandémopolitique. Réinventer la santé en commun, Paris, éditions La Découverte, 2021.
À vrai dire, et comme souvent, le titre est un peu trompeur. Du moins le sous-titre : Réinventer la santé en commun, car seule la troisième partie du livre est consacrée à cette belle intention – ceci dit sans ironie aucune : je parle d’intention car après la lecture des deux premières parties, j’ai l’impression que cette réinvention tient plus du programme utopique que d’autre chose, et cela même si les trois auteur·e·s ont répertorié des initiatives qui nous font penser que l’utopie n’est pas forcément vouée à le rester…
Tout le livre est axé autour de la notion de « triage ». Depuis que l’épidémie de Covid-19 a atteint un point critique – en France, au printemps 2020 –, il a été beaucoup question du traumatisme que représentait pour les personnels soignants et les populations concernées la nécessité de devoir procéder à un « tri » parmi les malades, en privilégiant l’accès aux services de réanimation à celles et ceux qui avaient plus de chances de survie que d’autres. Dit comme cela, cela paraît horrible, à la limite de la barbarie. Et c’est probablement horrible et barbare. Cependant, l’affaire est moins simple que ce que les médias ont complaisamment répercuté. En effet, le « triage » des patients est caractéristique de la médecine de guerre[1]. Dans ces cas-là, on assiste à une production industrielle d’atteintes graves à l’intégrité des personnes, qui dépasse tous les moyens de soins mis en place en période « normale ». Mais en mars 2020, nous n’étions pas en guerre, que je sache. Ou du moins pas dans une guerre conventionnelle, avec armées qui s’affrontent sur le champ de bataille. La guerre sociale poursuivait son cours[2], évidemment, et avec elle le business as usual. Face à pareille énigme (comment un virus ni plus ni moins « virulent » qu’un autre a-t-il pu déborder à ce point les capacités de soins d’un pays qui s’enorgueillissait d’un système de santé parmi les plus performants au monde, oui monsieur), et puisque nous parlons de la guerre et de son cortège de traumatismes, il me semble important de rappeler la sagesse de Bertold Brecht : « On dit d’un fleuve emportant tout sur son passage qu’il est violent, mais on ne dit jamais rien de la violence des rives qui l’enserrent. » C’est de la violence des rives que parlent les deux premières parties de ce livre.
Les auteur·e·s commencent par un rappel assez rapide des débuts de la dite « crise sanitaire » – le premier chapitre s’intitule ainsi « Masques, tests et pénuries ». Ensuite, ils et elle expliquent que le triage n’a pas commencé avec l’apparition du Covid. Il y avait déjà un certain temps que s’effectuait un triage « économique » de facto des patients, à partir, d’une part, de conditions de rareté budgétaires et d’autre part, de critères « d’efficience » – nombres d’actes réalisés, actes plus ou moins « rentables », durées de séjours les plus courtes possibles, etc. Souvenez-vous des mobilisations des personnels hospitaliers durant l’année 2019, avec cette banderolle en particulier : « L’État compte ses sous, on va compter les morts ! »
Et puis il y a un autre mode de triage, en amont de l’hôpital et même de l’ensemble du réseau de soins. Le chapitre 3 est intitulé « La conjuration des inégaux » et sa première section : « Territoire, Covid-19 et inégalités de santé : emblématique Seine-Saint-Denis ». Je ne reprendrai pas ici la litanie des statistiques de la pauvreté, de la précarité et des discriminations qui caractérisent ce département, ni celles qui le placent en tête, et largement, de la surmortalité due au Covid-19. Juste un constat, plus général celui-là, rapporté d’après l’Insee : « l’écart entre l’espérance de vie des cadres et celle des ouvriers est de 6,4 ans pour les hommes et 3,2 ans pour les femmes[3] ». La section suivante est intitulée « Covid-19, race et inégalités ». Elle est d’actualité, au moment où certains chercheurs (Beaud et Noiriel, pour ne pas les nommer) demandent que l’on arrête de mettre en avant le phénomène racial au risque d’y dissoudre les classes sociales (et leur lutte). Ici, nos auteur·e·s déplorent le fait que l’on ne puisse pas faire de statistiques ethniques, ou raciales, en France, car cela aurait probablement permis de mettre en évidence un taux de prévalence de la Covid plus important chez les minorités racisées. Ils et elle s’appuient donc sur les études qui ont été menées dans ce domaine aux États-Unis, et qui montrent que les minorités, noire avant tout, sont de loin plus touchées que les autres. Rien de génétique ni de bien mystérieux ici : ces minorités cumulent les facteurs aggravant les risques de contamination et de formes graves – car leurs membres ont dû continuer à travailler, et pas en télétravail, pendant l’épidémie et, par ailleurs, les taux de maladies style diabète, affections cardiovasculaires, obésité y sont plus importants que dans la population blanche (malbouffe, exposition aux pollutions, etc.), sans parler de la surface moyenne des logements plus petite conjuguée à un taux d’occupation plus grand[4].
Et puis il y a encore le triage du genre. Qui est-ce qui se tape le plus gros du travail du soin – et aussi le plus risqué concernant une maladie contagieuse, puisque ce travail implique des contacts rapprochés et répétés avec les patients ? Ben tiens, les femmes, encore, les femmes toujours. Pendant que de distingués épidémiologistes, chefs de services et autres virologues patentés pérorent sur les plateaux télés, qui s’occupe des malades à l’hôpital, des personnes âgées (souvent elles aussi malades) dans les maisons de retraite et de celles qui sont encore « à domicile », comme on dit ? Ok, il y a bien deux trois femmes parmi les « experts », mais elles ne sont pas majoritaires, loin de là. Et d’ailleurs, celles que les médias s’efforcent de convoquer plus souvent désormais (la parité, coco, la parité !) ne sont pas les petites mains…
Dans la deuxième partie du livre, il est question des « habits neufs du triage systémique ». On y parle de globalisation, de new public management, de partenariats publics-privés, de Big Pharma (là, c’est moi qui résume, je ne crois pas que ce terme soit utilisé), de brevets et de propriété « intellectuelle » (guillemets, je ne vois pas ce qu’il y a d’intellectuel là-dedans) sur le vivant… J’en retiens que les méchants ont gagné : une conception de la médecine comme science – la biomédecine, centrée sur un individu moyen, chair à statistiques et susceptible de télédiagnostics assistés par ordinateur, et qui entre des données d’un côté et vous sort de l’autre une ordonnance longue comme un jour sans pain de médicaments qui, au mieux, ne vous feront pas de mal, au pire vous empoisonneront (je ne déconne pas : voyez l’industrie du cholestérol et des statines[5]). Il n’est peut-être pas nécessaire de revenir ici sur l’affaire du Remdesivir dont le prix par traitement individuel s’élève aux États-Unis à 3120 dollars pour les hôpitaux et à 2340 pour les patient·e·s bénéficiant d’une assurance privée. Il s’est avéré inefficace, voire nuisible, selon un avis rendu par l’OMS en novembre dernier. Trop tard : la Commission européenne en avait déjà commandé (en octobre) pour 1,2 milliards de dollars. Oups ! Chéri, tu t’es gouré de marque de pâtes, tu veux pas aller en chercher d’autres ? Bah, celles-là, on les gardera, pour le prix que ça coûte[6]…
Quand je dis que les méchants ont gagné, ça pourrait sous-entendre qu’il y a eu, ou qu’il y a encore des gentils. Bon, je ne sais pas jusqu’à quel point, mais ce qui est sûr, c’est qu’il y a eu pendant un certain temps une vague de « tiers-mondisme » et de non-alignement dans les grandes agences de l’ONU, telle l’OMS. À ce moment-là, on a mis l’accent sur des programmes dont l’un des plus célèbres fut celui des « médecins aux pieds nus » chinois (jusqu’à quel point il s’agissait de réalité ou de propagande, je ne sais pas), et qui se consacraient en priorité aux « soins de santé primaire ». Mais cette époque est révolue. Comme Ivan Illich l’avait déjà bien souligné, la némésis médicale[7] est en fin de compte (c’est le cas de le dire !) plus intéressée à la production industrielle de la maladie qu’à prendre soin des personnes, des communautés et de leurs environnements sociaux et écologiques.
Mais trêve de jérémiades. La troisième partie du livre[8], je l’ai dit, engage à un peu plus d’optimisme car elle traite d’approches et de pratiques « dissidentes » en santé. Cette partie revient sur la question des « communs » (en santé). Une brève présentation explique la notion de communs, son rapport avec une politique des besoins (et non de l’offre consumériste) et donc avec la question de la définition de ces besoins par… des communes, des communautés ? Je ne m’étendrai pas ici sur le distinguo, ce n’est pas le lieu ni peut-être de ma compétence. Cela dit, l’idée est que le soin ne se limite pas au réglage du métabolisme individuel, comme le prétend la biomédecine, mais qu’il prend en compte les rapports de cet individu avec les autres et avec ce tout ce qui constitue son monde. Il faut peut-être même soigner (ou prendre soin) le commun avant l’individu (mais peut-être que j’extrapole un peu trop).
J’ai sauté un peu rapidement la question des médicaments communs, contre les médicaments « propriétaires » tel le Remdesivir dont j’ai parlé plus haut. On lira avec intérêt le développement que leur consacrent les auteur·e·s. Vu la puissance accumulée par Big Pharma, ce n’est pas une petite bagarre que de réussir à obtenir la production de médicaments génériques à bon marché accessibles à toutes et tous à travers le monde.
J’ai beaucoup aimé le chapitre sur la « santé communautaire ». Apès avoir évoqué les féministes du MLAC dans les années 1970, qui pratiquaient avortements et accouchements hors toute institution médicale, on y revient sur l’expérience oubliée des centres de santé et des petits déjeuners offerts aux enfants des ghettos par les Black Panthers. Ce chapitre parle aussi des Young Lords, ces « Black Panthers latinos », qui engagèrent également toute une série d’actions, y compris l’occupation et l’autogestion d’un hôpital, au service de la santé de leur communauté[9]. Sont évoqués ensuite les initiatives menées par des associations dans les années 1980, en France, de prévention des risques liés à l’usage de drogues en temps de Sida. Et enfin, dans les années 2000, la création de plusieurs centres de santé communautaire tels le Château en santé à Marseille, La Place santé à Saint-Denis, La Case de santé à Toulouse ou le Village 2 santé à Échirolles.
Il semble qu’une des résolutions issues du « Ségur de la santé », l’une des sauteries participatives mises en place par le gouvernement Philippe au printemps 2020 (suite aux mobilisations des soignants en 2019), s’inspire de ces centres en proposant la création d’une soixantaine de centre « participatifs » en France. À suivre (on a le droit d’être sceptique).
Les auteur·e·s soulignent à juste titre que la santé communautaire s’oppose à la « démocratie sanitaire » promue depuis quelques années par les institutions sanitaires et qui regroupent personnels soignants, représentants des institutions et des patients. Celles et ceux qui ont déjà participé à des comités d’usagers à l’hôpital savent ce que vaut cette démocratie « représentative » : pas grand-chose. Cela est d’ailleurs apparu de manière encore plus flagrante depuis l’irruption du Covid qui, sous prétexte d’urgence (et de risque contagieux, la belle affaire !), a évacué tout semblant de concertation.
Bref, j’ai essayé de donner une idée du contenu de ce livre qui fourmille d’informations intéressantes et ne peut que nourrir la réflexion sur ce sujet qui nous concerne tous, la santé. J’avoue que les deux premières parties critiques mériteraient selon moi un ton un peu plus acerbe. Je dois être un peu old school : je regrette le temps des pamphlétaires et j’ai un peu de mal avec les textes trop policés à mon goût. Mais bon, c’est une préférence personnelle, hein, et ça n’enlève rien à ce livre dont, vous l’aurez compris, je recommande la lecture.
[1] Je ne crois pas pour autant que cela autorisait le président Macron à marteler son « nous sommes en guerre » lors de son adresse « à la nation » du 17 mars 2020, six jours seulement après avoir fièrement déclaré (le 11 mars), à propos du même sujet : « Nous ne renoncerons à rien. Surtout pas à rire, à chanter, à penser, à aimer. Surtout pas aux terrasses, aux salles de concert, aux fêtes de soir d’été. » Etc.
[2] Heu… je vais un peu vite. Je devrais ajouter la guerre « antiterroriste » que la France mène en Afrique, au Sahel en particulier, même si ce n’est pas non plus une guerre conventionnelle, à moins qu’il ne soit désormais considéré « conventionnel » le fait de bombarder des civils réunis pour une noce, comme cela s’est encore produit récemment.
[3] Ici, je ne peux pas m’empêcher de ressortir une vieille note toute poussiéreuse de mon bêtisier (j’avais relevé cette perle de Jean-Marc Ayrault prononcée sur le plateau du JT de France 2 le 11 juin 2003. Il était alors président du groupe PS à l’Assemblée nationale et répondait à une question sur la réforme des retraites (hé oui, déjà !) : « Puisqu’un ouvrier a six ou sept ans d’espérance de vie de moins qu’un cadre, il faut adapter le nombre d’années travaillées aux situations… » (C’est moi qui soulignais. Le présentateur du JT n’avait pas relevé, bien sûr.)
[4] Je me refuse à employer le terme de « promiscuité » qui me semble faire partie de l’arsenal sémantique employé par les riches dans leur éternelle guerre contre les pauvres.
[5] Voici quelques années, une toubib que j’aime bien par ailleurs s’est inquiétée de mon taux de cholestérol. Elle m’a prescrit des statines. Quand j’ai lu la notice du médoc, et ses contre-indications, j’ai refusé de le prendre, puis j’ai commencé à me documenter un peu sur cette histoire de cholestérol. J’ai trouvé les ouvrages de Michel de Lorgeril, que je recommande à toute personne qui s’interroge à ce sujet : lisez-les avant de vous laisser intoxiquer…
[6] Le Remdesivir n’est pas la première arnaque de Big Pharma, hein : voyez par exemple l’histoire édifiante du Tamiflu, qui devait nous sauver de je ne sais plus quelle épidémie de grippe. Le labo qui le produisait a gagné beaucoup, beaucoup, vraiment beaucoup d’argent avec, avant que l’on s’aperçoive qu’ils avaient bidonné les études sur son efficacité. On trouve cette histoire un peu partout, par exemple ici.
[7] Ivan Illich, Nemesis médicale. L’expropriation de la santé, Paris, Seuil 1981 [1975]. Et cette actualisation (encore plus radicale) en 1999 : « L’obsession de la santé parfaite », https://www.monde-diplomatique.fr/1999/03/ILLICH/2855
[8] Dont je n’aime pas du tout le titre : « Un autre triage est possible ». Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas, probablement que ça me rappelle des slogans assez vains.
[9] À ce propos, lire l’excellent Young Lords. Histoire des Blacks Panthers latinos (1969-1976) de Claire Richard, Paris, L’Échappée, 2017, auquel j’ai consacré une note de lecture ici-même.