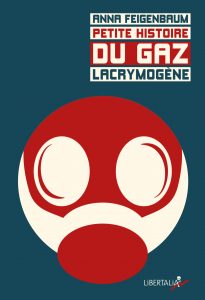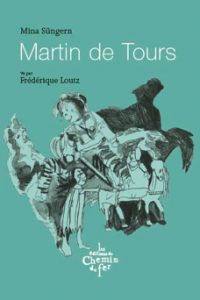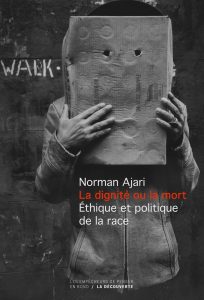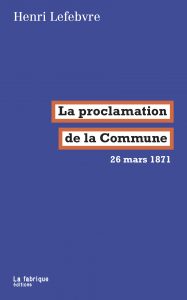De Wendy Brown, j’ai déjà donné ici une recension de Murs. Les murs de séparation et le déclin de la souveraineté étatique[1]. On peut désormais lire aussi en français Défaire le dèmos. Le néolibéralisme, une révolution furtive[2].
De Wendy Brown, j’ai déjà donné ici une recension de Murs. Les murs de séparation et le déclin de la souveraineté étatique[1]. On peut désormais lire aussi en français Défaire le dèmos. Le néolibéralisme, une révolution furtive[2].
L’adjectif interroge : pourquoi « furtive » ? Il nous semble pourtant avoir beaucoup entendu parler du néolibéralisme durant ces dernières années… Ce n’est pas un phénomène caché, inconnu, loin de là. Si l’on se contente d’une approche superficielle, on pourrait même le qualifier d’« ostensible, public, ouvert, franc », soit les contraires de « furtif » que me propose mon dictionnaire. Cependant Wendy Brown va plus loin : « Intensification des inégalités, marchandisation et commercialisation éhontées, influence toujours croissante des entreprises sur la conduite de l’État, instabilité et conséquences économiques dévastatrices : il s’agit là assurément des effets de la politique néolibérale […] Néanmoins, ce livre propose une conceptualisation quelque peu différente du néolibéralisme et s’attache à décrire certains autres de ses effets délétères. » C’est ici que nous arrivons au côté « furtif » de la révolution néolibérale. En effet, « plutôt que d’interpréter le néolibéralisme comme un ensemble de politiques étatiques, comme une phase du développement du capitalisme ou comme une idéologie qui débride le marché pour restaurer les profits d’une classe capitaliste, [Wendy Brown] le considère, avec Michel Foucault et quelques autres auteurs, comme un ordre de la raison normative qui, lorsqu’il devient prépondérant, prend la forme d’une rationalité gouvernementale étendant à toute les dimensions de la vie humaine une combinaison spécifique de valeurs, de pratiques et de critères économiques » (c’est moi qui souligne). Comme l’ont dit d’autres auteurs, on peut parler d’une « économisation de sphères et de pratiques jusque-là non-économiques ». Cela ne se « voit » pas forcément – même si l’on en subit les effets –, car « cette économisation n’implique peut-être pas toujours que les pratiques considérées soit monétarisées. » Par contre, « dans la façon dont nous envisageons, par exemple, notre éducation, notre santé, notre forme physique, notre vie de famille ou notre voisinage, nous pouvons penser et agir comme des sujets du marché contemporain […] » (c’est encore moi qui souligne). « L’idée est [donc] que la rationalité néolibérale dissémine le modèle du marché dans tous les domaines et activités – même là où il n’est pas question d’argent – et qu’elle configure toujours, intégralement et exclusivement les êtres humains comme des acteurs intervenant sur un marché, comme homines œconomici. »
Relisant les cours consacrés au néolibéralisme de Michel Foucault au Collège de France[3], Wendy Brown pointe deux lacunes d’une analyse dont elle ne nie par ailleurs en aucun cas la pertinence, et sur laquelle, on l’a vu, elle s’appuie pour avancer dans son propre travail. Tout d’abord, l’homo œconomicus de Foucault ressemble par trop, selon elle, à celui des premiers économistes politiques. « C’est là, écrit Brown, l’une des failles majeures de la narration foucaldienne : faire de l’intérêt la pulsion essentielle et transhistorique de ce personnage revient à escamoter ce qu’implique la transition d’une formation libérale classique à une formation néolibérale, d’Adam Smith et Jeremy Bentham à Gary Becker. » Pour résumer, quitte à forcer un peu le trait, on peut avancer qu’aujourd’hui, l’homo œconomicus n’est plus un sujet guidé par son intérêt, mais un capital humain dont la raison d’être est de s’apprécier sur un marché.
Deuxième lacune, « Foucault omet de signaler la façon particulière dont [homo œconomicus] a éclipsé homo politicus à l’époque contemporaine. » Selon lui, en effet, les deux coexistent, en quelque sorte, tandis que selon Wendy Brown, le premier est en train de liquider le second et, avec lui, « tout ce que la démocratie peut signifier [soit] l’égalité et la liberté politiques, la représentation, la souveraineté populaire, la délibération et le jugement en matière de bien public et de commun ». Cette tendance antidémocratique n’est certes pas nouvelle – j’en parlais ici il y a peu en rendant compte d’un livre sur le Directoire qui relate par le menu comment les thermidoriens, après cinq ans de révolution, s’appliquèrent à débarrasser la république de ce qu’ils nommaient le « peuple délibérant ». Wendy Brown n’entretient certes aucune illusion sur l’application effective des principes que l’on vient d’évoquer dans les démocraties contemporaines, mais elle montre que ce qui est en train d’advenir avec la « rationalité néolibérale » risque d’en effacer jusqu’au souvenir. C’est cela-même qui est nouveau dans le néolibéralisme : la dissémination de sa « rationalité politique » dans tous les domaines de la vie humaine, depuis la politique jusqu’aux affects en passant par tous les recoins du social.
Ainsi, d’abord, en est-il de la « gouvernance » : elle « désigne un mode spécifique de gouvernement d’où les agents ont été évacués et qui a été institutionnalisé dans des processus, des normes et des pratiques. » Elle « redéfinit le politique comme un champ à gérer ou à administrer », remplaçant « la délibération concernant la justice et autres biens communs, la polémique quant aux valeurs et aux visées, les luttes pour le pouvoir, la recherche d’une certaine conception du bien commun » par « la résolution de problèmes et […] la mise en application de programmes. […] Et lorsque ce rétrécissement de la vie publique se combine avec une valorisation du consensus, l’hostilité à toute politique devient palpable. » D’autre part, tout en évacuant le langage du pouvoir et avec lui la visibilité de ce dernier, « la gouvernance néolibérale contemporaine opère à travers l’isolement et “l’entrepreneurialisation” d’unités et d’individus responsables, à travers la délégation de l’autorité et de la prise de décision ainsi que de la mise en œuvre des politiques et normes de conduite. Ces processus aboutissent à rendre responsables d’eux-mêmes les individus et les autres petites unités sur le lieu de travail, tout en les rattachant à des pouvoirs et à un projet d’ensemble. Combinant l’inclusion et l’individualisation, et instaurant une coopération sans collectivisation, la gouvernance néolibérale est un exemple parfait d’“omnes et singulatim”, cette conjonction du rassemblement et de la séparation, du regroupement et de l’isolement en quoi Foucault voyait la marque de la gouvernementalité moderne. »
La gouvernance néolibérale opère par délégation et responsabilisation : ainsi de plus en plus de tâches sont-elles déléguées – l’exemple emblématique de ce processus étant les auto-entrepreneurs –, cette délégation s’accompagnant obligatoirement de la responsabilisation, qui « charge le travailleur, l’étudiant, le consommateur ou la personne indigente de discerner et d’appliquer les stratégies d’auto-investissement et d’entrepreneuriat adéquates pour prospérer et survivre. À ce titre, c’est une manifestation de la transformation des humains en capital. » Comme le dit un auteur cité par Wendy Brown, « si les bureaucraties hiérarchiques fonctionnaient systématiquement à l’obéissance, la gouvernance fonctionne systématiquement à la responsabilité. » Pris dans cette double contrainte à l’autonomie et à la responsabilité, « l’individu se voit doublement responsabilisé : on attend de lui à la fois qu’il se débrouille tout seul (et on lui reproche son échec lorsqu’il ne prospère pas) et qu’il agisse pour le bien de l’économie (lorsque celle-ci ne prospère pas, c’est à lui qu’on le reproche. » Pire, « même lorsque l’on ne leur reproche rien [aux individus], même lorsqu’ils se sont conduits convenablement au regard des normes de la responsabilisation, les mesures d’austérité prises au nom de la santé macroéconomique peuvent, en toute légitimité, détruire leurs moyens d’existence et leur vie. » Ainsi, « la délégation et la responsabilisation font […] des individus quelque chose dont on peut se passer et qu’il n’est pas nécessaire de protéger. » C’est, conclut Wendy Brown sur ce point, « plus que le simple démantèlement de la logique de l’État social, ou même du contrat social libéral : […] c’est à proprement parler son inversion. »
Le benchmarking et les dites « meilleures pratiques » sont des compléments indispensables de la délégation et de la responsabilisation. En effet, pour que des (auto)entrepreneurs ou d’autres responsables locaux mènent leurs opérations de façon satisfaisante et ce, sans recevoir en permanence des consignes précises comme c’était le cas dans le contexte hiérarchique précédent, il faut que soient diffusées largement des normes de conduite – les fameuses « meilleures pratiques ». On les retrouve partout, « des protocoles de recherche aux services sociaux, de l’industrie aux stratégies d’investissement et à l’élaboration des politiques publiques » et justement, il est « frappant de constater leur circulation de l’un à l’autre de ces domaines, et par conséquent la façon dont elles reconfigurent les politiques, l’éducation, l’armée et les services sociaux sur le modèle du monde des affaires ». Vient s’y ajouter le benchmarking, qui « se réfère à la pratique d’une entreprise ou d’une agence mettant en œuvre des réformes internes sur la base de l’étude et de l’importation des pratiques d’autres sociétés ou agences plus performantes ». Wendy Brown précise que « l’un des principes fondamentaux du benchmarking est que les meilleures pratiques peuvent être importées d’une industrie ou d’un secteur à un autre et même que certaines des réformes les plus fructueuses découlent précisément de l’adaptation audacieuse de pratiques issues d’un champ à un autre champ ». Ce que suppose cette circulation des « meilleures pratiques », c’est qu’elles ne sont liées en aucune façon à ce qui est produit. Ce qui permet d’appliquer des procédures issues de l’industrie et du secteur privé aux services publics, ainsi que l’on a pu le voir depuis déjà un certain temps, y compris en France – où les « néolibéraux » n’ont eu de cesse de seriner que l’État – ou les services publics – devaient être « gérés comme les entreprises ». Mais là aussi, s’appuyant sur la littérature managériale qui vante les vertus des « meilleures pratiques », Wendy Brown va encore un peu plus loin, affirmant que non seulement l’État et les services publics sont investis par la rationalité du marché, mais que cette dernière a tendance à prendre en charge elle-même les préoccupations politiques et juridiques qui relevaient auparavant de la sphère publique : « En combinant éthique, équité, légalité, efficacité et maximisation des résultats dans un environnement concurrentiel, les meilleures pratiques tout à la fois se substituent aux réglementations classiques des États, en représentent une critique (en préférant aux lois et commandements génériques des recommandations et des normes appropriées spécialement concues) et incarnent la priorité absolue donnée aux résultats économiques à chaque fois que de telles réglementations pourraient apparaître. » Cela dit, selon les situations, la gouvernementalité néolibérale peut aussi passer par des procédures assez autoritaires qui rappellent les pires côtés des pratiques étatiques qu’elle « abjure officiellement ». C’est ainsi que les « meilleures pratiques » ont pu aussi servir de cheval de Troie « grâce auquel le droit et l’ordre politique qu’il garantit [ont pu] être transformés pour et par la raison néolibérale », comme le montre l’exemple de « la néolibéralisation de l’Irak d’après Saddam ». Je ne vais pas reprendre ici la narration qu’en donne Wendy Brown, mais je ne peux qu’en recommander la lecture, tout à fait édifiante (voir ci-après, extrait 1). Pour résumer, elle montre comment l’administration américaine d’occupation a livré par décret l’ensemble de l’agriculture irakienne à Monsanto. Des millénaires de savoir-faire, de pratiques paysannes et de patrimoine génétique céréalier (l’Irak n’est autre que l’ancienne Mésopotamie, soit le fameux « croissant fertile », berceau de la culture du blé) ont été ainsi sacrifiés sur l’autel de la « modernisation agricole », comme on appelle la privatisation, la réduction drastique de la diversité et finalement la monopolisation des semences par la multinationale américaine.
Dans son chapitre 5, « Le droit et la raison juridique », Wendy Brown décortique quatre arrêts récents de la Cour suprême des États-Unis qui montrent comment « le droit devient […] un moyen de dissémination de la rationalité libérale au-delà de l’économie, et jusqu’aux éléments constitutifs de la vie démocratique. » Là non plus, je ne reprendrai pas le détail de son analyse, mais comme celle de la néolibéralisation de l’Irak, elle mérite vraiment d’être lue in extenso. Dans ces quatre jugements, écrit Wendy Brown, nous avons affaire à « une redéfinition majeure du dèmos ». « Le premier [de janvier 2010] autorise les grandes entreprises à financer les élections, ce symbole par excellence de la souveraineté populaire dans la démocratie néolibérale. » Le deuxième (avril 2011) autorise « les entreprises à contourner les class actions, ou recours collectifs, engagés contre elles en contraignant les consommateurs mécontents à accepter un arbitrage individuel ». Les troisième et quatrième (juin 2011), en réduisant à néant le pouvoir de négociation des syndicats du secteur public et en refusant de reconnaître la légitimité d’une action collective contre la discrimination salariale engagée par un million et demi de femmes contre le géant mondial de la distribution Wal-Mart, condamnent à l’impuissance toute action collective des travailleurs. « Pris ensemble, ces quatre arrêts s’attaquent à tous les niveaux du pouvoir populaire et de la conscience collective aux États-Unis : aux citoyens, aux consommateurs, aux travailleurs. […] La démocratie est désormais dissociée de tout pouvoir populaire organisé », ce qui ne représente rien de moins que l’accomplissement du programme déjà évoqué plus haut des contre-révolutionnaires de Thermidor et du Directoire. Mais Wendy Brown ne s’arrête pas en si bon chemin : « Ainsi, poursuit-elle, au-delà de l’augmentation des inégalités produites par la levée des restrictions pesant sur le capital et par l’intensification de celles qui pèsent sur les travailleurs, au-delà du démantèlement des associations et des solidarités populaires, il est une troisième opération par laquelle le droit contribue à la dé-démocratisation néolibérale : l’économisation des champs, des activités, des sujets, des droits et des visées politiques. » Et c’est ce qu’elle s’applique à montrer à travers l’examen détaillé de l’arrêt sur le financement des campagnes électorales. Celui-ci dit qu’interdire ou même réglementer les contributions des entreprises constituerait une restriction anticonstitutionnelles de la liberté d’expression, « droit fondamental qu’il faudrait garantir aux entreprises, en tant que “personnes fictives”, au même titre qu’à tous les citoyens ». Selon un juriste cité par Wendy Brown, ce jugement « applique la théorie économique néoclassique à la sphère politique et établit une analogie entre cette dernière et le marché. » Mais selon elle, ce jugement va encore plus loin : en effet, « il redéfinit des sphères auparavant non-économiques comme des marchés au niveau tant des principes que des normes et des sujets. Il redéfinit la sphère politique comme un marché et l’homo politicus comme un homo œconomicus : dans la sphère politique, les individus, les entreprises et les autres associations travaillent tous à améliorer leur compétitivité et la valeur de leur capital. » En fait, selon le juge suprême, limiter le financement de la politique par les grandes entreprises, c’est priver les citoyens d’une source d’information à laquelle ils ont pourtant droit. Cela revient à « interdire tel ou tel discours » et, en dernière analyse, à priver la société « d’un libre marché des idées ». Derrière ces arguments sur la « paralysie du discours des entreprises par l’État se joue un geste rhétorique crucial : la description du discours comme étant analogue au capital sur le “marché politique” ». Ainsi la démocratie est-elle « ici conçue comme un marché dont les biens – idées, opinions et, au bout du compte, votes – sont produits par le discours, exactement comme sur le marché économique s’échangent des biens produits par le capital. » Autrement dit, « le discours lui-même acquiert le statut de capital et l’on insiste sur la nécessité de garantir que ni ses sources ni sa circulation ne soient en aucune manière entravées » (voir ci-après, extrait 2).
On voit bien ici que nous n’avons pas simplement affaire à une « application des principes du marché [à des] champs qui ne relèvent pas du marché », mais à une véritable « économisation du politique » qui passe par la « conversion des processus, des sujets, des catégories et des principes politiques en processus, sujets, etc. économiques ».
Après une autre étude de cas, également assez effarante, consacrée à l’« économisation » de l’enseignement supérieur aux Etats-Unis, Wendy Brown conclut son livre par un épilogue titré « La fin de la démocratie élémentaire et l’inversion de la liberté en sacrifice ». Même si, dit-elle, la politique dans les démocraties libérales n’était pas indemne de toute contamination par l’économie, il subsistait cependant une tension entre l’affirmation du principe d’égalité au niveau politique et l’évidence criante des inégalités économiques. Et celles-ci pouvaient être contestées (même si ce ne fut pas toujours couronné de succès, loin de là) en mobilisant celui-là. Mais que se passe-t-il quand ce principe disparaît au profit de la seule « liberté du marché », comme c’est la tendance dans le néolibéralisme ? « Si la démocratie exprime l’idée que le peuple, plutôt que quoi que ce soit d’autre, doit décider des fondements et du cadre de l’existence commune de ces membres, l’économisation de ce principe est ce qui peut finalement parvenir à la tuer. »
Quant au sacrifice, Wendy Brown soutient l’idée que même si le néolibéralisme fonctionne « à la liberté » (du capital et des capitaux en quoi il transforme les êtres humains), il requiert cependant le sacrifice des citoyens, qui est en quelque sorte son « supplément nécessaire », soit un élément qui lui est extérieur, hétérogène, mais dont il ne saurait se passer[4]. En effet, une société de capitaux, c’est bien joli, mais quelque peu utopique – ça ne peut tout simplement pas fonctionner sans que toutes et tous (encore plus toutes : pensons au care et à l’énorme quantité de travail gratuit fourni par les femmes qui font tourner la « sphère de la reproduction », comme diraient des marxistes) sacrifient leur temps, leur énergie, leur plaisir de vivre au profit (c’est le cas de le dire) de ce satané capital. Comme le fait remarquer Wendy Brown, le sacrifice en régime néolibéral inverse la logique du sacrifice souvent décrit par les historiens et anthropologues, selon laquelle on sacrifie une ou des victimes afin de préserver la cohésion, voire la survie de la communauté. Aujourd’hui, « on demande à l’ensemble de la communauté de se sacrifier pour sauver certains de ses éléments déterminés ». C’est ainsi que l’on a demandé aux citoyens de se « serrer la ceinture » après la crise de 2008, afin de mieux renflouer les banques. On a vu la même logique à l’œuvre en Grèce et ailleurs, et les dégâts qu’elle a produits.
« Désespoir : un autre monde est-il possible ? » se demande Wendy Brown dans son dernier sous-titre. La formulation en elle-même ne semble pas très optimiste. À juste titre.
[1] La version française avait paru en 2009 aux éditions Les Prairies ordinaires, lesquelles avaient déjà publié en 2007 Les Habits neufs de la politique mondiale. Néolibéralisme et néoconservatisme.
[2] Traduit de l’anglais par Jérôme Vidal, éd. Amsterdam (qui ont par ailleurs repris le fonds des Prairies ordinaires).
[3] Naissance de la biopolitique. Cours au Collège de France (1978-1979), Paris, Seuil/Gallimard, 2004.
[4] La notion de supplément est reprise à Derrida qui l’a développée dans De la grammatologie (éd. de Minuit, 1967)
Extrait 1 : Les meilleures pratiques dans l’agriculture irakienne au XXIe siècle
En 2003, plusieurs mois après le renversement de Saddam Hussein, Paul Bremer, le chef de l’Autorité provisoire de la coalition, nommé par les Américains, déclara l’Irak « ouvert aux affaires » et promulgua un ensemble de cent décrets bientôt connus sous le nom de « décrets Bremer »1. Ils ordonnaient la vente de plusieurs centaines d’entreprises publiques. Les sociétés étrangères étaient autorisées à jouir de la propriété pleine et entière d’entreprises irakiennes et à s’approprier l’intégralité de leurs profits ; les banques pouvaient également désormais devenir la propriété d’étrangers, tandis que les barrières douanières étaient purement et simplement supprimées – faisant de l’Irak la nouvelle aire de jeu de la finance et des investisseurs mondiaux. Les décrets Bremer limitaient les droits des travailleurs et saignaient les biens et les services publics. Ils rendaient illégales les grèves et supprimaient le droit de se syndiquer dans la plupart des secteurs ; ils établissaient un impôt à taux unique sur les revenus et limitaient à 15 % l’impôt sur les sociétés, et ils supprimaient de surcroît toute taxation des profits rapatriés par les entreprises étrangères.
Beaucoup de ces décrets violaient les conventions de Genève et de La Haye sur la guerre, l’occupation et les relations internationales, puisque celles-ci visent à garantir que la puissance occupante protège les intérêts du pays occupé au lieu de brader ses richesses. Mais s’ils étaient illégaux dans le cadre du droit international, ils pouvaient en revanche être mis en œuvre par un gouvernement irakien souverain. C’est à cette fin que les États-Unis ont nommé un gouvernement provisoire en 2003 et lui ont instamment enjoint de ratifier les décrets Bremer lorsqu’il a été déclaré « souverain », en 2004. Et pour parer à l’éventualité qu’un futur gouvernement élu se montre moins conciliant, l’un des décrets précise qu’aucun gouvernement irakien n’a le pouvoir de les modifier2.
Les décrets Bremer, aussi bien que l’État sous domination américaine en voie de construction qui les a ratifiés et mis en application, illustrent de façon évidente une quantité impressionnante de caractéristiques du néolibéralisme : l’utilisation de catastrophes pour imposer des réformes néolibérales (ce qu’on a appelé la « stratégie du choc ») ; l’élimination des biens publics et des protections collectives ; la réduction des impôts et des taxes ; l’usage systématique de l’État pour structurer la concurrence commerciale à travers l’inégalité ; la dissolution des solidarités ouvrières et populaires ; enfin, la création de conditions idéales pour la finance et les investisseurs mondiaux. En même temps, ces décrets, définis comme des « instructions ou directives contraignantes pour le peuple irakien, qui créent des conséquences pénales et ont des conséquences directes sur les réglementations s’imposant aux Irakiens, avec notamment des changements du droit irakien3», paraissent en porte-à-faux avec le principe du soft power de la gouvernance et des meilleures pratiques, principe que nous avons jusqu’à présent décrit comme étant la modalité selon laquelle se diffuse la rationalité néolibérale. Comme l’a noté William Engdahl, ces décrets prenaient la forme d’un : « Obéissez ou vous mourrez4 ». Mais en examinant les choses de plus près, nous allons voir à la fois l’importance du droit dans la codification et la diffusion des meilleures pratiques, et le rôle des meilleures pratiques dans la production du droit et des politiques. Ces décrets découlaient de la compréhension néolibérale des meilleures pratiques et les mettaient en mouvement. Le droit, plutôt que la violence et les commandements, peut être mobilisé pour structurer la concurrence et faciliter l’accumulation du capital, mais aussi pour codifier et animer les meilleures pratiques. L’examen détaillé d’un des décrets Bremer illustrera de façon frappante cette concaténation d’effets.
Le décret Bremer no 81, la « loi sur les brevets, le design industriel, les informations confidentielles, les circuits intégrés et les variétés de plantes », comprend une interdiction portant sur « le réemploi des semences récoltées de variétés protégées5 ». Pourquoi promulguer une loi contre le réemploi des semences ? Les variétés protégées citées dans le décret sont les semences génétiquement modifiées produites par Monsanto, Dow, DuPont et d’autres géants de l’agro-industrie, et à première vue, l’interdiction paraît avant tout destinée à protéger les droits à la propriété intellectuelle de ces sociétés : il s’agit d’empêcher les agriculteurs d’acheter une fois les semences, puis de pirater leur descendance. Impitoyable, sans doute, mais rien de contraire à l’éthique ni d’extraordinaire. Et l’on ne voit pas bien non plus le rapport avec les meilleures pratiques. Mais la lettre de la loi n’est pas le fin mot de cette histoire, bien au contraire.
Monsanto et les autres grandes entreprises de l’agro-industrie vendent partout dans le monde un « package », une association de produits, qui est en train de transformer l’agriculture : ce lot inclut des semences génétiquement modifiées, brevetées, et les engrais et pesticides qui vont avec6. Armés de la promesse de rendements fantastiques et de la fin de la lutte contre les nuisibles, les géants de l’agrobusiness cherchent à convaincre les paysans des pays en développement d’abandonner leurs techniques, leur matériel et leurs marchés « traditionnels » pour entrer dans la « modernité ».
Depuis au moins 8 000 ans avant J.-C., les paysans irakiens ont fait pousser du blé avec succès sans ces outils dans la région qu’on appelle aujourd’hui le Croissant fertile. Au fil des siècles, ils ont cultivé diverses variétés essentielles à la durabilité des récoltes en conservant les graines issues de récoltes particulièrement vivaces une année, en les replantant et en les croisant avec des graines ayant d’autres caractéristiques l’année suivante. Par ces pratiques, la récolte ne cesse de s’améliorer et de se diversifier, sous l’effet cumulé de la sélection par des paysans expérimentés, de l’évolution des plantes et de la pollinisation spontanée due au vent, aux insectes et à d’autres animaux. Jusqu’en 2002 encore, comme le relève l’écologiste Jeremy Smith, l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture « estimait que 97 % des paysans irakiens » se livraient à de telles pratiques, contribuant par-là à ce qu’il existe « aujourd’hui dans le monde plus de 200 000 variétés de blé connues7 ».
Pendant des millénaires, les paysans du Croissant fertile ont partagé et échangé de façon informelle leurs graines au moment des moissons et des semailles. Au xxe siècle, ils se sont mis à stocker et à retirer les semences dans une banque nationale agricole, laquelle était, hélas, située à Abou Ghraïb. Elle fut entièrement détruite par les bombardements et l’occupation. Suite à ce désastre, qui venait s’ajouter aux destructions de la guerre, à des périodes de sécheresse depuis 1991, mais aussi à l’embargo des États-Unis et de la Grande-Bretagne, qui limitait l’accès aux équipements agricoles, la production de blé en Irak a connu une chute dramatique, de sorte que, pour la première fois depuis des siècles, la production n’a plus suffi aux besoins de la population8. C’est à la faveur de cette crise de production que les géants de l’agrobusiness ont pu s’introduire en Irak : avec la destruction de la banque de semences et la diminution considérable des récoltes due aux catastrophes naturelles et aux années de guerre, les paysans irakiens étaient vulnérables, désespérés, exploitables. Ils avaient besoin de semences, et les opérations d’aide soutenues par l’agrobusiness étaient là pour leur en fournir. Le décret Bremer no 81 scella la dépendance permanente des paysans aux géants de l’agro-industrie.
Offrir en 2004 des semences génétiquement modifiées aux paysans irakiens, comme l’a fait le gouvernement américain, c’était comme proposer de l’héroïne à une mère isolée au chômage, menacée d’expulsion et ayant perdu tout espoir pour l’avenir. Non seulement on leur promettait un soulagement de leurs souffrances, mais la première livraison était gratuite. Ainsi, on créait un lien indissoluble entre le récipiendaire et le fournisseur, et l’addiction était fatale : elle signait la mort de l’agriculture irakienne, de l’autosuffisance des paysans et, ultimement, des paysans eux-mêmes.
L’encre des décrets Bremer était encore fraîche que l’Agence américaine pour le développement international (USAID) livrait déjà des milliers de tonnes de semences de blé au ministère de l’Agriculture irakien, qui les distribua gratuitement ou pour une somme modique aux paysans du pays9. Une société de recherche en agriculture d’Arizona, la World Wide Wheat Company, y ajouta quelques milliers de sacs de semences gratuites10. Ces dons étaient accompagnés de séances de démonstration, organisées pour USAID par l’Agricultural and Mechanical University of Texas, et visant à expliquer aux paysans comment cultiver les nouvelles variétés à haut rendement. Des milliers de paysans furent ainsi persuadés d’adopter ces nouvelles techniques agricoles, qui impliquaient également l’usage de fongicides, de pesticides et d’herbicides spécialement adaptés. Séduits par la gratuité des semences, la promesse d’une hausse considérable de la production et l’insistance de leurs formateurs sur le fait que ces récoltes uniformes et les produits chimiques qui les accompagnaient représentaient la modernité, la prospérité et l’avenir, les paysans irakiens rompirent presque du jour au lendemain avec des siècles de tradition. Le décret no 81 garantissait cette transformation. Les paysans irakiens sont désormais indissolublement liés à leurs vendeurs étrangers, puisqu’ils n’ont plus le droit de conserver les semences des variétés protégées, à présent omniprésentes dans leurs champs, mélangées aux semences qui constituaient leur héritage millénaire. Ainsi fut signée la fin d’une production de blé biologique, diversifiée, peu coûteuse et écologiquement soutenable en Irak11.
La moitié des semences de blé distribuées dans l’Irak de l’après-Saddam était panifiable ; l’autre moitié était destinée à la production de pâtes – or, les pâtes ne font pas partie du régime des Irakiens12. Ainsi, non seulement les paysans irakiens dépendent désormais de géants de l’agro-industrie, à qui ils doivent acheter chaque année leurs semences, leurs licences et leurs produits chimiques (des achats qui plus est subventionnés par l’État, tandis que les autres subventions agricoles ont été supprimées), mais alors qu’ils pratiquaient auparavant la polyculture, ce qui leur permettait de satisfaire les besoins de la population locale, ils pratiquent désormais la monoculture et ont été intégrés aux marchés mondiaux d’import-export13. Aujourd’hui, les paysans irakiens assurent des profits à Monsanto en fournissant des pâtes aux cafétérias des écoles du Texas, tandis que l’Irak s’est mis à importer des denrées qui poussaient autrefois sur son propre sol.
L’histoire déchirante de la destruction de milliers d’années d’agriculture soutenable et de ce que certains activistes appellent la « souveraineté alimentaire » ne s’arrête pas là, mais projetons-nous un moment dans un futur possible. Une expérimentation similaire s’est déroulée en Inde dans les années 199014. Des représentants de l’agro-industrie, allant porter la bonne parole de village en village, sont parvenus à persuader des dizaines de milliers de paysans d’adopter des semences de coton génétiquement modifiées en leur promettant des récoltes plus importantes et susceptibles d’être exportées, ce qui était particulièrement désirable au moment où des réformes libérales mettaient un terme aux subventions gouvernementales pour la production de coton. Les paysans étaient par ailleurs encouragés à s’engager dans cette transition par l’accès à d’importants prêts bancaires pour l’achat des semences et des pesticides, fongicides et herbicides nécessaires à leur culture. Comme les Irakiens, les cultivateurs de coton indiens n’adoptaient pas simplement de nouvelles technologies agricoles : ils étaient intégrés au marché mondial et à l’économie de la dette.
Le problème est que l’agriculture a ceci de particulier qu’elle est vulnérable aux fluctuations naturelles, comme la sécheresse ou les inondations, tandis que l’agriculture tournée vers l’exportation est quant à elle vulnérable aux fluctuations des marchés mondiaux. Ces aléas peuvent ruiner une année et laisser les paysans accablés de dettes, dans l’incapacité de rembourser leurs emprunts ou d’emprunter à nouveau (ou alors à des taux usuriers), donc de semer et par conséquent de compenser leurs pertes. C’est exactement ce qui s’est passé il y a une dizaine d’années en Inde, les cultivateurs de coton se retrouvant toujours plus profondément aspirés dans une spirale d’endettement15. Le résultat ? Une épidémie de suicides de paysans (il y en a eu au moins vingt mille jusqu’à aujourd’hui). Et c’est bien souvent en avalant une bouteille de RoundUp®, l’herbicide produit par Monsanto qui tue tout sauf les semences génétiquement modifiées de Monsanto, qu’ils en finissent16.
Bien sûr, Monsanto n’a pas volontairement créé cette catastrophe en Inde. Pas plus que ce n’est le but du décret no 81 en Irak. Non, il vise bien plutôt à instituer un ensemble de meilleures pratiques – soit des « techniques, méthodes, procédures, activités ou incitations qui se sont avérées les plus efficaces pour produire un certain résultat » – qui promeuvent la modernisation des techniques agricoles, la mise en place de monocultures à haut rendement, l’intégration à l’économie mondiale et le développement d’une capacité d’exportation dans le contexte d’un marché libre – tout cela en garantissant un climat favorable à l’agrobusiness. Le décret nomme explicitement chacune de ses visées dans son préambule. En voici les extraits pertinents :
Reconnaissant le désir du Conseil de gouvernement de modifier significativement le système de propriété intellectuelle irakien, une mesure nécessaire à l’amélioration de la situation économique du peuple irakien,
Déterminés à améliorer les conditions de vie, les compétences techniques et les chances de tous les Irakiens, et à lutter contre le chômage, dont les effets sont délétères sur la sécurité publique,
Reconnaissant que les sociétés, les établissements de crédit et les entrepreneurs ont besoin d’un environnement équitable, efficace et prévisible pour la protection de leur propriété intellectuelle,
Reconnaissant l’intérêt manifesté par le Conseil de gouvernement irakien pour devenir membre à part entière du système d’échanges international, connu sous le nom d’Organisation mondiale du commerce […]
Agissant de façon conforme au rapport du secrétaire général au Conseil de sécurité […] à propos de la nécessité d’un développement de l’Irak et de sa transition d’une économie centralisée et non transparente à une économie de marché transparente, caractérisée par une croissance économique soutenable à travers l’établissement d’un secteur privé dynamique, et la nécessité de mettre en œuvre des réformes institutionnelles et juridiques pour le réaliser17.
Rendre le climat plus favorable à l’investissement en Irak, intégrer le pays au commerce mondial et éliminer la propriété et la gestion étatiques, jugées non transparentes, au profit d’entreprises privées : voilà les « résultats » que le décret no 81 vise à produire. Le « bidouillage juridique », comme l’appelle Nancy Scola, qui a permis de mettre fin au stockage et au réemploi des semences était la réforme nécessaire pour les réaliser18. Se présentant comme l’opposé de la réglementation, ce décret initie les pratiques qui visent à intégrer l’agriculture et les paysans irakiens à l’ordre mondial, une intégration réalisée, d’une part, en éliminant les échanges non monétaires, l’utilisation des ressources locales et les techniques traditionnelles, et, d’autre part, en organisant la dépendance à des grandes entreprises étrangères, aux engrais et aux pesticides, aux prêts financiers et à l’exportation mondiale sur des marchés extrêmement vastes. Le bidouillage juridique évoqué lance ces meilleures pratiques mais, à l’instar de l’éthique protestante que Weber estimait cruciale à la construction du capitalisme, son importance s’atténue une fois la machine mise en route19. Ainsi, le décret no 81 est le symbole parfait de la mobilisation néolibérale du droit non pour réprimer ou punir, mais pour structurer la concurrence et assurer la « conduite des conduites ». En modifiant une modeste pratique (le stockage des semences), il met en branle les visées convergentes de la croissance économique irakienne, de la protection de la propriété intellectuelle des entreprises et de l’intégration de l’Irak au commerce et à la finance mondiaux.
Revenons une fois encore sur le préambule du décret no 81. Il comprend l’objectif d’améliorer les conditions de vie, les compétences techniques, les opportunités et la sécurité publique des Irakiens ; celui de produire un environnement désirable pour les sociétés, les banques et les entrepreneurs ; celui d’intégrer l’Irak au système commercial mondial et, enfin, celui de créer une économie de marché libre, dynamique et transparente. Le préambule illustre la fusion, au sein de la gouvernance, de la véridiction et de l’objectivité, de l’expertise et du consensus, de la satisfaction des besoins et de la mise en place d’un avantage compétitif. Il illustre également le fait que les meilleures pratiques présupposent l’existence d’un objectif commun, plutôt que de paraître favoriser les intérêts d’un acteur au détriment d’un autre, ou même de reconnaître l’existence d’intérêts divergents. En neutralisant ou en masquant la polémique ou le conflit sur les fins, les meilleures pratiques instituent les normes et les caractéristiques du marché en principe de réalité. Ainsi, bien qu’il soit certainement possible d’imaginer des pratiques plus soutenables écologiquement, économiquement et socialement pour l’agriculture irakienne, celles-ci seraient contradictoires avec les principes du marché et de la concurrence au niveau mondial, avec le droit de la propriété intellectuelle et les nouvelles modalités de financement, sans parler bien sûr des techniques agricoles modernes. Certes, des pratiques agricoles biologiques, à petite échelle, coopératives, affranchies du financement par l’emprunt, favorisant la biodiversité et assurant une « souveraineté alimentaire » à la nation pourraient faire sens si l’on se demandait comment la production de blé en Irak pourrait s’appuyer sur le savoir, les matériaux et les techniques du passé pour construire un avenir viable. Mais dans la mesure où de telles pratiques feraient de l’Irak une anomalie dans l’économie mondiale, elles ne peuvent être reconnues comme des meilleures pratiques.
Ce que rend également manifeste cette histoire, c’est l’intrication singulière des visées étatiques et commerciales dans la gouvernance néolibérale, une intrication qui va au-delà des directions emboîtées et des petits arrangements « donnant-donnant » que l’on a connus dans les formes passées du capitalisme. Le but de l’État est d’encourager la croissance économique et de créer un climat favorable à l’investissement, non le bien-être d’un secteur ou d’une population particulière ; et le but du capital est de produire cette croissance, bien qu’il s’intéresse en même temps aux finalités et aux questions éthiques plus larges, auparavant prises en charge ailleurs. Ainsi, avec la gouvernance néolibérale s’opère toute une série de transpositions historiques : le monde des affaires se consacre au développement local, tandis que le gouvernement s’occupe du positionnement sur le marché mondial ; les gouvernements négocient des contrats tandis que les entreprises deviennent des éducateurs ; les gouvernements se soucient de créer un climat favorable à l’investissement, et le monde des affaires se soucie d’éthique ; les gouvernements donnent la priorité à la croissance économique, à la cote de crédit et au positionnement dans l’économie mondiale, cependant que le monde des affaires représente les intérêts des nécessiteux ou des défavorisés.
On raconte que le décret no 81 a été rédigé par Monsanto, et il découle clairement des liens étroits que l’administration Bush entretenait avec l’agrobusiness (et dont témoignait la composition du cabinet de Bush). Mais ces faits manquent l’essentiel. Les décrets exprimaient et mettaient en œuvre le projet de Bremer en Irak, qui n’était pas de démocratiser le pays, mais de le néolibéraliser. Dans cette perspective, il y a quelque chose de plus significatif encore que l’influence directe de Monsanto : le fait que les décrets encourageant la dérégulation économique, la privatisation et l’organisation de la concurrence ont précédé la construction d’institutions démocratiques – les décrets d’abord, ensuite seulement les constitutions, les parlements, les conseils, les élections et les libertés civiles. Il convient également de remarquer que le gouvernement provisoire qui a validé les décrets, dont les membres avaient été personnellement choisis par l’équipe de Bremer et dont toutes les actions étaient soumises au veto de Bremer lui-même, n’était composé que de gens favorables à l’occupation américaine. Et ce gouvernement a quant à lui proposé un processus de ratification de la constitution permanente qui excluait tous les partis politiques ne soutenant pas l’occupation20. Là encore, on peut voir dans ces manœuvres l’intervention directe et brutale des États-Unis, soucieux de faire de l’Irak un terrain de jeu pour le capital international et plus particulièrement pour les entreprises américaines, de Halliburton à Monsanto. Mais plus révélatrice encore est la façon dont ces mesures expriment des caractéristiques distinctives de la gouvernance néolibérale : si les États fonctionnant sur un modèle commercial tendent à éviter de faire un usage excessif de la violence ou de pratiques extraconstitutionnelles, ils se refusent en même temps à laisser s’exprimer des intérêts adverses ou concurrents, à céder leur contrôle ou à donner la priorité à la justice et à la protection sociale plutôt qu’au climat propice à l’investissement et à la croissance économique21. Ce déplacement décisif des finalités et de la légitimité de l’État est plus important que la question de savoir précisément qui, des hommes politiques, des grandes entreprises et des banques, couche avec qui. Cet ancien modèle tombait facilement sous l’accusation de corruption. La gouvernance néolibérale encourage une fusion plus souple et plus efficace des pouvoirs politiques et économiques, qui éradique dans une large mesure le scandale de la corruption parce qu’elle efface la distinction entre les finalités et les modes de gouvernance respectifs des États et du capital, grâce à la circulation entre eux des meilleures pratiques, vecteur de cet effacement22.
- Les décrets Bremer, ainsi que leur préambule et leur déclaration d’intention, sont disponibles à l’adresse suivante : www.iraqcoalition.org/regulations.
- William Engdahl, « Iraq and Washington’s “Seeds of Democracy” », Current Concerns, no5, 2005, en ligne : www.currentconcerns.ch/archive/2005/05/20050507.php
- Bremer Orders, www.iraqcoalition.org/regulations
- William Engdahl, « Iraq and Washington’s “Seeds of Democracy” », art. cité.
- Le texte complet du décret no81 de l’Autorité provisoire de la coalition, « Patent, Industrial Design, Undisclosed Information, Integrated Circuits and Plant Variety Law », est disponible à l’adresse : www.bibliotecapleyades.net/ciencia/ciencia_geneticfood18a.htm
- Voir Le Monde selon Monsanto, un documentaire de Marie-Monique Robin, France, Image et Compagnie, 2008.
- Jeremy Smith, « Order 81: Re-engineering Iraqi Agriculture », Global Research, 27 août 2005, en ligne : www.globalresearch.ca/order-81-re-engineering-iraqi-agriculture/870
- Ibid. ; William Engdahl, « Iraq and Washington’s “Seeds of Democracy” », art. cité.
- William Engdahl, « Iraq and Washington’s “Seeds of Democracy” », art. cité, p. 3.
- Jeremy Smith, « Order 81: Re-engineering Iraqi Agriculture », art. cité, p. 2.
- William Engdahl, « Iraq and Washington’s “Seeds of Democracy” », art. cité; Jeremy Smith, « Order 81: Re-engineering Iraqi Agriculture », art. cité ; Nancy Scola, « Why Iraqi Farmers Might Prefer Death to Paul Bremer’s Order 81 », Alternet, 19 septembre 2007, www.alternet.org/story/62273/why_iraqi_farmers_might_prefer_death_to_paul_bremer%27s_order_81
- Jeremy Smith, « Order 81: Re-engineering Iraqi Agriculture », art. cité ; William Engdahl, « Iraq and Washington’s “Seeds of Democracy” », art. cité, p. 3-4.
- William Engdahl, « Iraq and Washington’s “Seeds of Democracy” », art. cité, 4.
- Nancy Scola, « Why Iraqi Farmers Might Prefer Death to Paul Bremer’s Order 81 », art. cité. Voir aussi Vandana Shiva, La Biopiraterie, ou le pillage de la nature et de la connaissance, Paris, Alias etc., 2002.
- Nancy Scola, « Why Iraqi Farmers Might Prefer Death to Paul Bremer’s Order 81 », art. cité, p. 2.
- , p. 5.
- Décret no81 de l’Autorité provisoire de la coalition.
- Nancy Scola, « Why Iraqi Farmers Might Prefer Death to Paul Bremer’s Order 81 », art. cité, p. 1.
- « Quoi qu’il en soit, le capitalisme vainqueur n’a plus besoin [du] soutien [de l’ascétisme religieux] depuis qu’il repose sur une base mécanique » (Max Weber, L’Éthique protestante,cit., p. 224).
- Ce qui a suscité des problèmes pour le processus de ratification de la constitution parce qu’une première proposition visait à exclure du processus tous les partis qui s’opposaient à l’occupation.
- Si les États sont confrontés à des défis et des missions autres que ce but, comme calmer les gens ou préserver la nation d’un danger, ils peuvent également s’en occuper par décret, d’où le décret no2 qui a aboli l’armée irakienne.
- L’effacement de la distinction entre la forme et le contenu du gouvernement et ceux du monde des affaires par la gouvernance néolibérale est importante. Cependant, la façon dont cette gouvernance lie le monde des affaires et la recherche ne l’est pas moins. Comme la gouvernance néolibérale est légitimée par l’efficacité avec laquelle elle déploie les moyens requis pour parvenir à des fins – plutôt que, par exemple, par le fait de respecter et d’appliquer des principes de justice ou de pourvoir aux besoins fondamentaux de ses membres – elle a un rapport particulier au savoir. La bonne gouvernance promeut la croissance économique, une atmosphère favorable aux investissements et une cote de crédit élevée, et elle requiert le savoir nécessaire pour ce faire. Pas la mauvaise gouvernance. Ainsi, la réduction de tout savoir à son utilité économique (qui est manifeste dans le soutien toujours plus appuyé aux recherches universitaires qui ont des « facteurs d’impact » élevés et dans l’effort pour assécher ou éliminer la recherche qui au contraire n’a pas d’impact commercial) et de tout gouvernement à l’objectif de santé économique sont les deux faces d’un même phénomène. Les meilleures pratiques expriment cette convergence. Le financement par l’agrobusiness de la recherche à Texas A&M University, le développement par Texas A&M University de parcelles témoins pour favoriser la commercialisation de semences génétiquement modifiées en Inde et le travail conjoint des équipes d’USAID et des représentants de la World Wide Seed Company en Irak – ne sont que les manifestations empiriques superficielles d’une reconfiguration bien plus profonde dans la gouvernance néolibérale et, par elle, des fossés et des intervalles, certes modestes, certes régulièrement outrepassés, entre les domaines et les activités du monde des affaires, de la recherche et du gouvernement.
Extrait 2 : Le discours est semblable au capital
Le discours est semblable au capital
S’exprimant au nom de la majorité dans le jugement Citizens United, le juge Kennedy entreprend d’émanciper le discours des rets de la réglementation et de la censure qui selon lui le découragent (si ce n’est pire) actuellement. Citant l’avis de Roberts, président de la Cour suprême, dans une affaire antérieure, il rappelle que « les libertés garanties par le premier amendement ont besoin d’espace pour respirer1 ». « À mesure que de nouvelles règles sont créées pour réglementer le discours politique, ajoute Kennedy, tout discours qui pourrait être jugé relever d’elles est comme paralysé2. » Décrivant la Commission électorale fédérale comme un organe avant tout préoccupé de censure, à l’origine de « pesantes restrictions » qui « fonctionnent comme des équivalents de limitations a priori de la liberté d’expression3 », Kennedy s’applique à en souligner le danger – un danger que la Cour a précisément le devoir de combattre :
Lorsque la Commission électorale fédérale émet des avis qui interdisent tel ou tel discours, « beaucoup de gens, plutôt que de tenter de faire valoir leurs droits en engageant individuellement des poursuites – une tâche extrêmement pesante, et parfois risquée – choisissent tout simplement de ne pas user de leur droit à la liberté d’expression, ce qui non seulement leur porte tort à eux, mais porte tort à la société dans son ensemble, puisqu’elle se voit privée d’un libre marché des idées. » Virginia v. Hicks, 539 U. S. 113, 119. Par conséquent, « le jugement du censeur peut en pratique s’avérer sans appel. » Freedman.
À certains moments de son argumentation, Kennedy élève la voix et dénonce les restrictions portant sur les dépenses des entreprises dans les campagnes électorales comme « une censure pure et simple4 » ; à d’autres, il les décrit simplement comme des interventions étatiques inappropriées, témoignant des pesanteurs bureaucratiques5. Mais sous toutes ces hyperboles sur la paralysie du discours des entreprises par l’État se joue un geste rhétorique crucial : la description du discours comme étant analogue au capital sur « le marché politique ». D’un côté, les interventions de l’État sont dépeintes tout au long de l’avis comme des atteintes au marché des idées que produit le discours6. Les restrictions étatiques portent tort à la liberté d’expression comme elles portent tort à toutes les libertés. D’un autre côté, l’accumulation et la circulation illimitées des discours sont érigées en bien absolu, essentiel au « droit des citoyens à chercher, entendre, exprimer et utiliser l’information pour parvenir à un consensus, [qui est lui-même] l’une des conditions de possibilité d’une autonomie politique éclairée et l’un des moyens nécessaires de sa protection7. » Ce ne sont pas simplement les droits des entreprises, donc, mais la démocratie elle-même qui est en jeu dans cette déréglementation du discours. On relèvera cependant que la démocratie est ici conçue comme un marché dont les biens – idées, opinions et, au bout du compte, votes – sont produits par le discours, exactement comme sur le marché économique s’échangent des biens produits par le capital. En d’autres termes, au moment même où le juge Kennedy soutient que le libre exercice de droits égaux sur ce marché ne saurait être entravé par la prise en considération de la richesse extrême de certains (sans quoi l’on mettrait en danger la maximisation de l’utilité pour tous que permettent ces droits), le discours lui-même acquiert le statut de capital et l’on insiste sur la nécessité de garantir que ni ses sources ni sa circulation ne soient en aucune manière entravées.
Qu’y a-t-il de significatif dans le fait de considérer le discours comme un capital ? L’économisation du politique intervient non seulement à travers l’application des principes du marché aux champs qui ne relèvent pas du marché, mais à travers la conversion des processus, des sujets, des catégories et des principes politiques en processus, sujets, etc., économiques. C’est précisément cette conversion qui prend place à chaque page de l’avis rendu par Kennedy. Si tout ce qui existe dans le monde est un marché, et si les marchés néolibéraux sont uniquement composés de capitaux concurrents – petits et grands –, et si le discours est le capital propre au marché électoral, alors le discours partage inévitablement les attributs du capital : il prend de la valeur grâce à des investissements réfléchis, et il favorise la position de celui qui le porte ou le possède. Pour prendre les choses par l’autre bout, une fois qu’on a fait du discours le capital du marché électoral, il convient de lever toutes les restrictions et réglementations dont il pourrait faire l’objet : il peut être consommé et remplacé par différents acteurs et dans différents lieux, et il n’existe que pour favoriser les intérêts de celui qui en est porteur. On chercherait vainement dans cette description tout ce à quoi le discours est traditionnellement associé – la liberté, la conscience, la délibération ou encore la persuasion.
Mais en quoi exactement le discours est-il un capital selon l’avis rédigé par Kennedy ? Comment en vient-il à le définir en termes économiques, de telle façon que sa réglementation ou sa limitation apparaissent néfastes à son marché propre et que sa monopolisation par les grandes entreprises apparaisse bénéfique à tous ? La transformation monstrueuse du discours en capital intervient à plusieurs niveaux.
Si le discours s’apparente au capital, c’est tout d’abord par sa tendance à proliférer et à circuler, à passer outre les barrières, à circonvenir les limitations, légales ou autres, qu’on cherche à lui imposer, et même par sa capacité à toujours mettre en échec les efforts pour le contrôler ou le censurer8. Le discours est ainsi décrit comme une force à la fois naturelle et bonne, qui peut être indûment entravée et gênée, mais jamais anéantie.
Deuxièmement, les personnes ne sont pas simplement des producteurs de discours, mais également des consommateurs, et l’ingérence de l’État – illégitime dans le principe et néfaste en pratique – les menace à ces deux titres. C’est le marché des idées qui décide de la valeur des affirmations portées par un discours, répète inlassablement Kennedy. Chaque citoyen doit juger pour lui-même du contenu d’un discours ; cette question ne saurait être tranchée par le gouvernement, exactement comme le gouvernement ne doit pas s’arroger les autres choix qui relèvent du consommateur9. Au cours de son argumentation, Kennedy ne mentionne pas la délibération ni l’élaboration collective d’un jugement en politique, pas plus qu’il n’évoque les voix dépourvues de financement et relativement impuissantes. L’objet de son réquisitoire est l’illégitimité du gouvernement qui « dicte […] où une personne peut obtenir des informations, ou quelle source jugée indigne de confiance elle ne peut pas entendre, [utilisant] la censure pour contrôler la pensée10 ». Si le discours produit des biens consommés en fonction de préférences individuelles, l’État fausse ce marché en « interdisant le discours politique de millions d’associations de citoyens » (à savoir, les grandes entreprises) et en restreignant de façon paternaliste ce que les consommateurs sont autorisés à savoir ou à envisager. Encore une fois, si le discours est le capital du marché politique, alors nous sommes politiquement libres quand il circule librement. Et il ne circule librement que si les grandes entreprises ne sont pas limitées dans leur capacité à soutenir ou à financer tel ou tel discours.
Troisièmement, Kennedy décrit le discours non pas simplement comme un moyen d’expression et de dialogue, mais comme une puissance productive et innovatrice, exactement comme le capital. Il existe « une dynamique créative inhérente au concept d’expression libre » qui rencontre et se nourrit des « changements rapides en matière de technologie » pour produire le bien commun11. Pour Kennedy, c’est particulièrement cet aspect du discours qui nous « met en garde contre le maintien d’une loi limitant le discours politique dans certains médias ou à certains locuteurs12 ». De nouveau, le dynamisme, l’inventivité et la productivité du discours sont entravés par l’intervention de l’État.
Quatrièmement – et c’est peut-être là l’essentiel pour établir le statut du discours comme capital du marché électoral –, Kennedy place le pouvoir du discours et le pouvoir de l’État en opposition directe, dans un jeu à somme nulle. À de multiples reprises tout au long de l’avis majoritaire, il identifie le discours à la liberté et l’État au contrôle, à la censure, au paternalisme et à la répression13. Lorsque liberté d’expression et État se rencontrent, c’est pour s’affronter : à l’en croire, le droit à la libre expression garanti par le premier amendement a pour « présupposé la défiance à l’égard du pouvoir d’État » et est « un mécanisme essentiel de la démocratie [parce qu’]il est ce qui permet d’obliger les responsables à rendre des comptes au peuple14 ». Le thème connaît de multiples variations au cours de l’avis, et notamment celles-ci :
Le premier amendement n’a certainement pas été conçu [par les rédacteurs de la Constitution] pour valider la répression de discours politiques dans le média le plus en vue de la société. Il était conçu comme une réponse à la censure15.
Lorsque l’État fait usage de tout son pouvoir, y compris de la loi pénale, pour dicter où une personne peut obtenir des informations, ou quelle source jugée indigne de confiance elle ne peut pas entendre, elle utilise la censure pour contrôler la pensée. […] Le premier amendement confirme la liberté que nous avons de penser par nous-mêmes16.
Cette interprétation du premier amendement et de la finalité du discours politique conduit Kennedy à présenter l’État et le discours comme deux forces ennemies, symétriques de celles que sont l’État et le capital dans l’économie néolibérale.
Dans son avis, le juge interprète le premier amendement non plus comme un droit humain ou civil, mais comme un droit du capital. Ce qu’il cherche à garantir contre toute réglementation ou ingérence, ce ne sont plus des idées, une délibération ou l’intégrité de la sphère politique démocratique, mais un flux de discours. Tout en conservant le langage du droit et des personnes, il opère en réalité une dissociation entre, d’une part, le discours et le droit à la libre expression et, d’autre part, les individus, ce qui lui permet ensuite de défendre plus aisément la protection de la libre expression des entreprises. Le problème que soulève Citizens n’est donc pas – comme l’affirment souvent ses critiques – qu’il confère aux grandes entreprises les droits des individus, mais que les individus en tant que porteurs de droits et parties prenantes de la souveraineté populaire disparaissent lorsque les flux de discours accèdent au statut de flux de capitaux et que tous les acteurs cherchent à accroître la valeur de leur capital.
Pour Kennedy, non seulement discours et capitaux doivent circuler librement, mais le seul ennemi de cette liberté est l’État. Dans cette perspective, tous les membres de la société et de l’économie, du citoyen le plus pauvre à l’entreprise la plus riche, sont liés entre eux en tant que victimes potentielles de l’ingérence et de la censure de l’État. Dès lors qu’individus et entreprises sont ainsi alliés – et même identifiés par les périls identiques qui les menacent –, la puissance singulière du discours des grandes entreprises n’est pas simplement passée sous silence, elle est transformée en cause à défendre. Désormais, ce qui doit être combattu, ce sont les conditions qui font que « certaines associations défavorisées de citoyens – celles qui ont une forme entrepreneuriale – sont pénalisées » et empêchées de « proposer tant des faits que des opinions au public », qui se voit ainsi privé de « connaissances et d’opinions vitales à son fonctionnement17 ».
Dans un champ structuré par une rhétorique selon laquelle il n’existe que le discours et sa mise en danger par l’État, où le flux sans entraves du discours profite à tous, tandis que l’intervention de l’État cible et discrimine invariablement, les différences significatives entre locuteurs disparaissent. Que celui qui parle soit une femme à la rue ou Exxon, le discours est du discours et le capital, du capital. Le déni des stratifications et des différences de pouvoir dans le champ de l’analyse et de l’action est un trait essentiel de la rationalité néolibérale, et c’est précisément ainsi que sont effacées discursivement les distinctions entre capital et travail, propriétaires des moyens de production et producteurs, propriétaires et locataires, riches et pauvres. Il n’y a que du capital, et le fait qu’il soit humain, entrepreneurial, financier ou dérivé, qu’il soit immense ou infime, ne dit rien des normes qui doivent s’appliquer à lui, ni n’altère son droit à être affranchi de toute ingérence. Ainsi, dans Citizens United, il n’y a que du discours, et tout discours dispose du même droit, de la même capacité à enrichir le marché des idées, de la même capacité à être jugé par les citoyens et de la même vulnérabilité aux restrictions et à la censure de l’État.
En bref, pour le juge Kennedy, si le discours est semblable au capital, c’est parce qu’il est naturel, incontrôlable, dynamique et créateur ; parce qu’il opère et circule dans un champ organisé comme un marché ; parce qu’il a le même statut, quels que soient les agents sociaux qui le portent ; parce qu’il crée de la liberté à travers les choix des producteurs et des consommateurs ; parce qu’il a le droit d’être libre ; parce qu’il s’oppose par principe à toute réglementation par l’État. Comme nous le verrons, le discours fonctionne en tant que capital dans la mesure où il favorise la position de celui qui le porte sur ce que Kennedy appelle « le marché politique ». À travers cette transformation – ce passage d’un registre politique à un registre économique – de la signification, du caractère, de la visée et de la valeur du discours, s’exprime de façon précise le développement de la rationalité néolibérale dans la sphère politique et éthique. En étouffant les inquiétudes suscitées par la distribution inégale du pouvoir et de l’efficacité au sein du marché des discours, elle renforce en même temps l’argumentaire de ceux qui veulent lever les restrictions relatives à l’entrée sur le marché et éliminer les réglementations encadrant leur fonctionnement à l’intérieur du marché. Une fois cette économisation accomplie, vouloir soumettre le marché sur lequel opère le discours à une égalité ou à une redistribution artificielles revient simplement à commettre une erreur morale et technique typique du keynésianisme. Si les marchés sont des lieux où règne une égalité naturelle, qui ne sauraient exister et prospérer en l’absence d’une concurrence sans entraves, l’État peut certes intervenir pour en faciliter l’accès ou entretenir la concurrence, mais en dehors de cela, il n’est qu’un intrus, il n’a aucune légitimité. Ainsi, aux yeux du juge Kennedy, les décisions de la Cour suprême qui visaient à limiter la liberté d’expression des entreprises constituent des ingérences dans le « libre marché » des idées que protège le premier amendement18.
- Citizens United v. FEC, 558 U.S. (2010), p. 329, qui cite Federal Election Commission v. Wisconsin Right to Life, Inc.
- Ibid., p. 334.
- Ibid., p. 335.
- Ibid., p. 312 et 339.
- Après avoir longuement exposé tout le travail engendré pour les Political Action Committees (PAC) par la tenue des dossiers, la comptabilité et les déclarations, Kennedy conclut qu’« étant donné ces contraintes très lourdes, une entreprise peut ne pas être en situation de créer un PAC en temps et en heure pour faire connaître ses vues » pendant une campagne électorale. Une telle « limitation du discours », ajoute-t-il, constitue un tort non seulement pour le locuteur potentiel, mais aussi pour le public, dans la mesure où cela « réduit nécessairement la quantité d’expression par la restriction du nombre des questions abordées, la profondeur de l’examen auxquelles elles donnent lieu et la taille du public susceptible d’être touché » (Ibid., p. 339, qui cite Buckely v. Valeo).
- Steven Shiffrin est sans doute l’auteur qui a discuté de la façon la plus approfondie et intéressante qui soit la question du recours à la métaphore du marché dans l’interprétation du premier amendement. Dans de nombreux articles et livres, ainsi que dans son recueil de jurisprudence, il coupe avec résolution les liens prétendus entre un marché imaginaire des idées et la vérité, l’équité, le dissensus, la délibération ou même le choix véritable. Voir par exemple The First Amendment, Democracy, and Romance (Princeton, Princeton University Press, 1990), dans lequel il affirme : « L’engagement à soutenir le dissensus ne requiert pas de croire que ce qui émerge du “marché” est généralement juste ou que le “marché” est la meilleure des épreuves de vérité. Au contraire, l’engagement à soutenir le dissensus présuppose que les pressions sociétales qui vont dans le sens du conformisme sont fortes et que les incitations au silence sont souvent grandes. Si la métaphore du marché encourage le point de vue selon lequel une main invisible ou des arrangements volontaristes nous ont guidés avec patience, mais lentement, jusqu’à l’harmonie burkéenne, l’engagement à soutenir le dissensus nous encourage à croire que les confortables arrangements de l’état de choses existant ont été établi sur une base en deçà du vrai ou du juste. Si la métaphore du marché encourage le point de vue selon lequel les conventions, les habitudes et les traditions ont émergé comme notre meilleure approximation de la vérité à partir de l’épreuve de vérité rigoureuse du marché des idées, l’engagement à soutenir le dissensus encourage le point de vue selon lequel les conventions, les habitudes et les traditions sont des compromis susceptibles d’être contestés. Si la métaphore du marché nous invite à penser que la vérité selon le marché est plus digne de confiance que n’importe quelle vérité que le gouvernement pourrait dicter, un engagement à soutenir le dissensus nous invite à nous méfier du marché comme du gouvernement. Si la métaphore du marché favorise une forme molle de relativisme (tout ce qui émerge du marché convient jusqu’à nouvel ordre), l’engagement à soutenir le dissensus insiste sur le fait que les sondages ne décident pas de la vérité » (Cité dans Steven Shiffrin et Jesse Choper, First Amendment: Cases, Comments, Questions, Saint Paul, West Academic Publishing, 2001, p. 15-16). Voir aussi Steven Shiffrin, « The First Amendment and Economic Regulation: Away From a General Theory of the First Amendment », Northwestern University Law Review, vol.78, no 5, 1983.
- Citizens United v. FEC, 558 U.S. (2010), p. 339.
- Ibid., p. 364.
- Ibid., p. 349-350.
- Ibid., p. 356.
- Ibid., p. 354.
- Ibid., p. 364.
- Ibid., p. 339-340, 349-350, 353 et 356.
- Ibid., p. 339.
- Ibid., p. 353.
- Ibid., p. 356.
- Ibid., p. 356, 354 et 355.
- Ibid., p. 354.
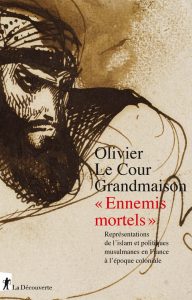 Olivier Le Cour Grandmaison, « Ennemis mortels ». Représentations de l’islam et politiques musulmanes en France à l’époque coloniale, La Découverte, 2019.
Olivier Le Cour Grandmaison, « Ennemis mortels ». Représentations de l’islam et politiques musulmanes en France à l’époque coloniale, La Découverte, 2019.