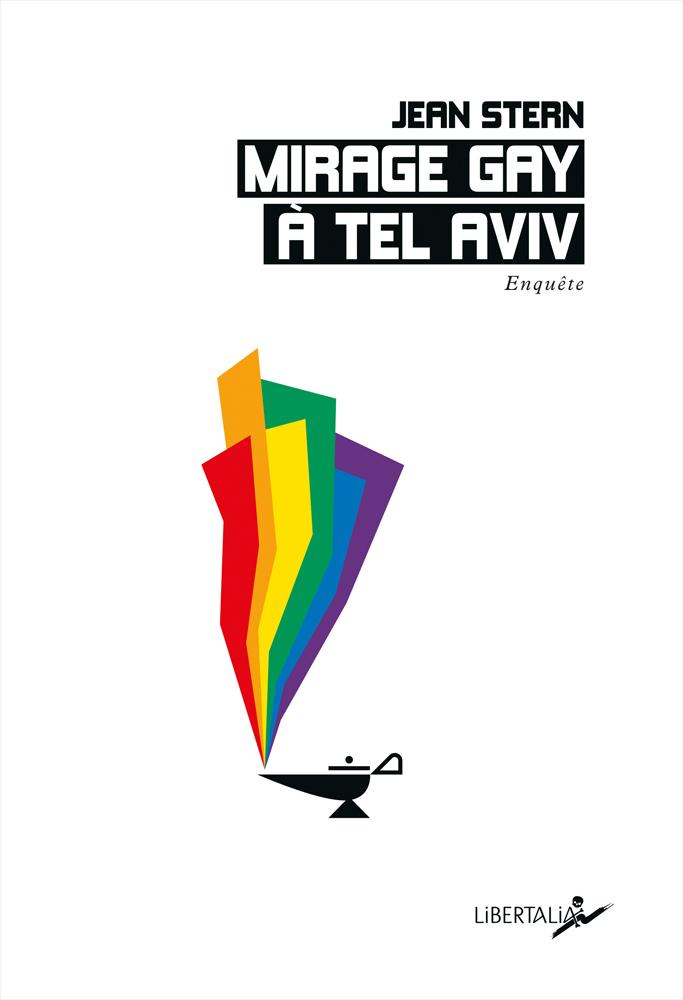Yuri Slezkine, La Maison éternelle. Une saga de la révolution russe. La Découverte, Paris, octobre 2017.
C’est un pavé de 1300 pages – appendice et notes comprises. On pourrait le penser lassant. Je ne dirai pas, reprenant l’expression courante, qu’il se lit « comme un roman ». Au contraire, comme on fait précéder certaines séquences audiovisuelles de la mention « attention, certaines images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs », il faudrait avertir les lectrices et lecteurs de cette saga que certains de ses épisodes sont particulièrement gore (je pense, entre autres, aux campages contre les Cosaques, à la « dékoulakisation » des campagnes et aux grandes purges staliniennes). Mais on aurait tort de passer à côté de ce « chef-d’œuvre ». J’utilise ici des guillemets pour signifier que j’entends le terme au sens où l’entendent les artisans compagnons du Tour de France, dont la formation doit s’achever par la fabrication d’un objet techniquement « parfait ». J’avoue avoir parfois ressenti un certain malaise devant ces chefs-d’œuvre magnifiques dont l’utilité ne saute pas toujours aux yeux. Il y a un peu de cela dans le livre de Slezkine. Il est réellement « parfait » dans sa construction, bien adaptée au choix de son objet. Pour le dire vite, il s’agit d’écrire l’histoire de la révolution russe à travers celle de la « Maison du Gouvernement », bâtie non loin du Kremlin entre 1928 et 1931 afin de loger les dirigeants du nouvel État socialiste et de son économie entièrement nationalisée (seuls quelques-uns, de rang encore supérieur, habitaient au Kremlin, sous l’œil vigilant du petit père des peuples). « La Maison du Gouvernement était concue comme une espèce de compromis historique, un édifice “de type transitionnel”. À mi-chemin entre l’individualisme bourgeois et le collectivisme communiste, elle incluait 550 appartements familiaux entièrement meublés et une série d’espaces publics, dont entre autres un réfectoire, une épicerie, un centre de soins, une garderie, un salon de coiffure, un bureau de poste, un central télégraphique, une banque, un gymnase, une bibliothèque, un court de tennis et des dizaines de salles communes accueillant diverses activités (du billard au tir à la cible en passant par la peinture et les salles de musique). Le tout était couronné […] par le Nouveau Théâtre d’État, qui pouvait accueillir 1 300 spectateurs et […] par le cinéma Oudarnik (“Ouvrier de choc”) avec ses 1 500 places. […] En 1935, la Maison du Gouvernement abritait 2 655 locataires enregistrés. Environ 700 d’entre eux étaient des fonctionnaires de l’État et du Parti bénéficiant d’un appartement individuel. Les autres étaient pour la plupart des personnes à leur charge, dont 588 enfants. Les services aux résidents et l’entretien de l’édifice étaient assurés par 600 à 800 serveurs, peintres, jardiniers, plombiers, concierges, blanchisseuses, polisseurs de planchers et autres employés (dont 57 administrateurs). La Maison du Gouvernement était le domaine privé de l’avant-garde, une forteresse protégée par des portes de métal et des gardes armés, un dortoir où les grands commis de l’État assumaient leurs rôles de maris, d’épouses, de parents et de voisins. Foyer des révolutionnaires, elle était aussi la chambre mortuaire de la révolution. » Ce que la « patrie du socialisme » fut à la révolution mondiale, la Maison du Gouvernement le fut aux bolcheviks, en quelque sorte.
Slezkine a composé son récit à partir de « trois grandes trames narratives ». La première est une « saga familiale qui implique nombre de résidents connus ou anonymes de la Maison du Gouvernement » ; un appendice présente près de 70 minibiographies de ces résidents : c’est d’eux et de leurs proches (parents, épouses, amantes, enfants) dont il est question tout au long du livre, c’est-à-dire d’un « échantillon » assez représentatif des locataires de la Maison du Gouvernement (qui faisaient partie, au premier chef, de ce que l’on a appelé la « nomenklatura »).
« La deuxième trame est analytique » : Slezkine décrit les bolcheviks « comme membres d’une secte millénariste se préparant à l’apocalypse ». Leur histoire, selon lui, est celle « d’une prophétie vouée à l’échec, laquelle semble d’abord s’accomplir avant de déboucher sur une grande déception, sur une série d’ajournements, puis sur l’offre désespérée d’un ultime sacrifice ». Ce parti-pris peut choquer au premier abord, mais il s’avère bien étayé et pour tout dire assez pertinent dès lors que son auteur l’expose plus en détails dans les chapitres 2 : « Les prédicateurs » et 3 : « La foi ». Au tournant du xxe siècle, la Russie en crise baignait dans une atmospère millénariste : « La plupart des prophètes du Grand Jour étaient chrétiens ou socialistes. La majorité des chrétiens continuaient à concevoir la “Seconde venue du Christ” comme la métaphore d’un événement sans cesse reporté, mais une minorité croissante, y compris quelques intellectuels décadents et les protestants évangéliques, de plus en plus nombreux en Russie, espéraient assister au Jugement dernier au cours de leur existence. Cette croyance était partagée par ceux qui associaient Babylone au capitalisme et attendaient avec impatience une révolution violente suivie de l’instauration du règne de la justice sociale. »
Enfin, la troisième trame est littéraire. Le titre lui-même, La Maison éternelle, est tiré d’une nouvelle d’Andreï Platonov publiée en 1929 par la revue Octobre : Makar pris de doute. Makar est un paysan, un personnage qui s’apparente à celui du « brave soldat Schvéik » et dont la naïveté et la simplicité révèlent en creux les absurdités du monde auquel il a affaire. Il n’est « pas en mesure de penser, ayant une tête vide sur des mains intelligentes ». Après quelques démêlés avec le camarade Lev Tchoumovoï, chef du village qui, lui, « en a dans la tête, mais [dont] les mains sont vides », Makar s’en vient à Moscou, « la ville des miracles de la science et de la technique ». Il se met en quête du centre, cherchant « une perche avec un drapeau rouge, qui devait indiquer le milieu du centre-ville et le centre de l’État, mais il n’y avait pas trace de perche de ce genre. Par contre, il trouva une pierre avec une inscription. Il s’y appuya, afin de passer un petit moment en plein centre et de se pénétrer de respect envers lui-même et son État. Il poussa un soupir heureux et sentit qu’il avait faim. Aussi s’en alla-t-il vers la rivière, et il aperçut un chantier autour d’une maison prodigieuse. Qu’est-ce qu’on construit ici ? demanda-t-il à un passant. — Une maison éternelle de fer, de béton, d’acier et de vitres claires ! répondit le passant. »
Les « trésors de la littérature mondiale » et l’écrit en général tenaient une place très importante dans la formation intellectuelle des « Vieux Bolcheviks » (c’est-à-dire des plus anciens membres du Parti, ceux de la génération qui mena la révolution d’Octobre – il existait d’ailleurs une association officielle des Vieux Bolcheviks ; en faire partie donnait droit à un certain nombres de privilèges), et aussi de leurs enfants. Ainsi Slezkine entremêle-t-il au récit de nombreux extrait d’œuvres littéraires soviétiques et, en plus des archives et des témoignages personnels, il a pu aussi s’appuyer sur quelques-uns des journaux intimes tenus par les résidents de la Maison du Gouvernement.
La Maison éternelle est divisé en trois parties. Le livre I, « En route », suit les Vieux Bolcheviks à l’époque de leur jeunesse, avant et pendant la révolution. Le livre II, « À la maison », les voit engagés dans la « construction du socialisme » à travers le premier plan quinquennal et l’édification de la Maison du Gouvernement où ils vont s’installer. Le communisme n’est pas encore là mais il ne saurait tarder, à condition que « l’infrastructure » (entendez : l’industrialisation) en soit achevée. Le livre III, « Au tribunal », raconte les purges successives qui décimèrent les Vieux Bolcheviks, un seul restant au-dessus de tout soupçon : le camarade Staline.
Comme je l’ai dit, l’auteur fait preuve d’une certaine virtuosité dans l’accomplissement de son projet. On peut néanmoins émettre une réserve par rapport au sous-titre du livre : Une saga de la révolution russe. En effet, même si l’article indéfini le relativise un peu, il reste tout de même abusif de parler de la « révolution russe » alors qu’il s’agit, comme le dit par ailleurs très bien Slezkine, de la saga familiale de quelques dizaines de révolutionnaires (d’ailleurs pas seulement russes, mais de différentes nationalités de l’ancien empire tsariste). Ancien éditeur moi-même, je crois deviner ce qui a motivé cette (bénigne) tromperie sur la marchandise : Une saga des Vieux Bolcheviks aurait probablement été moins vendeuse. Reste que La Maison éternelle vaut la peine d’être lu. Afin de soutenir cette affirmation, je ne chercherai pas à le résumer, encore moins à le synthétiser, mais je procéderai à coups de sonde, tâchant ainsi de donner un aperçu de la richesse de son contenu.
Le chapitre 9 porte le même titre que le livre : La Maison éternelle. Je l’ai trouvé particulièrement passionnant en ce qu’il rapporte les débats du début des années 1930 sur la question du logement. Comment construire le socialisme ? Ou : quels types de logements construire afin de préparer l’abolition complète de la propriété privée et de la famille, conditions sine qua non de l’avènement du communisme ? Deux lignes principales s’opposaient. Il y avait les partisans d’un type d’habitat que l’on pourrait dire « en ruche », combinant des cellules individuelles composées d’une seule chambre à coucher et « un réseau public de réfectoires, de crèches, d’écoles maternelles, de pensionnats, de blanchisseries et d’ateliers de couture ». « Le projet le plus populaire imaginait des “cités agro-industrielles” bâties autour de “centres de production” et consistant en plusieurs “maisons communales” ou “conglomérats industriels” accueillant chacun de 20 000 à 30 000 résidents adultes. » Face aux promoteurs de ce courant se dressaient les « désurbanistes » qui critiquaient le principe même de la ville et de sa fatale séparation d’avec la campagne. Combler ce fossé « et créer […] de nouvelles manières d’habiter qui seront les mêmes pour tout le monde (à savoir une répartition socialiste uniforme des populations de travailleurs) » était selon l’un de ces désurbanistes « le rôle historique sans précédent qui incombe à notre pays, à notre Union (extrait d’un texte de 1930) ». Cependant, les deux courants s’accordaient pour dénoncer « l’idéologie bourgeoise […] encore si forte chez certains membres du Parti qu’ils continuent à inventer, avec un zèle qui mériterait une meilleure cause, de nouveaux arguments pour conserver le lit double en tant que meuble permanent et obligatoire d’un logement prolétarien. » Et les partisans des deux thèses opposées partageaient l’idée que ce n’étaient pas de simples bâtiments qu’il fallait édifier, mais de nouveaux rapports sociaux – avec, pour corollaire, l’arrogance typique des architectes qui prétendent pouvoir changer la vie des gens grâce à leur planche à dessin. Mais en 1930, l’heure était passée des projets utopiques. Selon le Comité central, ces projets étaient même « extrêmement nuisibles » car ils supposaient que l’on pourrait « surmonter “d’un bond” les obstacles existant sur la voie de la transformation socialiste de la vie quotidienne, lesquels [avaie]nt pour origine, d’une part, l’arriération économique et culturelle du pays et, d’autre part, la nécessité […] de mobiliser toutes les ressources disponibles pour industrialiser le pays le plus rapidement possible, seule manière de créer les conditions matérielles d’une transformation de la vie quotidienne. » Et c’est ainsi que la Maison du gouvernement, dont la conception datait de 1927, présentait certains aspects hérités de la période utopique – son gigantisme, son suréquipement en espaces publics de services et de loisirs (clubs divers et variés, terrains de sport, théâtre, cinéma, etc.) – mais aussi des caractéristiques qui lui valurent des critiques acerbes d’architectes qui n’avaient pas encore pris le virage de la « pause » dans la collectivisation : « Le secteur résidentiel de ce complexe se compose exclusivement d’appartements faits pour répondre à l’économie familiale et à la satisfaction individuelle des besoins familiaux, c’est-à-dire à une vie familiale autonome et circonscrite (les appartements ont leurs propres cuisines, leurs propres baignoires, etc. [Il s’agit] d’une interprétation erronée de l’idée de maison communale, qui aboutit à ajourner, voire à discréditer, l’introduction de nouveaux rapports sociaux parmi les masses. [Souligné dans le texte] » Il est vrai que sur ce dernier point, ce n’était pas l’équipement des cuisines du nouvel ensemble, qui comprenait une gazinière, un vide-ordures, un ventilateur d’extraction et un lit pliant pour la bonne (souligné par moi), qui pouvait préfigurer en quoi que ce soit le communisme futur. En fait, les membres de la nomenklatura avaient le beurre et l’argent du beurre : les équipement collectifs et le confort privé. Ils bénéficiaient par ailleurs d’autres lieux de confort à eux réservés – les datchas autour de Moscou, les lieux de repos et de soin en Crimée et ailleurs, etc. Ainsi, atteindre l’objectif d’en finir avec les inégalités sociales passait, semble-t-il, par une perpétuation, voire un renforcement de ces mêmes inégalités.
Autre objectif lointain, le dépérissement de l’État passait lui aussi par son contraire : le renforcement sans précédent de l’État, à travers la « collectivisation » (ou plutôt : l’étatisation) de toute l’économie, le contrôle et l’encadrement de tout type d’activité s’exerçant hors espace privé et la prolifération monstrueuse de l’appareil policier. Les camarades résidents de la Maison du Gouvernement y participèrent activement. La « terreur rouge » fut mise officiellement à l’ordre du jour dès l’été 1918, après l’assassinat d’un responsable de la Tcheka (police secrète) de Petrograd et, le même jour, un attentat contre Lénine qui fut blessé par balles lors d’un meeting. Mais le contexte de guerre civile qui suivit Octobre, ainsi que les déclarations effrayantes du même Lénine l’avaient déjà justifiée d’avance. Slezkine cite par exemple cet extrait d’un texte de 1917 sur la révolution qui devrait « débarrasser la terre russe de tous les insectes nuisibles, des puces (les filous), des punaises (les riches) et ainsi de suite[1] ». Lénine y parle de la diversité des moyens à employer contre les « insectes nuisibles » – il s’agit entre autres d’emprisonnement, de contrôle social renforcé, d’affectation au « nettoyage des latrines », « ou encore, on fusillera sur place un individu sur dix coupables de parasitisme ». Boukharine lui non plus n’y allait pas de main morte avec les ennemis de la révolution. Ainsi (un peu plus tard, en 1920), dans Économique de la période de transition, où il définit neuf catégories d’ennemis « extérieurs » (au prolétariat révolutionnaire) il n’hésite pas à parler de « Vendée des koulaks » (les paysans riches) contre laquelle doit s’exercer la « violence concentrée du prolétariat[2] ». Ces résolutions furent hélas mises en pratique à grande échelle, et cela en grande partie sous la supervision de résidents de la « maison éternelle ». L’un des tout premiers groupes, sinon le premier, sur lequel s’abattit une répression féroce fut celui des Cosaques du Don. Coupables d’avoir servi le tzar en tant que guerriers paysans montant la garde aux marches de l’Empire, mais aussi sur les fronts extérieurs et dans la répression interne en tant qu’unités de cavalerie, les cosaques étaient éminemment dangereux aux yeux des bolcheviks. « Qui d’autre, demandait Staline en 1919, pourrait devenir le bastion de la contre-révolution de Denikine et Kolchak [deux généraux « blancs »], sinon les cosaques – ces instruments séculaires de l’impérialisme russe, qui jouissent de privilèges spéciaux, sont organisés en société militaire et ont longtemps exploité les peuples non russes des zones frontières ? » Effectivement, une partie des cosaques se rebella contre les bolcheviks dès 1918. Ils déchaînèrent une terreur blanche contre les paysans du Don qui n’étaient pas cosaques, les traitant de bolcheviks, et contre les Cosaques du Don probolcheviks (environ 20% des cosaques en armes). La riposte des bolcheviks fut à la hauteur : « la seule stratégie correcte », disait un rapport de l’Orgburo, à la tête de la contre-offensive, « est une lutte sans merci contre toute l’élite cosaque qui passe par son extermination totale ». De plus, les responsables locaux du parti avaient tendance à interpréter les consignes de Moscou de façon encore plus rigoureuse. C’est ainsi que l’un d’entre eux put ordonner l’« extermination d’un pourcentage à définir de la totalité de la population masculine ». Slezkine cite des témoignages faisant état de massacres de plusieurs dizaines de personnes par jour, y compris des vieillards incapables de porter les armes, décidés par les tribunaux révolutionnaires locaux.
Je n’ai pas très envie de m’étendre longuement sur les crimes perpétrés sous la direction des habitants de la Maison du Gouvernement, telles les campagnes de collectivisation et de réquisition des récoltes qui entraînèrent des millions de morts, particulièrement en Ukraine et au Kazakhstan. Mais tout le zèle déployé par leurs auteurs ne suffit pas à les sauver lorsque vint le temps des grandes purges. Le 1er décembre 1934 on apprit l’assassinat de Kirov, secrétaire du Parti de la région de Leningrad. Ce fut le prélude à ce que l’on a appelé les « procès de Moscou », une nouvelle version de la grande chasse aux sorcières qu’avait connue l’Europe occidentale à l’aube de la modernité. Des centaines de milliers de Soviétiques, depuis les plus hauts responsables du Parti jusqu’à de simples villageois, furent emprisonnés, déportés, fusillés. Une très grande majorité d’entre eux reconnurent leur culpabilité : ils n’avaient pas été assez dévoués au Parti et à son guide suprême, favorisant ainsi les menées criminelles de conspirateurs antisoviétiques agissant dans l’ombre et, bien sûr, soutenus par les fascistes et les impérialistes… la crise dura quatre ans, emportant la plupart des Vieux Bolcheviks, à commencer par Boukharine, éliminé par la même logique que celle qui avait guidé sa dénonciation, citée plus haut, des ennemis de la révolution, et donc la plupart des résidents de la Maison du Gouvernement. Je me contenterai de citer ici ce que déclara Boukharine à la fin de son procès, le 13 mars 1938, car cette déclaration est assez emblématique de toutes celles que firent les innombrables « déclarés coupables » au cours de cette interminable et sinistre mascarade :
« Je me tiens à genoux devant le pays, devant le Parti, devant le peuple tout entier. La monstruosité de mes crimes n’a pas de bornes, surtout dans cette nouvelle étape de la lutte de l’URSS. Puisse ce procès être la dernière et pénible leçon, et que tout le monde voie que la thèse contre-révolutionnaire de l’étroitesse nationale de l’URSS demeure suspendue en l’air comme une misérable chiffe. Tout le monde voit la sage direction du pays, assurée par Staline. C’est avec ce sentiment que j’attends le verdict. La question n’est pas dans les tribulations personnelles d’un ennemi repenti, mais dans l’épanouissement de l’URSS, dans son importance internationale. »
Les grandes purges prirent fin en novembre 1938, d’un jour à l’autre, non sans que Staline n’ait fait incarcérer puis liquider tous ceux qui les avaient dirigées. Zletkine termine son livre en décrivant quelles furent les destinées de quelques-un·e·s des enfants des camarades disparus au cours de l’orgie stalinienne. Ces enfants, qui avaient grandi dans la maison du Gouvernement, poursuivirent leurs études puis leur vie professionnelle avec des fortunes diverses. Mais il semble bien que l’un de leurs points communs fut le partage d’une certaine incompréhension vis-à-vis de leurs parents qui, soient étaient morts, soit, lorsqu’ils revinrent des camps, étaient brisés moralement. Cette histoire était trop lourde à porter pour les enfants qui, pour la plupart, s’en détournèrent afin de vivre leur propre vie.
Il faut bien sûr mentionner encore l’épilogue de La Maison éternelle, consacré à l’œuvre de l’écrivain Iouri Trifonov, qui grandit dans cette maison qu’il mit en scène ensuite dans l’un de ses romans les plus connus, La Maison du Quai. Le père de Youri, Valentin Andreïevitch Trifonov, avait été commissaire du corps expéditionnaire spécial dans la région du Don en 1919 ; président du Collège militaire de la Cour suprême soviétique ; attaché militaire adjoint en Chine ; représentant commercial en Finlande ; président de la Commission centrale des concessions étrangères au Conseil des commissaires du peuple. Il occupait avec sa famille l’appartement 137 de la Maison du Gouvernement. Il fut arrêté le 21 juin 1937. Quelques jours auparavant, en tant que spécialiste des affaires militaires, il avait envoyé le manuscrit de son dernier travail, Les Contours de la guerre à venir, à Staline et à plusieurs autres membres du Politburo, sans reçevoir de réponse.
Pour conclure, je devrais insister sur quelque chose que cette recension n’a pas pu, pas su mettre vraiment en exergue : le fait que toute l’histoire (celle de la révolution russe puis de L’URSS d’avant la Seconde Guerre mondiale, en gros) que décrit Slezkine passe systématiquement par les histoires des habitants de la Maison du Gouvernement. Et cela la rend sinon facile à lire, du moins lisible, ce qu’elle n’aurait pas été s’il s’était borné à écrire une sorte de procès-verbal des événements comme certains livres d’histoire s’en contentent. D’autre part, comme je l’ai dit au début, cette histoire est mise en perspective grâce à la littérature produite par ses protagonistes (à commencer par Platonov et Trifonov). Il faut encore ajouter à cela que l’auteur a aussi cherché à resituer les différents épisodes de cette saga dans l’histoire universelle, en essayant de les comparer à d’autres événements survenus ailleurs dans le monde et à d’autres époques. Cet effort de comparaison et de mise en perspective rend sinon plus compréhensible, du moins un peu moins étrange à nos yeux cette tragédie que fut la révolution russe à partir de sa confiscation par les bolcheviks. C’est pourquoi cette somme me semble vraiment très utile, intéressante, et pleine de résonances pour qui a vécu ou vivra des expériences collectives avec des aspirations communalistes, communisantes, communistes.
franz himmelbauer, le 15 octobre 2017.
[1] Texte à lire ici : https://www.marxists.org/francais/lenin/works/1917/12/vil19171227.htm
[2] http://fr.calameo.com/read/00072687847e5f531c37d