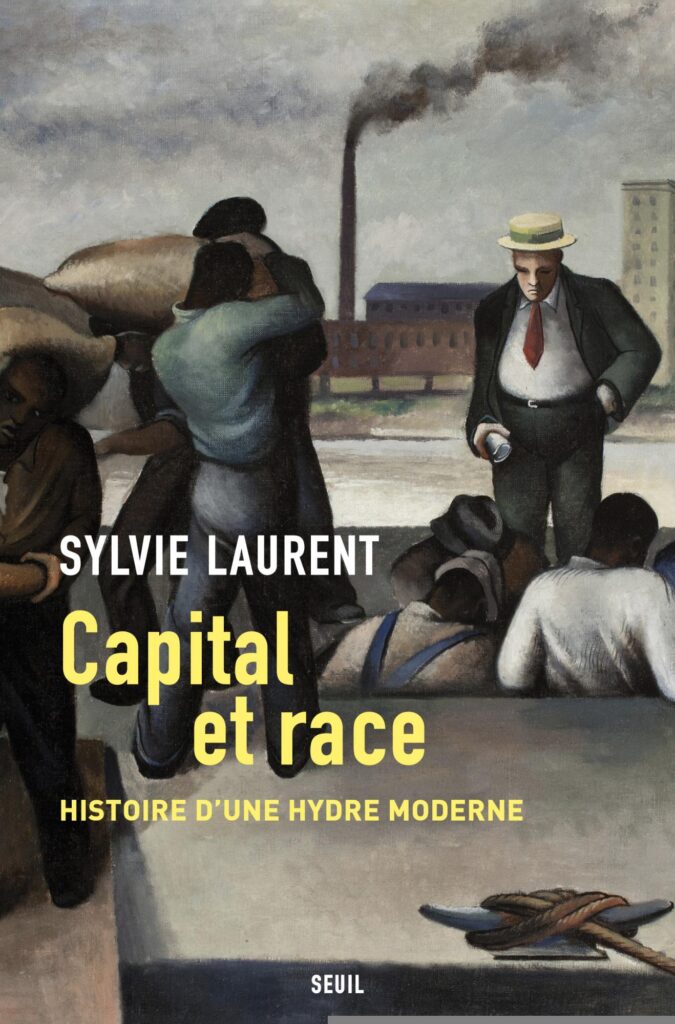 Sylvie Laurent, Capital et Race. Histoire d’une hydre moderne, Seuil, 2024
Sylvie Laurent, Capital et Race. Histoire d’une hydre moderne, Seuil, 2024
Un peu plus de 500 pages grand format, 70 de notes dont quasiment chacune donne une ou plusieurs références à d’autres ouvrages et/ou articles, voici un livre touffu, c’est le moins que l’on puisse dire. Cela ne devrait pas effrayer les lecteurs/trices : je donne ces chiffres non pour les intimider, encore moins pour me vanter du fait d’avoir surmonté cette difficulté, non, plutôt pour avertir que cette note n’offrira, une fois de plus, qu’un aperçu du texte. On attribuera cette brièveté soit à une certaine insuffisance intellectuelle de ma part, soit tout simplement à la difficulté de l’exercice – quoi qu’il en soit, je recommande d’ores et déjà chaudement la lecture de ce livre, rédigé dans un style clair, précis et très accessible. Il y est question du nouage étroit entre race et capital, bien représenté par la figure de l’hydre. On voit bien qu’il s’agit d’une question toujours brûlante aujourd’hui, ne serait-ce qu’à travers le génocide en cours à Gaza, sans parler bien sûr du racisme qui ravage les sociétés soi-disant postcoloniales, comme on a pu le constater encore cette semaine[1] en France, avec l’escalade de la censure contre LFI, depuis le refus de l’université de Lille d’accueillir une réunion de soutien aux Palestinien·ne·s jusqu’à la convocation par la police judiciaire, au motif « d’apologie du terrorisme », de celle qui devait en être la principale intervenante, en passant par l’oukase de la Préfecture du Nord interdisant carrément cette même réunion au prétexte du risque de « trouble à l’ordre public »…
Pas de commerce africain, pas de nègres ; pas de nègres, de sucre d’épices ou d’indigo…Pas d’îles, pas de terres, pas de terres, pas de commerce. Aimé Césaire[2]
Le nouage entre race et capital s’effectue en des temps et des lieux bien précis, même si ces temps s’étalent sur de longues durées et si ces lieux tendent à s’étendre tout autour de la planète, en une première mondialisation. C’est à l’évidence une des principales leçons de ce livre : le capital (et le capitalisme), comme la race (et le racisme) sont des phénomènes historiques, dont l’un des points communs a toujours été la prétention à se faire passer pour des donnés « naturels » aussi bien qu’intemporels.
Sylvie Laurent situe leur date de naissance gémellaire en 1492. Comme on sait, Christophe Colomb, un marchand génois mandaté par la Couronne de Castille et Aragon, laquelle vient tout juste d’achever la mal nommée Reconquista – une conquête tout court, évidemment – marquée par la chute, cette même année, de Grenade, dernier bastion aux mains des Maures, Colomb, donc, à la recherche d’une route directe vers les Indes, les « découvre » finalement. Que cherchait-il en vérité ? Des épices et de l’or, surtout de l’or. Moyennant quoi il a abordé les rivages d’une île que ses habitants, les Taïnos, nomment Ayiti. Avant l’arrivée du « découvreur » et de ses sbires, ces aborigènes
se comptaient par centaines de milliers, peut-être-même étaient-ils plus d’un million. En 1514, après vingt-cinq ans de travail forcé, de guerre et de destruction, il [en] demeure à peine plus de 30 000. […] Les Arawaks [groupe ethnique dont faisaient partie les Taïnos, et qui peuplaient les Grandes Antilles] disparaîtront définitivement un siècle plus tard […]. Ces décimations furent causées par les deux logiques structurantes de ce premier capitalisme colonial : l’extraction des ressources de la terre par la dépossession et l’extirpation de l’énergie humaine nécessaire par la violence disciplinaire et la négation de la souveraineté des indigènes sur leurs corps. Ce sont elles, avant la variole ou la rougeole, qui provoquèrent l’extinction des Taïnos.
[…] L’esclavage et l’accaparement des terres s’inscrivent alors comme une nécessité historique de l’Amérique. Inventée par l’Europe, cette terre inaugure une géohistoire inédite fondée sur un commerce total, transatlantique, puis mondial, qui réclame une nouvelle grammaire de la valeur du monde et une nouvelle conception de l’habitation de la terre. Désormais, il faut mettre la terre et ses créatures au travail et ne les envisager qu’au prisme de profits futurs. (R&C p. 32-33)
Naissance du capital (comme rapport « social », si l’on peut dire), donc. On voit bien que dès son apparition celui-ci hiérarchise de fait les humains (entre « civilisés » et « sauvages ») et pratique ainsi ce que nous nommerons plus tard la racialisation et, partant, le racisme. Cependant, si l’on peut dater de cette même annus horribilis[3] la naissance « officielle » de la race (au risque de l’anachronisme car, si je ne le trompe pas, on n’utilisait pas ce mot à ce moment-là), c’est parce que les souverains espagnols, Isabelle et Ferdinand (que leur nom soit maudit pour les siècles des siècles !) expulsent les juifs de leur royaume de Castille et Aragon, inaugurant la sinistre politique de la limpieza de sangre, la « pureté du sang ». On avait donné aux juifs et aux musulmans la possibilité de se convertir au catholicisme faute de quoi, ils étaient déclarés persona non grata dans le royaume. Seulement, toute une politique des « statuts de la pureté de sang » se développa par la suite, soupçonnant les « nouveaux chrétiens » de ne l’être pas vraiment et de continuer à pratiquer leur culte originel en secret. Pire, ces soupçons se reproduisirent contre les générations suivantes… Ainsi les gènes des religions hébraïque et musulmane étaient-ils censés se transmettre de père (et de mère) en fils (et en fille)… Un concept promis à un bel avenir, en Amérique avec la on-drop rule (règle de l’unique goutte de sang – noir évidemment – qui vous ôtait la qualité de Blanc), puis sous le IIIe Reich (Hitler était un grand admirateur des théories suprémacistes blanches des États-Unis), l’Afrique du Sud de l’apartheid et pour finir (mais je n’ai cité ici que les exemples les plus saillants, on aurait aussi bien pu y ajouter la France coloniale, puis celle de Vichy et enfin celle d’aujourd’hui, ses contrôles au faciès et ses violences policières à l’encontre des personnes racisées), l’État d’Israël, qui ne reconnaît que les juifs comme ses citoyens.
Dès avant ces scènes inaugurales (entre péninsule ibérique et « Indes occidentales ») intervient un autre fait capital (si je puis me permettre) : l’invention de la plantation. Ici, je me permets de m’éloigner un peu du livre de Sylvie Laurent (mais aucunement pour exprimer un désaccord) et de convoquer celui d’Aurélia Michel, Un monde en nègre et blanc, dont j’ai déjà eu l’occasion de dire tout le bien que j’en pense – mais auquel je n’ai pas encore consacré une « vraie » note de lecture. En 1471, dit-elle, les Portugais (la grande puissance maritime de l’époque) occupent un petit archipel au large du Gabon, qu’ils baptisent São Tomé. Jusqu’alors, ils achetaient des esclaves sur la côte du Gabon, voire plus au sud vers l’actuel Angola, en vue de les revendre aux marchands d’Afrique de l’Ouest en échange d’or qui était l’objet principal de leur convoitise dans la région.
Mais la prise de São Tomé fait évoluer ce schéma. Les navires portugais l’utilisent d’abord comme une étape de navigation, notamment pour l’achat d’esclaves, qu’ils revendent ensuite plus au nord. Et ainsi va surgir un « coup de génie » promis à un destin fracassant : les premiers colons venus du Portugal […] y sont sommés de produire du sucre, car le roi souhaite prolonger la bonne expérience de Madère qui pouvait déjà en exporter 2 500 tonnes par an. Pour cela, les Portugais vont utiliser sur les plantations de São Tomé les esclaves qu’ils achètent en Angola et au Gabon. L’entreprise tient très bien ses promesses et la production de sucre à São Tomé, en 1488, égale déjà celle de Madère. Elle la surpasse même rapidement, si bien que le Portugal devient un gros importateur de sucre en Europe[4].
Ce qui vient de s’inventer là est tout simplement l’économie moderne – le capitalisme dans toute sa hideur, qui va s’épanouir ensuite aux Amériques dans les grandes largeurs. On débarque quelque part, on élimine les « naturels », comme on disait à l’époque, et on les remplace par de la main d’œuvre servile importée afin d’extraire et/ou de transformer les matières premières dont on a besoin, naturellement sans aucune considération pour les écosystèmes que l’on dévaste au passage. « On pourrait comparer cette innovation, écrit encore Aurélia Michel, à celle de la délocalisation du travail par les firmes transnationales, telle qu’elle s’est inventée dans le capitalisme de la fin du XXe siècle : la mise en place de quelques conventions internationales et la possibilité de réunir les conditions de production les plus rentables n’importe où dans le monde » (AM, p. 83).
Selon Sylvie Laurent (qui raconte aussi cette histoire de São Tomé, d’une manière un peu différente mais tout aussi intéressante), la plantation est l’une des institutions cardinales du développement siamois du capital et de la race. Elle en mentionne trois autres, en autant de chapitres : l’Académie, la multinationale et le contrat colonial.
L’Académie produit les discours humanistes qui accompagnent et recouvrent l’horreur de la traite et de l’esclavage. Quelqu’un comme Louis Sala-Molins (entre autres) avait déjà étudié le sujet[5]. Mais au fond, le plus intéressant dans ce chapitre, c’est l’image que les intellectuels européens produisent d’eux-mêmes et de l’Europe – de la civilisation, qui se dit à l’époque seulement au singulier –en reflet de ce qu’ils racontent sur les « nègres » et autres « sauvages ». En effet, commence à apparaître ici le discours du progrès et de la civilisation par le « doux commerce », qui s’épanouira un peu plus tard. Le pompon à cette vieille crapule de Voltaire qui, tout en déplorant les « excès » subis par la main d’œuvre servile (célèbre phrase d’un « nègre du Surinam » dans Candide, alors que celui-ci est stupéfié par la violence coloniale néerlandaise – pas française, hein ! : « C’est à ce prix-là que vous mangez du sucre en Europe ») ne manque pas d’investir dans le commerce infâme du « bois d’ébène », et pas qu’un peu. Il travaille avec la Compagnie des Indes orientales, qui détenait alors en France le monopole sur la traite négrière :
En cinq ans, il aurait financé plus de quarante expéditions, un investissement de 400 000 livres qui aurait représenté près de la moitié de ses dépenses totales. On estime que la marge de profit de la Compagnie en ces années dépasse les 15%. Les bénéfices du philosophe sont donc solides (C&R p. 136).
La multinationale, ou plutôt les multinationales de l’époque, ce sont justement ces « compagnies à charte » qui bénéficient d’un monopole exclusif accordé par les autorités royales de leur pays. On pourrait évoquer à leur propos les juteux « partenariats public-privé » d’aujourd’hui : tandis que l’État leur accordait tous les moyens de faire du profit sans restriction (monopole, réglementation de l’esclavage, possibilité de s’armer pour faire la police partout où elles s’implantaient et souvent même, gouvernement des colonies ou des comptoirs), elles levaient des fonds dans le privé (cf. Voltaire ci-dessus) pour financer leurs activités criminelles. Il me semble avoir parlé ici-même il n’y a pas si longtemps des zones franches du Sud global où les transnationales d’aujourd’hui font à peu près ce qu’elles veulent[6] : le savoir-faire du capital s’est bien transmis, merci pour elles !
Le contrat colonial… Pour résumer, je dirai : « Pile je gagne, face tu perds. » Il y a des gens qui habitent sur la terre que je convoite ? Pas très grave, me répond Locke (1632-1704). Le philosophe anglais explique en effet que ce qui compte, pour établir un droit de propriété, c’est l’établissement d’une souveraineté sur la terre par sa mise en valeur.
Résolument partisan de la colonisation anglaise de l’Amérique du Nord, Locke justifie la confiscation des terres amérindiennes en raison de ce qu’il juge être une piètre utilisation du sol (ce qui n’était pas le cas), incapable d’être « profitable » au regard de l’agriculture commerciale anglaise. Tel est le principe d’une mise en valeur, au sens littéral : seule importe la « valeur » produite par le travail de la terre grâce à l’improvement, mesurée par la croissance des rendements. Ainsi, loin d’être condamnable, l’accaparement de toute terre « vacante » participe pour Locke du « bien commun »[7]. (C&R, p 156)
C’est bien sûr la suite logique du développement de la plantation – délocalisation des hommes et des productions. Cela me fait penser aussi au processus, décrit par Émilie Hache, du passage d’un monde de la (ré)génération à un monde de la (re)production[8]. À l’évidence, les Amérindiens prenaient soin de leur terre, mais ils ne la mettaient pas en valeur au sens de Locke. Donc, exit les « Indiens » (rappelons que 95% des populations présentes avant la « découverte » avaient disparu au début du XXe siècle. Quelque 55 millions d’entre eux avaient déjà disparu en 1610, date à laquelle on constate une chute notable de la quantité de dioxyde de carbone dans l’atmosphère, due au retour de leurs terres à la forêt. C’est la première fois que les humains modifient par leur action la composition chimique de l’atmosphère, raison pour laquelle certains historiens datent de 1610 le début de l’anthropocène)[9]. Ce thème de la terre vacante, voire de la terre sans hommes, fera florès tout au long du déploiement colonial de l’Occident – jusqu’à son dernier avatar, le sionisme, dont l’un des slogans était : « une terre sans hommes pour des hommes sans terre ».
Le contrat colonial, ce sont encore les Codes noirs.
La « réification juridique » de l’esclave est produite par l’établissement d’un statut juridique transmissible par la mère, établissant la doctrine du Partus sequitur ventrem (déjà en vigueur depuis 1662 dans la colonie américaine de Virginie). Ce principe de transmission matrilinéaire permet non seulement l’organisation sociale de la propriété et de la production, mais elle est le fondement de la reproduction forcée de la main d’œuvre. Toute naissance d’une esclave noire étant la propriété du maître, les naissances à répétition sur la plantation même permettent de limiter les coûts d’importation de la main-d’œuvre. Celle-ci est ainsi rationalisée, et […] la qualité juridique de la condition d’esclave est établie. Même les clauses qui limitent les prévarications des planteurs postulent l’esclave comme « objet et non sujet de droit […] ». (R&C p. 168)
Cette « propriété du maître » fonde le développement capitaliste. Elle lui donne même une base si solide que toutes les abolitions de l’esclavage, désormais célébrées comme de grandes victoires du progrès, de la civilisation et des droits de l’homme, seront payées – et combien ! – par l’indemnisation des maîtres. Après tout, on leur devait bien ça, puisqu’on leur retirait leur propriété – on les spoliait, pour tout dire ! On sait que ces indemnités furent à tel point exorbitantes qu’elles ont maintenu Haïti, où l’abolition, camouflet insupportable pour la bourgeoisie blanche, avait été décrétée par les esclaves eux-mêmes, dans un état de misère totale jusqu’à aujourd’hui[10].
La troisième partie de Capital et race s’intitule Récits. Elle s’ouvre sur une très intéressante analyse de Robinson Crusoé, de Daniel Defoe, « parabole du capitalisme racial » aux yeux de Sylvie Laurent. En fait, ce « premier roman moderne » anglais montre et cache à la fois ce que c’est que le capitalisme – ou plutôt un capitaliste à l’œuvre. Marx ne s’y est pas trompé en parlant de « robinsonnades » qui tendraient à faire croire que l’accumulation primitive pourrait se dérouler sans heurts ni graves problèmes. Même Vendredi, ainsi baptisé par son maître Robinson car il lui est apparu un vendredi, est un esclave consentant, heureux de se confier à la protection du maître et de travailler pour lui, et même de l’assister dans ses combats contre quelques sauvages – cannibales, ceux-là, évidemment ! – qui pourraient pénétrer par effraction la sacro-sainte propriété de l’Empire britannique dont le naufragé Robinson est le digne représentant… Une sorte de storytelling avant l’heure, qui a connu par la suite un succès énorme, parce qu’il définissait le projet colonial tout en escamotant ses côtés les plus sombres.
L’autre ensemble de récits analysés par Sylvie Laurent concerne « l’émancipation par le commerce ». Je ne m’y attarde pas, ayant déjà un peu abordé le sujet plus haut. Pour faire court, il s’agit du discours des « économistes politiques », lesquels, à partir de Montesquieu déjà, parlent du « doux commerce » qui adoucit les mœurs en promouvant des interactions pacifiques entre les peuples. Ce qui, dans le contexte de la traite négrière, nous apparaît aussi crédible que les discours que l’on peut entendre de nos jours et qui nous promettent, dans tel ou tel domaine, des échanges « gagnant-gagnant ». Compte là-dessus et bois de l’eau fraîche, disait ma grand-mère. Cela dit, Sylvie Laurent repère tout de même des nuances entre différents discours. Ainsi, par exemple,
Deux conceptualisations de l’Empire britannique s’opposent : celle de Warren Hastings [premier gouverneur général du Bengale], qui définit la colonisation britannique comme induisant un droit légitime à l’appropriation violente et à la soumission des indigènes, et celle de Hume, qui établit une véritable théorie libérale de l’Empire et la nécessité d’un droit colonial propre. […] Hume demande […] que les indigènes soient reconnus comme des « sujets » de la Couronne, avec statut et droits, plutôt que comme des étrangers sous la tutelle arbitraire de l’entreprise commerciale privée.
Hume oppose ainsi un « Empire du droit » à un domaine du « colonial » régi par la seule loi du plus fort. Et il distingue
les pratiques impériales civiles des « gentlemen capitalistes » de la City, respectueuses du législateur, [de celles des] brutes anglaises des compagnies qui dirigent les colonies aux marges de l’Empire (R&C, p. 226-227).
Good cop, bad cop, capitalisme vertueux et capitalisme sauvage, la distinction fera carrière… Jusqu’à Francis Ford Coppola adaptant à l’écran le roman de Joseph Conrad Au cœur des ténèbres, où l’on voit un colon devenu fou fonder sa propre dictature sanglante « aux marges de l’Empire ». Pareillement, Apocalypse now avait le don de nous faire oublier la réalité de la guerre du Vietnam tout en nous la montrant, grâce à l’accent mis sur des personnages monstrueux – et donc exceptionnels – comme le commandant de l’escadron d’hélicos qui charge au son de la chevauchée des Walkyries et qui ne songe qu’à trouver une vague pour faire du surf, et, bien sûr, comme le « marginal de l’Empire », le colonel Kurz.
La dernière partie du livre, intitulée « Praxis », fait le lien entre ces discours et la pratique, comme son nom l’indique, et suit la piste sanglante qui conduira à l’extermination des juifs d’Europe et qui passe (entre autres) par l’Afrique australe ou les Allemands expérimentèrent leurs premiers camps de concentration et la pratique du génocide (contre les Hereros et les Namas, autrement connus sous le nom d’Hottentos[11]).
Il y a encore beaucoup d’autres choses dans cette dernière partie (et dans l’épilogue qui la suit), mais bon, comme je l’avais promis au début de cette note, je n’ai donné qu’un aperçu de ce livre vraiment passionnant, à la fois par la pertinence de ses analyses étayées par une impressionnante documentation et par une belle capacité de synthèse qui, hélas, me fait défaut pour mieux le résumer. J’espère tout de même que cette première mise en bouche vous ouvrira l’appétit… c’est tout le mal que je vous souhaite.
Ce 21 avril 2024, franz himmelbauer pour Antiopées.
[1] Du 13 au 21 avril 2024.
[2] Cité in Sylvie Laurent, Race et Capital (désormais noté R&C), p. 185.
[3] Isabelle de Castille et Ferdinand d’Aragon la décrétèrent au contraire annus mirabilis…
[4] Aurélia Michel, Un monde en nègre et blanc. Enquête historique sur l’ordre racial, Points/Seuil, 2020, p. 80-81.
[5] Louis Sala-Molins, Le Code Noir ou le calvaire de Canaan, Puf, Quadrige, 2003 [1987].
[6] Voir ma note « Frontières et domination » ici-même, particulièrement la recension du livre d’Harscha Walia.
[7] À ce propos, voir par exemple Roxanne Dunbar-Ortiz, Contre-histoire des États-Unis. Trad. française aux éditions Wildproject. J’en ai parlé dans cette note de lecture.
[8] Ce que la même aussi appelle la logique du remplacement : loin du « grand remplacement » fantasmé par l’extrême droite, il s’agit du corollaire immédiat de la réduction du monde à des quantités mesurables. À partir du moment où tout est comptable avec les mêmes instruments d’abstraction – et avant tout avec la valeur au sens capitaliste du terme –, alors on peut « remplacer » un lieu par un autre, la biodiversité par des monocultures et des sauvages par des esclaves… (Dernier avatar, moins cruel peut-être mais tout aussi catastrophique pour les écosystèmes, la logique de la « compensation » appliquée aux grands chantiers type Notre-Dame des Landes : on détruit une zonz humide ici, pas grave, on en refera une autre ailleurs !) Cf. Émilie Hache, De la génération. Enquête sur sa disparition et son remplacement par la production, Les Empêcheurs de penser en rond, 2024. Voir ma recension ici.
[9] Voir ma recension d’Andreas Malm, L’Anthropocène contre l’histoire. À cela, il faut ajouter aussi que ce génocide des Amérindiens et ses conséquences bioclimatiques font dire à certain·e·s essayistes qu’il vaudrait mieux parler de « Capitalocène » ou même de « Plantationocène ». Cf. Donna Haraway, « Capitalocène, Plantationocène, Chthulucène. Faire des parents », in Multitude n°65, 2016/4, article repris dans Vivre avec le trouble, Les Éditions des mondes à faire, 2020 [2016].
[10] L’histoire de ce scandale absolu a été racontée récemment par le New York Times dans un dossier accessible en ligne : https://www.nytimes.com/fr/2022/05/20/world/haiti-france-dette-reparations.html
[11] Cf. aussi Sven Lindqvist, Exterminez toutes ces brutes (une réplique tirée de Au cœur des ténèbres), éd. le Serpent à plumes, 1999).
