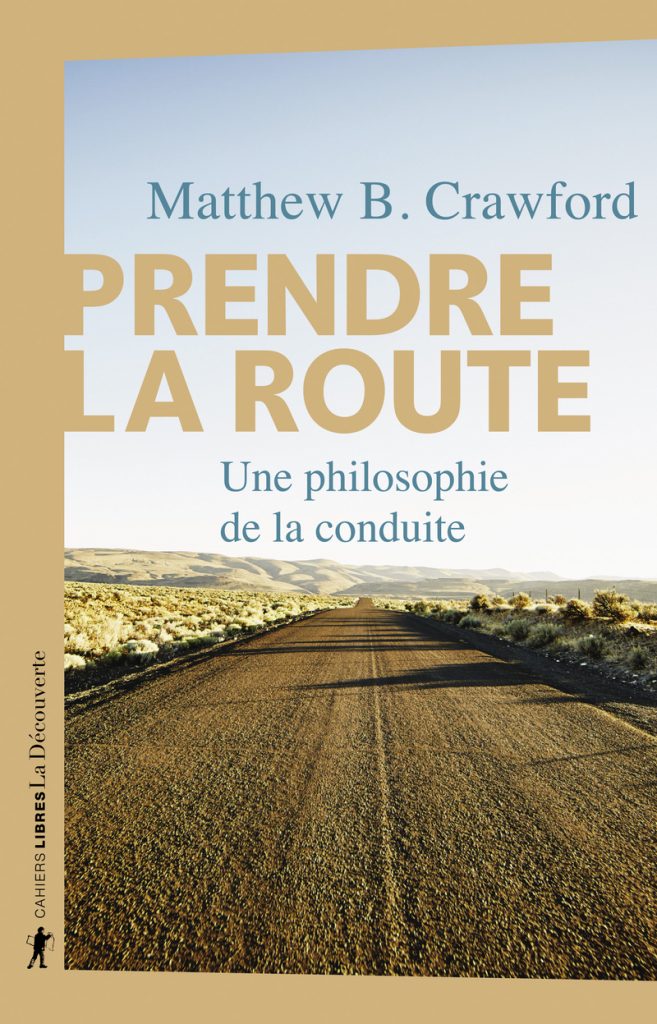 Matthew B. Crawford, Prendre la route. Une Philosophie de la conduite, traduit de l’anglais (États-Unis) par Marc Saint-Upéry et Christophe Jaquet, Paris, La Découverte, mars 2021 [2020]
Matthew B. Crawford, Prendre la route. Une Philosophie de la conduite, traduit de l’anglais (États-Unis) par Marc Saint-Upéry et Christophe Jaquet, Paris, La Découverte, mars 2021 [2020]
De Matthew B. Crawford, nous connaissions déjà Éloge du carburateur. Essai sur le sens et la valeur du travail (2010, La Découverte) et Contact. Pourquoi nous avons perdu le monde et comment le retrouver (2016, même éditeur). Nous savions déjà que « l’auteur est philosophe et réparateur de motos », comme le disaient les quatrièmes de couverture de ces deux premiers opus. Celle du troisième indique plus précisément qu’il « enseigne à l’université de Virginie, tout en tenant un atelier de réparation de motos ». Ça fait tout de suite américain : prof de philo et mécano… Et c’est aussi ce qui fait le charme de ses livres, composés de va-et-vient entre pratique théorique – une philosophie plutôt allègre et facile d’accès – et théorie de la pratique – plutôt orientée vers les différences entre travail manuel et travail intellectuel dans L’Éloge…, où il raconte (entre autres) comment et pourquoi il a abandonné un confortable salaire dans un think tank de Washington D. C. afin d’ouvrir son atelier de réparation de motos, puis vers une approche plus large des différences entre processus cognitifs selon qu’ils sont plus liés à la chair ou à l’esprit, dans Contact…
Je vais parler ici de son dernier opus, mais je tiens à souligner qu’il y a une vraie cohérence entre les trois. Je ne suis pas sûr de bien savoir comment la résumer (quelle prétention !), mais tant pis, je me lance : je dirai que sa thématique principale, qui trame ses compositions en basse continue, est ce qu’Isabelle Stengers (ou Vinciane Despret, ou les deux ensemble, dans Les Faiseuses d’histoires. Ce que les femmes font à la pensée[1], bah, je ne sais plus très bien…) décrit comme la différence, ou plutôt l’opposition entre les postures intellectuelles du thème et de la version. Le thème : je pars de quelque chose – un texte, une notion, un système, et je le traduis dans une autre langue, une autre pensée, un autre contexte, ou pour le dire plus simplement, peut-être, je pars d’une vérité théorique a priori que je plaque sur une réalité pratique. La version : je pars des « autres » cités ci-devant et tâche de les traduire en quelque chose de compréhensible par moi et mes interlocuteurs – ce que je pourrais décrire comme le processus de l’expérience, soit essayer de tirer un acquis théorique de données empiriques. Ouf ! vous feriez peut-être mieux de lire directement Crawford, je pense qu’il explique cela beaucoup mieux que moi.
Prendre la route parle plus d’automobiles que de motos. On y apprend que son auteur, en plus de la philo et de la réparation de motos, s’adonne à l’art délicat du hot rod. Pas de panique : moi non plus je ne savais pas ce que c’était avant de lire ce livre. Ce doit être connu, pourtant, puisque Crawford ne prend pas la peine de nous expliquer ce que cela signifie lorsqu’il introduit le terme dans un sous-titre de son Introduction[2] : « Ingénierie populaire : hot rod et tuning ». « Tuning », j’en avais entendu parler, j’avais compris qu’il s’agissait en quelque sorte de l’activité qui consiste à personnaliser son véhicule, mais j’avais cru[3] que cela se limitait à y mettre du gros son, de la lumière et pousser un peu le moteur… En quoi je me plaçais justement dans cette posture d’intello à la fois craintif et condescendant qui ne comprend que dalle aux moteurs à explosion et qui regarde de haut ceux qui sont capables de vouer une telle passion – et de consacrer autant de temps – aux « belles mécaniques ». Alors, si j’ai bien compris, le hot rod consiste à « restaurer et modifier radicalement » (p. 26) une voiture ancienne. C’est ce qu’a entrepris Crawford depuis quelques années avec une Volkswagen Coccinelle de 1975. Et quand il utilise l’adverbe « radicalement », il ne bluffe pas : « Voici maintenant huit ans que je l’ai achetée, dit-il, et tout ce qui subsiste de la carrosserie originale, c’est le châssis, le support moteur suspension arrière et le toit. Tout le reste n’était plus qu’une masse de poudre d’oxyde de fer conservant la forme d’une Volkswagen par la seule force de l’habitude et l’effet de la colle à tapis. » (chap. « Ingénierie populaire », p. 155) Et encore ne parle-t-il là que de la carrosserie : au moment où il écrivait le livre, soit donc huit ans après l’acquisition de cette « masse de poudre d’oxyde de fer », il n’avait toujours pas fini de (re)construire sa Coccinelle. Bien sûr, nous avons vu qu’il exerce d’autres activités chronophages – enseigner, réparer des motos, écrire des livres… Reste la question de savoir ce qui peut bien pousser quelqu’un à cette forme d’extrémisme ? En voici une première explication :
« L’être humain est un homo faber, vérité fondamentale soulignée par Hannah Arendt. Nous fabriquons des choses, et cela semble exprimer une nécessité profonde : nous avons besoin de pointer du doigt un objet sur la scène du monde et d’être capable de dire : “C’est moi qui l’ai fait.” Si vous combinez cette dimension de notre humanité avec notre côté homo moto[4], vous obtenez la passion des fanas de la mécanique. » (Introduction, p. 25)
Mais cela va plus loin. Parlant des « communautés d’amateurs » de hot rod et de tuning, qui se sont beaucoup développées avec l’apparition d’Internet, Crawford dit que « ce qu[’il] trouve de plus intéressant chez [elles], c’est qu’elles cultivent une forme d’appropriation cognitive de leurs automobiles dont la profondeur contraste fortement avec la passivité et la dépendance de la culture consumériste » (p. 25). Ce qui me paraît frappé au coin du bon sens. En fait, tout l’enjeu soulevé par le livre est là, me semble-t-il : il oppose la capacité à se mouvoir par soi-même à la passivité de l’être transporté, la dépression de « l’individu qui se laisse porter passivement par l’existence » et, au contraire, « la relation inhérente qui semble exister entre le mouvement et la joie. » (p. 20) Cela commence bien sûr avant l’âge du permis de conduire, par exemple avec une balançoire comme celle que l’auteur a installée pour sa fille dans le jardin : « Les enfants ont le don de trouver dans leur environnement des appuis et des prises qui leur offrent de multiples occasions de mouvement et de joie. En grandissant, nous commençons à percevoir de nouvelles opportunités de divertissement, dès lors que nous modifions notre environnement, par exemple en attachant une corde à un arbre. (C’est à cela que servent les pères.) » (p. 20) Et Crawford de se référer à Nietzsche, qui dit que la joie est le sentiment de l’augmentation de notre puissance d’agir (j’aurais plutôt pensé à Spinoza) et de combiner cette pensée avec celle d’Aristote qui observe que ce qui distingue les animaux du reste de la nature (comme les rochers, par exemple), c’est leur capacité à l’automobilité. Et, sautant par-dessus les siècles, il convoque ensuite les résultats des recherches en sciences cognitives qui montrent que le développement des facultés supérieures est lié à l’autolocomotion. Et, plus intéressant encore, que « notre automobilité semble être profondément impliquée dans le développement de ce que l’on appelle la “mémoire épisodique”. » Il cite ainsi un certain M. R. O’Connor, lequel explique que « nos cartes cognitives de l’espace […] sont aussi le site […] de notre remémoration du passé. » (p. 21) Et convenons avec Crawford que « Cela paraît logique, au fond : les événements se produisent toujours quelque part, et si le temps et l’espace sont liés dans notre expérience, ils le sont aussi dans notre mémoire. » (p. 21-22) Tels les Dupont dans Tintin, je dirais même plus ! en élargissant la formule au-delà de l’individu. En effet, ce lien entre lieux des événements et mémoire me rappelle une histoire rapportée par Bruce Chatwin dans son ouvrage Le Chant des pistes[5]. Avant de la lire, il convient de savoir qu’Arcady est le conducteur blanc d’un véhicule quelque part au milieu de rien en Australie, à bord duquel se trouve également Limpy, aborigène australien, dont l’ancêtre est Dasyure, une espèce de marsupial ressemblant au chat. « Au milieu de rien » n’est pas juste : c’est la vision du Blanc (enfin, la mienne, du moins). En fait, le véhicule dans lequel se trouve aussi le narrateur se dirige vers « Cycad Valley, un site important [du] chant [de Limpy] » où ce dernier ne s’est jamais rendu[6].
« Lorsque Arkady tourna le volant sur la gauche, Limpy bondit de nouveau (après avoir été immobile pendant sept heures). […] Il jeta un regard fou aux rochers, aux falaises, aux palmiers, à l’eau. De ses lèvres qui se déplaçaient à toute vitesse, comme celles d’un ventriloque, nous parvenait un bruissement, tel le son du vent dans les branches. Arkady comprit tout de suite ce qui se passait. Limpy avait appris ses strophes du Dasyure à la cadence d’un homme qui marche, à cinq kilomètres-heure, et nous roulions à quarante. Arkady rétrograda en première et la voiture avança au pas. Instantanément Limpy accorda son rythme à celui de la nouvelle vitesse. Il souriait. Sa tête se balançait d’un côté et de l’autre. Le son devint une belle mélodie frémissante ; et l’on sut qu’il était le Dasyure. »
Voici le commentaire de Jean-François Gaudreau : « Ils arriveront au bout du chant à pied, exactement au bon endroit, sans jamais y être allés auparavant. Cela est rendu possible par le fait que chaque pas du parcours de l’ancêtre Dasyure […] fait partie du chant et que chaque élément un tant soit peu important du paysage est décrit en tant que l’un ou l’autre pas. Il est donc évident que Limpy connaît par cœur son chant, malgré sa longueur incroyable, puisqu’il devrait être capable de parcourir à pied les trois cents kilomètres qui séparent son territoire habituel de Cycad Valley et qu’en plus, il est capable de le reprendre à n’importe quel point de l’itinéraire sans l’avoir parcouru au complet. »
Mais revenons à Crawford. Poursuivant son développement sur le lien entre mémoire et espace, il écrit que « nos souvenirs d’événements spécifiques sont les points que nous relions entre eux pour nous raconter des histoires sur nous-mêmes. C’est avec ce type de narration que nous accédons au territoire propre de l’humain. » Mais l’histoire de Limpy nous montre, me semble-t-il, que ce « territoire propre de l’humain » n’est guère accessible en voiture, ou alors il faut qu’elle roule à la même vitesse que celle de la marche à pied… C’est un premier et important bémol que j’apporterais à la lecture de Prendre la route. En effet, il a tendance à faire des véhicules automobiles des sortes d’extensions mécaniques du corps humain. Du moins les véhicules qu’il défend, c’est-à-dire des automobiles où les interfaces sécuritaires, à base d’électronique, entre la route et le conducteur, n’évacuent pas complètement l’expérience sensible de ce dernier. Je trouve tout à fait pertinente, par contre, sa critique de ces dispositifs dernier cri, qui vont du GPS à la conduite entièrement automatisée – sans chauffeur – en passant par les régulateurs de vitesse, les assistances au freinage ou à la stabilité du véhicule. Il y consacre de nombreuses pages qui valent vraiment le détour. Habitant un centre-ville ancien aux rues (très) étroites, avec des virages à angle droit difficiles à négocier pour des conducteurs de gros SUV habitués aux grandes villes et aux autoroutes, je ne peux que lui donner raison : ainsi, combien de fois ces touristes font-ils confiance à leur GPS qui leur recommande de passer par le centre ancien pour traverser la ville, et combien de fois se retrouvent-ils proprement coincés à l’angle de deux ruelles juste en dessous de chez moi… A-t-on assez râlé, avec notre voisin d’en face, contre ces néoconducteurs qui accordent plus de confiance à un écran qu’à ce qu’ils pourraient observer directement par eux-mêmes, c’est-à-dire qu’ils sont en train de s’engager dans un dédale inextricable… Récemment, à Marseille, un conducteur a précipité sa voiture dans le Vieux-Port en se fiant aux indications de son GPS. Au moins avait-il l’excuse que ce jour-là (ou ce soir-là, je ne sais plus), la visibilité était quasi nulle à cause d’un temps exécrable, pluie, brouillard, etc. Mais ici où j’habite, c’est en général en plein jour et sous un soleil de plomb que se produisent ces désagréments (en périodes de vacances, hein, j’habite dans le Sud…) Bref.
Crawford ferraille, donc, contre les autorités publiques et les puissances privées qui se démènent afin de prendre le contrôle des habitacles de nos voitures et de leur environnement, c’est-à-dire du trafic automobile. Parlant des salariés américains, il dit qu’il ne leur reste plus que le transport biquotidien en automobile comme espace de liberté individuelle… En voiture, dit-il, on peut rêvasser, chanter (il paraît que c’est là que les Américains moyens chantent le plus, avec la douche), bref échapper aux contraintes du boulot et du dodo. La durée moyenne de trajet des salariés qui se rendent au travail en voiture depuis leurs zones pavillonnaires est de vingt-six minutes aller et autant de retour. Il semble que Google et consorts adoreraient prendre le contrôle de ce qui deviendrait cinquante-deux minutes quotidiennes supplémentaires de cerveaux disponibles à condition de supprimer cet archaïsme : la conduite humaine. Cela implique, primo : de mettre au point les véhicules sans chauffeurs (qui existent déjà, au demeurant, mais qui ne seraient pas encore tout à fait opérationnels) ; deuzio : d’adapter les conditions du trafic à ces voitures « intelligentes », c’est-à-dire, d’une part, d’éliminer les autres, à conduite par des humains et donc difficilement programmables et d’autre part, d’équiper toutes les voies de circulation en capteurs émetteurs récepteurs reliés à des calculateurs régulateurs de trafic (si vous n’aviez pas encore pigé à quoi allait servir la 5G, avant la 6G puis les suivantes, eh bien, c’est fait) ; et tertio – mais en fait ça vient en même temps, dès le début : de convaincre tout le monde que c’est ça l’avenir, qu’il n’y a pas d’autre solution, que ça va tout arranger, etc. (le fameux story telling).
Sur toute cette évolution (on devrait plutôt parler de régression en termes d’autonomie et de liberté individuelles), Crawford est très convaincant. Il montre bien qu’il s’agit d’un problème éminemment politique, celui de l’autogouvernement menacé par un monstre technobureaucratique qui prétend faire notre bonheur à notre place. Tout cela est vrai et, je le répète, la somme d’informations apportées ici justifie largement cette lecture. Mais, comme vous avez dû le sentir arriver, voici le deuxième bémol, non moins important que le premier. Il est double (si, si, j’ai été vérifier dans Wikipédia, le double-bémol, ça existe !).
D’abord, de mon point de vue, je ne vois pas très bien comment je pourrais m’enthousiasmer pour la défense d’un soi-disant « espace d’autonomie et de liberté individuelle » dont je pense qu’il est bien plutôt une partie d’un dispositif qui tend à écraser toute possibilité d’autonomie et de liberté, justement. C’est quoi l’autonomie et la liberté des banlieusards qui se rendent au boulot en bagnole plutôt qu’en métro ? Ok, je veux bien admettre qu’il existe une nuance entre métro-boulot-dodo et auto-boulot-dodo, mais elle ne me semble pas très significative dans une perspective émancipatrice.
Ensuite, Crawford se réfère à Tocqueville (chaque fois que je tombe sur son nom dans un texte, ça a le don de m’énerver, mais ici n’est peut-être pas le lieu de m’étendre là-dessus), plus précisément au « pluralisme tocquevillien, à savoir la conscience que chaque fois que des gens s’unissent en vue de cultiver un intérêt spécifique qu’ils partagent, ce type d’association fait contrepoids au pouvoir central et constitue un frein à sa tendance à vouloir dominer toujours plus. Le pouvoir central en question n’est pas nécessairement l’État ; il peut fort bien s’agir d’une entité techno-capitaliste censément vouée à promouvoir notre confort, notre agrément et notre constante distraction. Les formes pluralistes d’association que j’entends considérer sous cet angle tocquevillien sont les groupes de passionnés d’automobiles » – auxquels il consacre plusieurs chapitres de son livre. Quant à moi, la description de ces groupes ne m’a pas du tout convaincu du contrepoids qu’ils exerceraient par rapport aux puissances publiques et privées des États-Unis, et encore moins de leur caractère subversif. Crawford a beau voir une « pure allégresse dionysiaque de destruction » dans un derby de démolition qui consiste à se rentrer dedans avec des véhicules spécialement équipés en vue de cet exercice jusqu’à épuisement des combattants (enfin, destruction des bagnoles), ou encore une « démocratie dans le désert » dans une course tout-terrain de 400 kilomètres à Caliente, dans le comté aride de Lincoln, Nevada, j’ai vraiment du mal à le suivre sur ce terrain. Il y a quelque chose de vrai dans ce qu’il dit, et que je peux ressentir aussi de mon côté quand je me retrouve pris au comptoir (enfin, je devrais parler à l’imparfait, mais je croise les doigts, ça reviendra) dans un groupe, plutôt masculin et blanc en général, rassemblé là par l’intérêt commun que ses membres éprouvent pour la chasse, la cueillette des champignons, la pêche… et aussi le pastis et autres boissons alcoolisées, évidemment. Il y règne une certaine liberté de ton, c’est vrai, et un certain irrespect envers les autorités qui prétendraient se mêler de leurs affaires. D’ailleurs, plus radicalement, un certain nombre d’entre eux se cotisent pour louer un bateau au moins une ou deux fois par an et s’en aller promener en Méditerranée, loin des contraintes quotidiennes. Je n’oserais cependant pas qualifier cela d’école de citoyenneté, comme le fait Crawford à propos des 400 kilomètres de Caliente (parce que les compétiteurs, en gros, se débrouillent par eux-mêmes pour organiser la compétition sans écraser les petits enfants quand ils passent à proximité d’habitations – surtout au départ et à l’arrivée, le reste de la course se déroulant dans un environnement plutôt désertique, semble-t-il).
Cependant, je ne voudrais décourager personne de lire ce livre qui reste, malgré ces bémols, extrêmement intéressant et agréable à lire. Et, comme je crois l’avoir déjà dit, mais tant pis, je me répète, bourré d’informations et de références dont je n’ai donné ici qu’un aperçu. Je n’ai probablement pas assez insisté sur le fait qu’y alternent des chapitres consacrés à l’analyse philosophique, politique et sociologique des enjeux de l’évolution de l’industrie automobile, et de nombreux autres chapitres qui sont des comptes rendus d’expériences personnelles de l’auteur (construction de la Coccinelle, conduite, comment dire, « sportive », et les sensations qu’elle génère, excès de vitesse et procès subséquents, etc.), souvent assez drôles. C’est vraiment rafraîchissant de lire un ouvrage de philo comme celui-là.
En guise de conclusion, je vais donner encore une citation du début du livre (Introduction, p. 43), qui donne une bonne idée de son projet. Elle reflète bien, me semble-t-il, à la fois tout son intérêt et, assez clairement, le contexte américain dans lequel il s’inscrit, et qui est aussi celui de la liberté de détention et de port d’armes.
« Ce livre intéressera les passionnés de la conduite automobile. Mais les lecteurs indifférents au plaisir de conduire pourront néanmoins y trouver une étude de cas susceptible d’apporter des lumières sur des thèmes plus amples, comme par exemple le destin de la puissance d’agir des êtres humains ou les perspectives de la gouvernance démocratique. Car s’il est une question qui émerge avec force de cette enquête, c’est bien celle de l’autodétermination au sens large, à la fois comme capacité individuelle d’autocontrôle et comme principe politique. […]
En traçant une ligne droite entre la capacité d’autocontrôle et l’autodétermination, au sens politique du terme, j’entends inscrire la problématique de l’art de conduire dans la tradition libérale républicaine de la pensée politique. Selon cette tradition, afin d’être digne de la démocratie, le peuple doit d’abord être composé d’individus capables de gouverner leur propre comportement, et ayant de ce fait gagné la confiance de leurs concitoyens. »
franz himmelbauer
[1] La Découverte, coll. Les Empêcheurs de penser en rond, 2011.
[2] Introduction titrée : « De l’art de conduire comme une forme d’humanisme », ce qui, évidemment, ne manquera pas de faire sursauter les gens comme moi que le terme humanisme renvoie automatiquement à « humanités », soit à l’image d’un programme d’enseignement assez éloigné des arts mécaniques. Lorsque j’étais jeune, voici déjà un temps certain, se présentaient aux élèves, après le certificat d’études primaires, deux voies auxquelles il était difficile d’échapper – celle qui était réservée aux futures « élites » de la nation et qui passait par les « humanités », justement : sept ans de lycée puis les études supérieures, tandis que le vulgum pecus était aiguillé vers les collèges d’enseignement techniques (CET) ou ce que l’on appelait des « classes-parkings » en attendant d’être éventuellement envoyé en apprentissage.
[3] Comme me disait ma grand-mère, qui n’était pas une intellectuelle mais était dotée d’un solide bon sens : « Y’a que les ânes qui croient ! »
[4] « Homo moto » est le sous-titre d’une section de l’Introduction qui commence ainsi : « Lorsque nous apprenons à marcher, nous ne faisons que les premiers pas sur la voie de la mobilité totale dans un monde d’artefacts. Il nous reste à mobiliser toutes les modalités du mouvement qui étendent et transforment nos facultés natives, du vélo au skateboard. Chacune d’entre elles crée en nous de nouvelles aptitudes et multiplie les plaisirs sui generis de cette créature hybride qu’est l’homo moto. » (p. 21)
[5] Traduction française disponible au Livre de Poche.
[6] J’ai (re)trouvé ce passage du Chant des pistes et les commentaires qui l’accompagnent dans Jean-François Gaudreau, « L’Espace nomade. Le cas particulier du Chant des pistes de Bruce Chatwin », disponible ici en pdf. J’avais lu il y a quelques années le bouquin de Chatwin, mais je ne l’ai plus, il ne m’avait pas laissé une impression inoubliable. Par contre, si l’on veut bien comprendre de quoi il retourne ici, il faut lire Barbara Glowczewski, Les Rêveurs du désert et Rêves en colère, Éditions Actes-Sud (Babel) et Pocket (Terre humaine poche, Arles, 1996 [1989] et Paris 2006 [2004], auxquels j’avais consacré une note de lecture visible ici.
