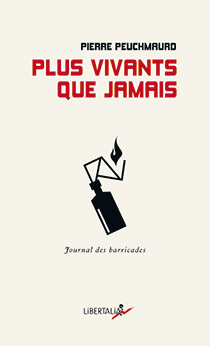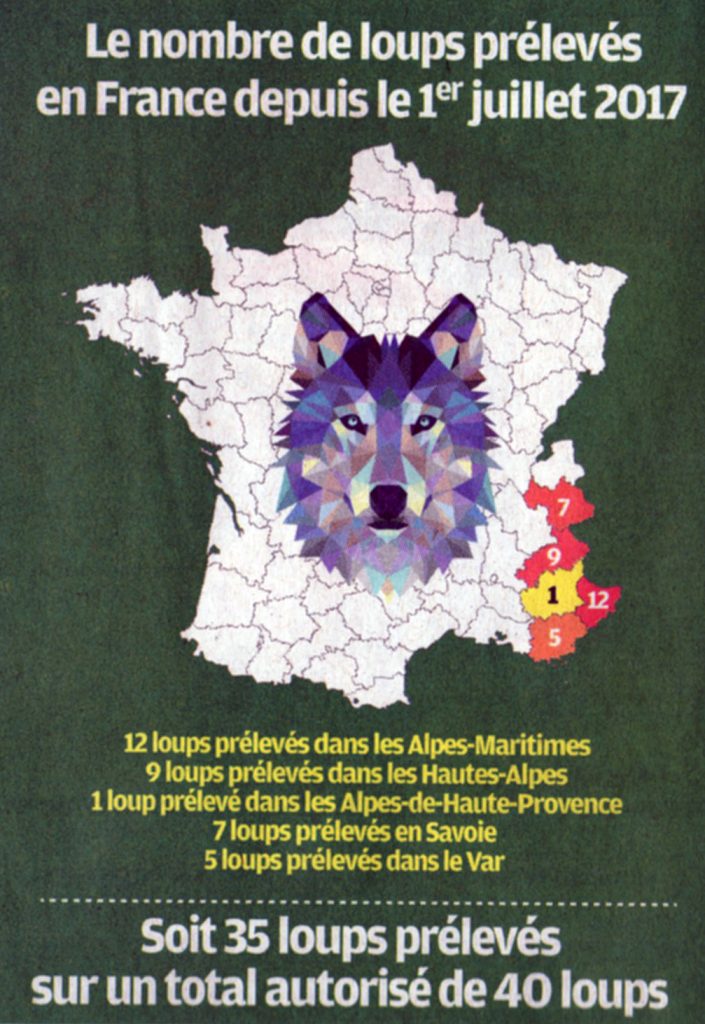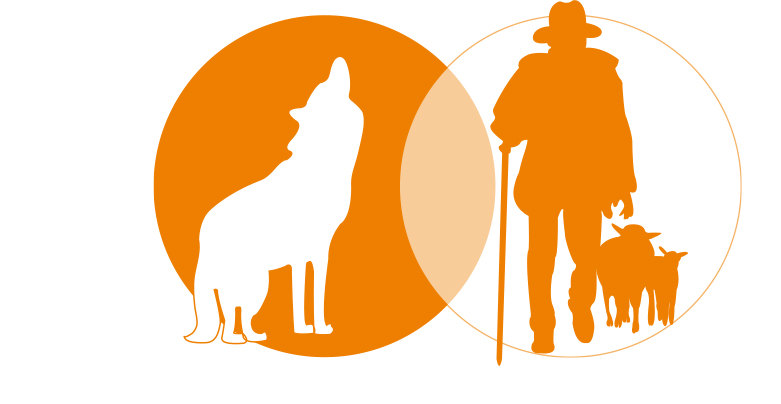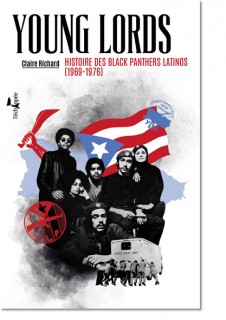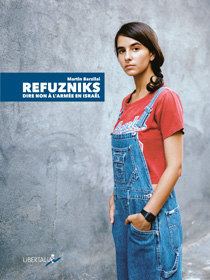Dirty Week-end, Helen Zahavi. Trad. de l’anglais par Jean Esch. Presses Pocket, Paris, 1992.
J’ai découvert ce thriller féministe grâce au livre Se défendre d’Elsa Dorlin dont j’ai rendu compte ici même il y a peu. Le dernier chapitre de Se défendre, intitulé « Répliquer », prend appui sur ce roman afin de donner à voir ce que c’est que la dite « condition féminine » – concrètement : être objet de harcèlement permanent – et une manière d’en sortir… Cette lecture n’apprendra probablement pas grand-chose aux femmes, par contre à nous autres, hommes, elle me semble tout à fait utile, voire indispensable. Comme je suis un peu flemmard, et qu’en plus, Elsa Dorlin donne une excellente présentation de ce livre, je m’en remets à elle (avec l’aimable autorisation des éditions Zones) pour cette note de lecture. La section citée, « Phénoménologie de la proie », occupe les pages 163 à 171 de Se défendre, dont on trouvera le texte intégral en ligne sur le site des lybers de Zones.
Phénoménologie de la proie
Quelques semaines avant sa sortie en 1991, la presse dénonce déjà Dirty Week-end, accusé d’être un brûlot immoral, ultra-violent et pornographique, et Helen Zahavi, son autrice, une « malade mentale ». Dans l’histoire moderne de la censure en Angleterre, le roman est le dernier opus à faire l’objet d’une demande d’interdiction de publication et de diffusion auprès du Parlement de Londres. Dirty Week-end touche visiblement un point ultrasensible. Pour la plupart des commentateurs du livre, il s’agit d’une apologie de la violence qui ne s’encombre même plus de justifications vengeresses : une violence gratuite, irrationnelle, sans limite. Bella, son héroïne, est la figure même de la victime devenue bourreau. Ralliée à la brutalité la plus obscène – mais, déclinée au féminin, la brutalité n’est-elle pas toujours considérée comme obscène ? –, Bella est présentée comme une version contemporaine de la folie féminine meurtrière : son éthique est ainsi réduite à une pathologie. À l’encontre du texte même de Helen Zahavi, ces commentaires manquent totalement ce qui est pourtant au centre du roman. Et, en ce sens, ils sont aussi peut-être le symptôme d’une volonté de ne pas savoir ; volonté que le texte même de Zahavi bouscule, déstabilise. Bella est bien une figure de la banalité qu’il y a à être violentée, et son week-end meurtrier, la fiction méthodologique qui sert à faire éprouver cette expérience, qui la fait, par l’écriture, accéder à la densité du réel et forcer les consciences.
Le roman déstabilise aussi une appréhension éthico-politique commune dans les courants féministes contemporains où la violence est seulement pensée comme expression de la puissance d’agir des « dominants » et ne constitue pas ou plus, par conséquent, une option « politique » possible pour le féminisme. Dans cette perspective, le roman est éminemment choquant parce qu’il resignifie les effets de la violence faite aux femmes en décrivant ce que la violence fait à Bella et ce qu’elle peut à son tour en faire. « Serial killer féministe », comme des journalistes l’ont qualifiée, Bella rompt ainsi avec une éthique féministe (ou trop rapidement attribuée au féminisme dans son ensemble) de la non-violence ; elle est la sale héroïne dont le féminisme avait besoin pour questionner son propre rapport à la violence : ce que l’on fait dans / de / avec la violence. Dans ce roman, nulle conversion véritablement héroïque de la gentille, fragile et vulnérable Bella en justicière sanguinaire défendant la cause des femmes. Il s’agit d’autre chose. Le politique se situe à un autre niveau : au cœur justement de cette intimité vécue, introspective, vaincue et désespérée, et, en même temps, de cette expérience charnelle d’une patience à bout. Dirty Week-end, c’est l’histoire politique du déploiement d’un muscle, jusqu’ici épuisé, recroquevillé sur lui-même, qui se saisit un jour d’un marteau pour exploser un crâne. « Politique », donc, au sens le plus féministe du terme, au sens où le personnel peut l’être.
Bella vit seule dans un tout petit appartement en semi-sous-sol d’un immeuble modeste, typique de Brighton, ville côtière du sud de l’Angleterre. Comme des millions d’autres, Bella est une jeune femme sans histoires, dont nul n’était censé se souvenir. Dans la vie, elle n’a ni ambition ni prétentions, pas même au bonheur le plus simple, le plus stéréotypé. D’ailleurs, Bella « a appris à être une bonne perdante. Perdre semblait lui convenir. C’était quelque chose de familier, comme une douleur qui a toujours été en vous, et qui vous manquera si jamais un jour elle disparaît ». Bella est une antihéroïne, un personnage anonyme, une femme qui passe et presse le pas, une ombre dans une foule. Et Bella est à ce point commune qu’elle peut précisément figurer toutes les femmes. Comme l’écrit Zahavi : « Vous la trouvez pathétique ? Sa faiblesse vous rebute ? L’image de ses grands yeux fous de victime vous soulève l’estomac ? Ne la jugez pas. Ne la jugez pas sans avoir vécu cela. » Dont acte, nous sommes toutes un peu Bella. Qui n’a pas une fois ressenti la médiocrité existentielle de Bella, son propre anonymat, la peur si familière qui l’accompagne, ses espoirs avortés, son épuisement revendicatif, sa claustrophobie à vivre dans son espace étriqué, à survivre dans son corps, son genre, son humilité à supporter sa galère sociale, sa seule exigence de vivre tranquille ? Parce que nous faisons à peu près quotidiennement, de façon répétitive, diverse, l’expérience de toute cette myriade de violences insignifiantes qui nous pourrissent la vie, qui met en permanence à l’épreuve notre consentement ; parce que nous faisons à peu près quotidiennement l’expérience de ces regards salaces, de ces harcèlements licites, de ces réflexions humiliantes, de ces gestes intrusifs, de ces brutalités nauséeuses, qui endommagent nos corps comme nos vies.
Les premières pages qui décrivent la vie de Bella dessinent en creux ce qui pourrait être qualifié de phénoménologie de la proie. Une expérience vécue que nous tentons par tous les moyens de supporter, de normaliser par une herméneutique du déni, en tentant de donner sens à cette expérience en la vidant de son caractère invivable, insupportable. Bella est très vite agressée par un homme des plus « ordinaires » (c’est un détail important) qui la violente de toute part, et elle essaie de maintenir coûte que coûte la fiction d’une Bella d’« avant » l’agression. Elle tente de vivre comme à son habitude, de se rassurer en faisant semblant que tout va bien, de se protéger en faisant comme si rien ne s’était passé, en déréalisant sa propre appréhension de la réalité – en face dans la rue, un homme la regarde jour et nuit depuis sa fenêtre, mais peut-être est-ce elle qui pense qu’un homme la regarde. Bella vit dans cet effort constant qui consiste à n’accorder que peu d’importance à soi : à ses ressentis, à ses émotions, à son malaise, à sa peur, à son angoisse, à sa terreur. Ce scepticisme existentiel de la victime relève d’une perte de confiance généralisée qui touche tout ce qui est vécu, perçu, au je. Puis, quand le déni devient impossible, Bella « prend sur elle » : en se recroquevillant dans son corps, en restant tapie dans son appartement, en rétrécissant son espace vital qui, malgré tous ses efforts, est violé. Elle vit dans la banalité d’un quotidien d’une proie qui veut s’ignorer, en aménageant sa vie pour en sauver le sens, et parce que l’idée même d’être une proie appelle une forme d’attention à soi qu’elle ne s’accorde même pas. Aussi, l’agression, loin de marquer un point de rupture dans l’itinéraire d’une vie sans histoires, n’est en fait que le révélateur de ce que les expériences continuées de la violence ont déjà abîmé, marqué dans le corps de Bella. Elles ont constitué son corps propre, son rapport au monde, ont charpenté la façon même dont ce monde lui apparaît, la touche ; elles ont modelé la façon dont son corps habite, affecte ce monde et s’y déploie. Il n’y a donc pas de retour possible à une vie ante agression. Il n’y a pas de possibilité de « revenir » en arrière car, de fait, il n’y a pas de point d’accroche pour retrouver une féminité épargnée, qu’il faudrait restaurer ou déviolenter.
L’histoire de Bella, c’est aussi l’histoire d’un voisin, un homme lambda, habitant l’immeuble en face, qui a décidé un jour de la violenter. Pourquoi ? Parce que Bella paraît si pathétique, si fragile, déjà si « victime ». Et, si nous sommes toutes un peu Bella, c’est aussi parce que, comme Bella, nous avons commencé à ne plus sortir à certaines heures, dans certaines rues, à sourire quand un inconnu nous interpellait, à baisser les yeux, à ne pas répondre, à presser le pas quand nous rentrions chez nous ; nous avons veillé à fermer à clef nos portes, à tirer nos rideaux, à ne plus bouger, à ne plus répondre au téléphone. Et, comme Bella, nous avons dépensé beaucoup d’énergie à croire que notre perception de cette situation n’était pas digne de faire sens, qu’elle n’avait pas de valeur, de réalité : à dissimuler nos intuitions et émotions, à simuler que rien de révoltant ne se passait ou, au contraire, que ce n’était peut-être pas acceptable d’être épiée, harcelée ou menacée, mais que c’est nous qui étions de mauvaise humeur, qui devenions intolérantes, paranoïaques, ou alors qu’on avait la poisse, que ce genre de « trucs », ça n’arrivait qu’à nous. Précisément, l’expérience de Bella est une somme de bribes d’expériences communément partagées mais aussi la description minutieuse de toutes ces tactiques prosaïques, de tout ce travail phénoménal (perceptif, affectif, cognitif, gnoséologique, herméneutique), que nous effectuons chaque jour pour vivre « normalement », qui relève du déni, du scepticisme, et rend indigne tout ce qui relève de soi. Or, cette normalité renvoie de fait à un critère de l’acceptable (et donc aussi à un critère de l’inacceptable, du révoltant), défini par la perspective imposée par cet homme à la fenêtre : c’est d’après son échelle de l’acceptable et du crédible, d’après « son monde à lui », que nous jugeons qu’il est « normal » de subir ce qu’il fait puisque c’est lui qui juge « normal » d’agir comme il le fait.
Et c’est depuis cet horizon d’expériences commensurables de la banalité du pouvoir que Bella peut devenir le personnage tragique d’un conte féministe, un conte exemplaire. Car l’histoire de Bella ne commence véritablement que quand Bella considère que finalement ça suffit. Il n’y a pas de roman avant ce point de basculement, juste un prologue qui évoque ce que ça fait d’être une femme.
Le voisin de Bella, l’homme qui l’observait par la fenêtre, l’appelait au téléphone, la réveillait au milieu de la nuit, cet homme l’a suivie un après-midi. Il s’est assis à côté d’elle alors qu’elle s’était octroyée quelques minutes pour jouir d’un rayon de soleil dont elle s’était privée depuis des semaines ; il lui a mis la main sur la cuisse, tenu le poignet au point de le lui briser, l’a embrassée de force et il lui a promis de venir chez elle pour lui « faire mal », Bella attend. Elle attend son tour devant la porte du monde de son violeur. Elle a beau lui avoir dit d’arrêter ; elle a beau avoir évoqué le fait que c’était insensé, protesté que c’était anormal : il n’entend pas, il ne comprend pas. C’est le « vide sidéral » – elle perd pied, elle n’y arrive plus ; elle est désorientée et ne parvient plus à restaurer du sens. Pourtant, Bella va « passer à l’acte ». Pourquoi ce jour-là précisément ? Était-elle plus exténuée de tout ce travail accompli pour maintenir une « vie normale » ? Rien ne permet d’y répondre. Tout se passe comme si un mouvement ou, plutôt, une tension à l’échelle même d’un muscle dont elle ignorait encore l’existence s’était petit à petit manifestée, avait fécondé un « petit noyau de rage compact ». Bella s’est arrêtée de douter, elle a arrêté de nier et d’attendre, de protester gentiment en tentant de sourire. Elle est alors sortie d’elle-même, elle est sortie de chez elle, elle a marché vers quelque chose : « Il était trois heures passées quand elle arriva dans les North Laines. C’est un quartier où on se rend quand on souhaite consulter un psy, se faire lire les lignes de la main, ou connaître son avenir. C’est le quartier mystique et altruiste de la ville. Là où on vous prend par la main pour vous conduire à travers vos rêves. »
Au cours de cette pérégrination, elle rencontre un voyant iranien, qui lui tient des propos elliptiques, et avec lequel elle parle longuement : d’elle, de sa vie, de son arrivée à Brighton trois ans auparavant, de ce qui se passe depuis plusieurs mois. Elle raconte la fatigue d’être une femme, à la manière d’une fable de l’hétérosexualité désenchantée. Les désirs, les rencontres, le sexe, l’amour libre, l’amour payant, le désamour, la désillusion, les ruptures, les abandons, parce qu’il nous dit que « l’on se laisse aller ». Les petits riens de la non-attention, du non-intérêt, de la non-écoute, des non-regards, des non-égards, du non-soin, du non-attachement qui ont généré chez Bella cette conviction profonde d’être « une épave flottante, un objet rejeté sur la côte. La dernière de la course. La pluie sans que vienne le beau temps. Un simple galet sur la plage. La dernière sortie du lit et la dernière dans la queue. La dernière en tout, pour tout le monde ». Ce passage du roman est crucial : Bella dialogue avec le voyant, mais se parle à elle-même.
Elle s’adresse à lui mais elle s’écoute. Pour la première fois, elle prend en compte ses propres mots, ses ressentis, ses jugements. Elle se redonne réalité. Apparaît alors, derrière l’« exceptionnelle » violence de son voisin « ordinaire », toute la violence des protagonistes « connus », « proches », « familiers » qu’elle a rencontrés tout au long de sa vie : des enseignants, des amoureux, des amants, des amis, des patrons… Cette parenthèse introspective redonne de la densité à son point de vue, à sa perspective, à son monde vécu.
Elle fait le lien entre toutes ses expériences, et objective tout ce qu’elle a déjà fait, toutes les résistances imperceptibles qu’elle a déployées pour traverser et vivre dans ces violences. Il s’avère que si Bella est encore là, c’est qu’elle est depuis longtemps une experte de l’autodéfense – une autodéfense qui n’en a pas le nom, pas le label, ni le prestige. Les techniques d’autodéfense que Bella a activées quotidiennement ont précisément été efficaces parce qu’elles lui ont permis de ne pas être complètement abattue par la violence. Évitement, déni, ruse, mot, argument, explication, sourire, regard, geste, fuite, esquive sont des techniques de « combat réel » qui ne sont pas reconnues comme telles. Bella prend donc conscience que, jusqu’ici, elle s’est défendue mais qu’elle s’est épuisée à prendre sur elle, qu’elle a raboté son monde, coupé dans le vif de son être. Elle a fait avec les moyens du bord, avec ce qu’on lui avait appris, ce qu’elle a reçu en héritage. Cette tactique qui relève de ce qui apparaît de prime abord comme une lâcheté toute « féminine », a été la seule tactique de survie efficace lui permettant de sauver la face au prix de sa propre déréalisation. N’empêche, jusqu’ici, elle a survécu, elle s’est défendue tant bien que mal.
Une question surgit alors : que peut-elle faire à présent, que lui est-il permis d’espérer ? Se défendre. Se défendre encore mais autrement : passer de la tactique à la stratégie. Ne plus se tenir tapie dans le monde de l’Autre à éviter les coups et à serrer les dents. Bella ne se libère pas, elle n’est pas plus « libre » qu’avant, elle comprend juste qu’elle est en colère, et cela lui suffit pour agir. Cette colère lui appartient. Bella restera polie, humaine, presque prévenante avec ses victimes. Au constat que, jusqu’ici, Bella s’est défendue de la violence en se faisant constamment violence, elle va modifier les règles de sa propre action. Plutôt que d’agir en « prenant sur elle », elle va se recentrer sur elle-même, prendre soin d’elle-même, et agir sur le monde. Et, pour cela, il faudra nécessairement qu’elle transgresse les règles en vigueur.
Alors voilà, même la fragile Bella peut soulever un marteau. C’est elle qui, un vendredi soir, part chez son agresseur en pleine nuit et s’introduit dans sa chambre. C’est elle qui, à présent, lui explique les nouvelles règles parce qu’il ignorait que le jeu avait changé ; c’est elle encore qui lui assène plusieurs coups et lui fracasse la tête, le laissant agoniser dans une mare de sang. À partir de ce point de non-retour, Bella tout en restant Bella va prendre soin d’elle-même en donnant de l’importance à sa réalité. Bella ne voulait pas s’imposer, elle ne voulait embêter personne, mais finalement, toute sa vie, elle a été éduquée à tuer les hommes – parce que, de fait, ils ont fait beaucoup pour qu’elle en arrive là ; ils l’ont très bien éduquée à la violence et il ne faut pas beaucoup de volonté, de force pour « passer à la violence » ; pas beaucoup de technique, pas beaucoup d’entraînement, et c’est d’ailleurs précisément pour cette raison qu’il est si facile de violenter une femme. Elle a vu faire, elle a vu faire, elle a éprouvé ce que cela fait. Au cours du week-end qui va suivre, ceux qu’elle rencontrera sur son passage vont donc « y passer », Toutefois, ces meurtres ne sont jamais « aveugles » : ne sachant pas que Bella avait changé les règles du jeu, tous les hommes croisés en deux jours l’ont comme à l’accoutumée insultée, harcelée, frappée, violée, menacée de la liquider, ou ont violenté une autre femme.
En réalité, c’est Bella elle-même qui est parvenue à un certain stade de maturité : à un point où la violence subie ne peut que devenir une violence agie. Bella est l’Émile mutant de Helen Zahavi, elle est une bonne élève. Elle n’a jamais pratiqué d’arts martiaux, elle n’a jamais reçu d’entraînement spécial, ni appris à utiliser un marteau, un couteau, ou tirer au pistolet… mais le travail sourd de la violence vécue a fonctionné en elle comme un apprentissage à l’autodéfense féministe – lui donnant, sans qu’elle s’en aperçoive elle-même, les ressources pour raisonner, juger, agir et frapper – c’est-à-dire pour advenir au monde. Bella expérimente son corps, elle apprend « sur le tas ». Elle commence à faire confiance à ses ressentis (à sa haine, sa rage, sa peur, sa joie), à ses déductions (non il ne faut pas se moquer d’un homme qui bande mou, non il ne faut pas se faire raccompagner, non il ne faut pas s’engouffrer dans une ruelle sombre, non il ne faut pas se tenir à portée d’une main prête à vous gifler, non il ne faut pas les laisser s’approcher trop près de votre cou… à moins d’être armée et résolue à taper fort), à donner du poids à ses choix (est-ce trop demander de vivre sans être violentée ?). Les deux jours de Bella figurent la temporalité d’un stage d’autodéfense féministe, avec sa pratique accélérée, son partage d’expériences, ses prises de conscience et ses recommandations. Bella n’a pas appris à se battre, elle a désappris à ne pas se battre. En passant à une stratégie d’autodéfense féministe, il ne sera donc jamais question de distiller la réalité pour en extraire l’efficace d’un geste (immobiliser, blesser, tuer…), mais, au contraire, de s’enfoncer dans la trame de la réalité sociale de la violence pour y entraîner un corps qui est déjà traversé par la violence, pour déployer un muscle familiarisé à la violence mais qui n’a fondamentalement jamais été éduqué et socialisé à s’entraîner à la violence, à l’agir.
S’il y a bien une mue, pour autant il n’y a pas de véritable métamorphose dans Dirty Week-end, Bella reste toujours la même. Elle ne devient ni une « hystérique assoiffée de cruauté » ni une « héroïne meurtrière magnifique », Helen Zahavi veut préserver son personnage principal dans sa banalité féminine à la fois si singulière et si communément vécue. L’autrice précise à plusieurs reprises que Bella voulait qu’on la laisse tranquille et que, malgré sa patience à toute épreuve, cela n’a pas été possible. Il a fallu deux jours de violence sidérante pour que son point de vue soit enfin pris en compte, qu’il compte pour autrui.
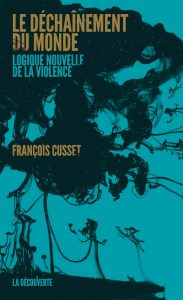 François Cusset Le Déchaînement du monde. Logique nouvelle de la violence, éd. La Découverte, 2018.
François Cusset Le Déchaînement du monde. Logique nouvelle de la violence, éd. La Découverte, 2018.