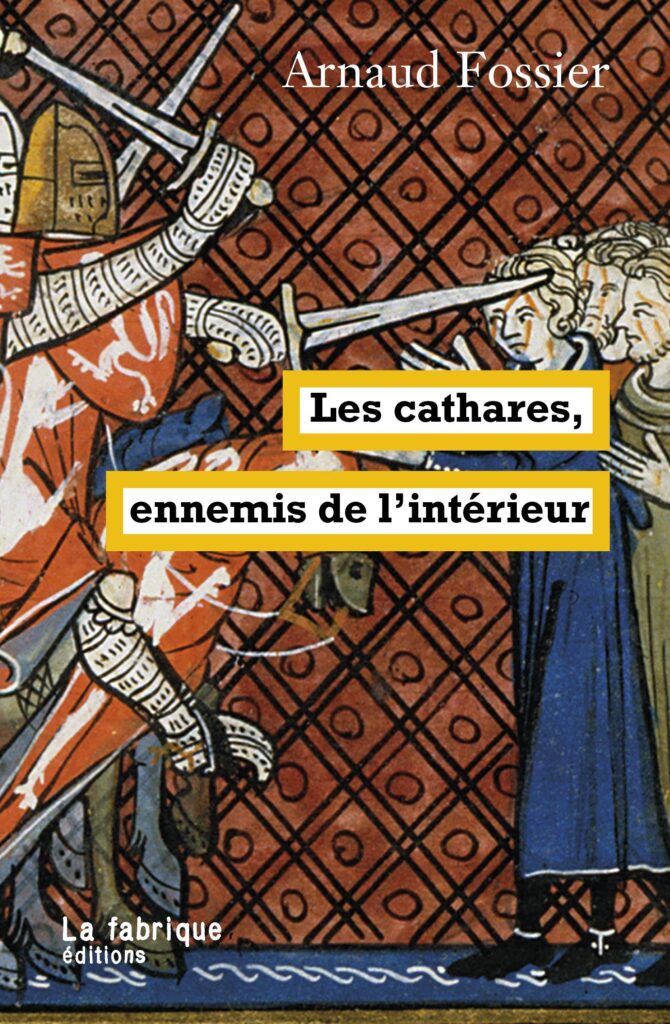
Arnaud Fossier, Les Cathares, ennemis de l’intérieur, La Fabrique éditions, 2025
Curieux titre que celui-là. Il nous fait immanquablement penser à d’autres, par exemple L’Ennemi intérieur de Mathieu Rigouste[1]. « Dans ce livre, écrivait celui-ci, nous tentons […] d’analyser à la fois la construction imaginaire de la menace dans l’institution militaire, la production de doctrines de surveillance et de répression et l’évolution des institutions chargées du contrôle intérieur depuis la fin de l’Empire français[2]. » Il étudiait « l’évolution des figures de “l’ennemi intérieur” », depuis celle de l’indigène insurgé des guerres coloniales jusqu’à celles de l’immigré postcolonial puis du musulman (forcément islamiste donc terroriste) des années 2000. Les cathares et le catharisme auraient-ils été des « constructions imaginaires », inquiétantes « figures de l’ennemi » prétextes à la répression féroce de toute déviance par rapport au dogme catholique et à l’Église romaine ?
C’est, grossièrement résumée, la question que pose cet ouvrage, une question qui a fait l’objet de vifs débats entre historien·ne·s depuis les années 1980[3], et particulièrement depuis la parution de l’ouvrage dirigé par Monique Zerner, Inventer l’hérésie ? Discours polémiques et pouvoirs avant l’Inquisition[4]. Voici ce qu’écrit Arnaud Fossier[5] dans son deuxième chapitre dont le titre : « Les cathares ont-ils existé ? » fera probablement sursauter celleux qui, comme moi, ne connaissaient jusqu’ici de cette histoire qu’une version plus… « orthodoxe », si j’ose dire, popularisée jusqu’il y a peu par une véritable industrie éditoriale, dans la même veine que celle qui exploite les thèmes des francs-maçons ou des Templiers, entre autres.
Il faut s’y résigner : nous ne connaissons les cathares que par le biais de leurs détracteurs, clercs et inquisiteurs. De là à conclure qu’ils furent le pur produit de l’imagination de ces derniers, il y a cependant un pas que l’on ne saurait franchir car les sources attestant la formation de poches de dissident·es dans diverses régions de la Chrétienté latine sont nombreuses et variées, quand bien même elles n’émanent que des persécuteurs. Les cathares n’en posent pas moins un véritable défi de méthode : comment faire l’histoire de celles et ceux – subalternes – dont la voix a irrémédiablement disparu ?
En effet, on ne dispose que de deux types de sources écrites : les « registres » tenus par les inquisiteurs lors de leurs enquêtes et procès, recueils de témoignages et/ou d’aveux d’« hérétiques », et les traités antihérésie commis par des clercs peu enclins à la miséricorde envers leur prochain. Imaginons, même si c’est une pure utopie – ou plutôt dystopie – que dans un ou quelques siècles, à la suite d’une longue période de dictature, avec un genre de ministère de la Vérité style 1984 qui aurait fait disparaître toutes les autres sources, on ne connaisse l’affaire de Tarnac que par les procès-verbaux de la SDAT et par les ouvrages « antiterroristes » du style Alain Bauer & Co. Bien sûr qu’il y aurait quelques esprits mutins pour s’élever contre ce qu’ils appelleraient une vision partiale de l’histoire… Mais sur quoi s’appuyer de tangible pour la contester ? Vous allez me dire que j’exagère. Peut-être pas tant que ça : nous parlons bien de « cathares », alors que celleux que l’Église ciblait ainsi comme « hérétiques » n’employaient jamais ces mots pour se désigner eux-mêmes, mots qui étaient ceux de « la langue du pouvoir » de l’époque, mots qui « nomm[ai]ent l’ennemi, qui figur[ai]ent l’anormal ». Le Dictionnaire historique de la langue française Robert indique en effet :
Cathare n. et adj. est emprunté au XVIIe siècle (1688 chez Bossuet) au latin médiéval catharus, relevé pour la première fois au XIIe siècle dans un acte de Nicolas, évêque de Cambrai (1164-1167), qui enregistre la condamnation portée par les évêques de Cologne, Trêves et Liège entre 1151 et 1156 contre un clerc, Jonas, « convaincu de l’hérésie des cathares ». Il est également employé en Allemagne au XIIe siècle par Eckbert, abbé de Schönau qui, dans ses Sermones adversus catharos (Sermons contre les cathares, 1163), leur reproche d’avoir eux-mêmes assumé cette appellation de « purs ». Le mot est en effet emprunté au grec katharos, « pur », « propre », dit concrètement du grain vanné, et employé au sens moral, la pureté religieuse se trouvant d’ailleurs associée à la propreté du corps ; par la suite, le mot gréco-latin a été employé par Eusèbe, saint Basile, saint Grégoire de Naziance pour désigner différentes sectes. […] Le mot, qui a pris place aux côtés de l’appellation générale et plus fréquente hereticus dès le latin médiéval, désigne et qualifie les hérétiques dualistes qui se manifestèrent en Occident dans la seconde moitié du XIIe siècle. Il s’est surtout appliqué aux hérétiques de la région d’Albi, persécutés et exterminés ensuite (croisades contre les albigeois). Voir Albigeois.
Je vous épargne le renvoi, qui définit les fameux Albigeois comme « membres de la secte chrétienne des Cathares contre laquelle le pape Innocent III prêcha une croisade exterminatrice en 1233 ». Mais alors, me direz-vous, si l’on a pu prêcher contre eux une croisade, c’est bien qu’ils ont existé, non ? Évidemment. Il y a eu un certain nombre de gens qui, dans le Languedoc médiéval (ainsi qu’en Italie), prenaient leurs aises avec le dogme catholique. Mais les taxer de « dualistes », comme fait le Robert, c’est aller vite en besogne. Et ça nous ramène longtemps en arrière, et loin vers l’Orient où un certain Mani (ou Manès) fonda au IIIe siècle une nouvelle religion. Le manichéisme devint une des nombreuses hérésies combattues par l’Église catholique romaine une fois devenue hégémonique grâce à son alliance avec l’Empire. Et la victoire de Rome fut telle qu’aujourd’hui encore, on traite de manichéen quelqu’un dont on veut déprécier la pensée en la traitant de simpliste, de vision en noir et blanc, sans nuances, etc. Tant est plus confortable certaine grisaille permettant d’euphémiser les rapports de pouvoir et d’exploitation… mais je m’égare. Ce qui est toujours assez surprenant dans cette accusation de dualisme, c’est qu’elle en dit la plupart du temps beaucoup plus sur ceux qui la fulminent que sur ceux qui en sont la cible. Ainsi de l’Église catholique, hors de laquelle il n’est point de salut, comme chacun sait – ou devrait le savoir, selon les hiérarques romains – faute de quoi, le chacun ou la chacune en question est « convaincu d’hérésie ». On n’en sort pas.
Or, aujourd’hui, le mythe cathare fait encore florès. Dans son premier chapitre, « Bienvenue en “Pays cathare” ! », Arnaud Fossier nous dit que
Chaque année, au moins 400 000 Français·es visitent l’un de ces châteaux cathares juchés sur une roche imprenable, depuis lesquels la vue est époustouflante et le spectacle garanti. On y trouve tout ce qui fait le charme , viril et guerrier, du château médiéval : pont-levis, tours et mâchicoulis, forge, latrines et oubliettes. Avec un peu de chance, un maître fauconnier vous autorisera à enfiler son gant de cuir et laissera l’un de ses rapaces se promener sur votre bras. De cathares en revanche, il n’est que peu question et pour cause : dans la plupart de ces citadelles aucun n’a jamais vécu, si ce n’est ici ou là quelques poignées de faidits – hérétiques traqués ayant trouvé refuge sur les hauteurs d’habitats villageois. L’écrasante majorité de ces castra n’ont été bâtis que plus tard, à l’initiative du roi de France dans les années 1230-1250, pour écraser la dissidence cathare ou surveiller la frontière avec le royaume rival d’Aragon. L’appellation « château cathare » est donc fantaisiste, tout le monde le sait, mais qu’importe puisqu’elle vend du rêve. Ou mieux, un mythe.
Et notre auteur de préciser en note :
Nous apprenons, au moment d’achever ce livre, que le département de l’Aude a changé la dénomination des célèbres châteaux en optant pour les « Forteresses royales du Languedoc » – un choix qui se veut « plus conforme à la réalité historique ».
Je parlais tout à l’heure d’« industrie éditoriale », j’aurais dû ajouter : « et touristique ». Tout ça me rappelle une chanson d’Atahualpa Yupanqui dans laquelle il disait que les Yankees avaient perdu la guerre au Viêtnam, mais qu’ils l’avaient gagnée ensuite au cinéma… Mon analogie est toutefois un peu bancale, puisque les Yankees de l’époque, soit les croisés ameutés par le pape Innocent III, ont bel et bien gagné leur guerre contre les Albigeois. Même s’il faudrait assortir ce constat de quelques réserves : l’affaire a duré plus longtemps qu’on ne l’imagine car, loin d’avoir rallié à leur cause les habitants du Languedoc, les massacres perpétrés par les seigneurs venus du Nord, encouragés par l’abbé de Cîteaux, Arnaud Amalric, nommé par le pape à la tête de la croisade et auquel on doit le sinistrement célèbre : « Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens ! », suscitèrent au contraire un mouvement de sympathie des gens envers les persécutés et des « rancunes tenaces, pour ne pas dire des haines profondes ». Reste que, selon Simone Weil, « Personne ne peut avoir l’espoir de ressusciter ce pays d’Oc. On l’a, par malheur, trop bien tué[6]. » Je pense qu’il est utile de s’arrêter un peu plus sur ce que disait Simone Weil dans les textes qu’elle donna au Cahiers du Sud en 1942 et 1943, parce qu’il me semble que ses réflexions de philosophe rejoignent en grande partie celles de l’historien Arnaud Foissier (enfin, il faudrait dire l’inverse pour respecter la chronologie). Tout d’abord, elle insiste sur la liberté spirituelle et la tolérance qui régnaient avant la croisade en pays d’Oc :
[…] le poème de Toulouse [la Chanson de la croisade des Albigeois] nous montre, par le silence même qu’il observe à ce sujet, combien le pays d’Oc, au XIIe siècle, était éloigné de toute lutte d’idées. Les idées ne s’y heurtaient pas, elles y circulaient dans un milieu en quelque sorte continu. Telle est l’atmosphère qui convient à l’intelligence ; les idées ne sont pas faites pour lutter. La violence même du malheur ne put susciter une lutte d’idées dans ce pays ; catholiques et cathares, loin de constituer des groupes distincts, étaient si bien mélangés que le choc d’une terreur inouïe ne put les dissocier. Mais les armes étrangères imposèrent la contrainte, et la conception de la liberté spirituelle qui périt alors ne ressuscita plus[7].
Hélas,
Comme les cathares semblent avoir pratiqué la liberté spirituelle jusqu’à l’absence de dogmes, ce qui n’est pas sans inconvénients, il fallait sans aucun doute qu’hors de chez eux le dogme chrétien fût conservé par l’Église, dans son intégrité, comme un diamant, avec une rigueur incorruptible. Mais avec un peu plus de foi, on n’aurait pas cru pour cela que leur extermination à tous fût nécessaire[8].
J’ai souligné cet « un peu plus de foi » car il dit bien, en creux, par quoi n’était pas motivée la croisade : miséricorde, amour du prochain. Église de Rome et royaume de France cherchaient à étendre et conforter leurs pouvoirs respectifs. En réprimant sauvagement les hérésies, la première perdit sa légitimité religieuse. Elle ouvrit ainsi la porte à la future Réforme – et ainsi, à une autre religion d’État qui, elle, ne s’embarrassa pas des principes de non-violence qui avaient animé les dissidents chrétiens jusque-là. On sait quelle horreur représentèrent les guerres de religion (après la guerre des paysans en Allemegne, au cours de laquelle Luther se rangea aux côtés des princes et les encouragea au massacre). Quant au royaume de France, on sait de reste comment il se construisit (et la République après lui) en laminant toute autonomie locale et/ou régionale, ce qui se traduisit, entre autres, par l’extinction de la plupart des langues qui avaient existé autrefois sur son territoire – les langues d’oc n’échappèrent pas à cette furie d’uniformisation.
C’est le début de ce processus que retrace Les cathares, ennemis de l’intérieur. Ce petit livre est parfaitement documenté et, si vous aviez déjà quelque idée un peu floue sur ce que furent les « cathares », il vous apportera de nombreux éclaircissements sur leur histoire, leurs idées et leur pratiques, autant que l’on puisse les connaître aujourd’hui. De plus, l’écriture d’Arnaud Fossier est simple et directe ce qui en rend la lecture très accessible, je dirais même agréable. Autant dire que je la recommande vivement.
franz himmelbauer, pour Antiopées, le 1er septembre 2025.
PS : Le livre sera en librairie vendredi 5 septembre.
[1] Éditions La Découverte, 2009.
[2] Ibid., Introduction, p. 7.
[3] Voir par exemple Jean-Louis Biget, « Les Cathares. Mise à mort d’une légende », L’Histoire, 94, 1986, p. 10‑21.
[4] Monique Zerner (dir.), Inventer l’hérésie ? Discours polémiques et pouvoirs avant l’Inquisition, Nice, 1998.
[5] La quatrième de couverture du livre nous apprend qu’il est historien médiéviste, enseignant à l’université de Bourgogne et que ses recherches portent sur l’Église et la religion au Moyen Âge.
[6] « En quoi consiste l’inspiration occitanienne », dans la livraison des Cahiers du Sud de février 1943: Le Génie d’Oc et l’homme méditerranéen, qui reprenait également un autre texte signé Émile Novis (pseudo de la philosophe), déjà paru dans la même revue en 1942 : « L’agonie d’une civilisation vue à travers un poème épique », sur la Chanson de la croisade contre les Albigeois.
[7] « L’agonie d’une civilisation… », loc. cit.
[8] « L’inspiration occitanienne », loc. cit.

Je ne pense pas qu’on puisse dire que la croisade anti-albigeoise a privé l’Eglise de sa « légitimité religieuse », si par légitimité vous entendez « consentement ». Les masses populaires de l’Europe chrétienne avait certainement oublié (ou n’avaient jamais entendu parler de) ces événements lorsque Luther parut sur la scène publique.