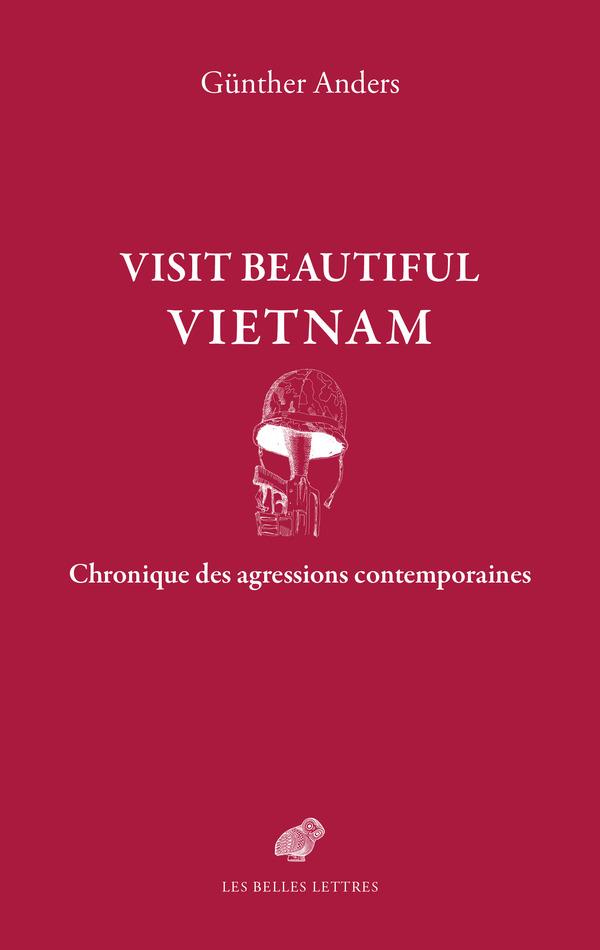 Günther Anders, Visit Beautiful Vietnam. Chronique des agressions contemporaines, trad. française (depuis l’allemand) et présentation par Nicolas Briand, Les Belles Lettres, 2024.
Günther Anders, Visit Beautiful Vietnam. Chronique des agressions contemporaines, trad. française (depuis l’allemand) et présentation par Nicolas Briand, Les Belles Lettres, 2024.
En 2025 (le 30 avril précisément), on fêtera – ou l’on commémorera tristement – le « jour de la réunification » selon les autorités de la RDV, République démocratique du Vietnam (jusque-là dénommée par les médias occidentaux « Nord-Vietnam ») – ou « le jour où nous avons perdu le pays », selon les Vietnamiens expatriés à ce moment-là. Un demi-siècle déjà, une paille pour le jeune homme de dix-neuf ans que j’étais alors et qui exultait en voyant les images du dernier hélicoptère décollant péniblement du toit de l’ambassade américaine à Saïgon, tachant de décrocher de ses patins les candidats fugitifs qui s’y étaient accrochés, faute de place à l’intérieur déjà bondé, je suppose. Je n’étais pas très porté sur la compassion envers les complices des régimes « fantoches », comme on disait alors, ceux que nous autres gauchistes de l’époque appelions les « laquais » de l’impérialisme américain (qui avait succédé à l’impérialisme français, hein, ne l’oublions pas dans nos prières, çui-là).
Autant dire que la traduction française, qui n’existait pas encore à ce jour, de ce recueil de textes de Günther Anders tombe bien. Son auteur, Nicolas Briand, nous explique en présentation de l’ouvrage[1] qu’elle intervient après une longue éclipse du texte en Allemagne même – il vient seulement d’y être réédité pour la première fois en 2023. Il faut dire que son auteur n’y allait pas avec le dos de la cuiller, comme on dit par ici, n’hésitant pas à comparer les alliés Américains d’alors (Anders publie ces textes en 1968, soit en pleine guerre froide) aux nazis et concluant que ceux-ci étaient « moins pires » que ceux-là… Scandaleux. Et pas seulement en 1968. Probablement qu’aujourd’hui encore, pas mal de gens seront choqués par cette comparaison… À ceux-là, on ne pourra que conseiller de se calmer d’abord, et de lire Anders ensuite, cela leur donnera peut-être à penser (c’est en tout cas tout le mal que je leur souhaite, en cette période des vœux).
Précisons tout d’abord que l’auteur, plus connu pour son célèbre L’Obsolescence de l’homme[2] (1956) fit partie du « Tribunal Russel », réuni en 1966 à l’initiative de Bertrand Russel et Jean-Paul Sartre pour dénoncer les crimes de guerre perpétrés par les États-Unis au Vietnam. « Lord Russel jugeait […] inutile [d’enquêter sur les crimes de guerre présumés commis par le Viet-Cong, comme s’il s’agissait de traîner en justice les Juifs du ghetto de Varsovie pour leur soulèvement contre les nazis », expliquait Ralph Schoenman[3]. Le tribunal tint deux séances en 1967 avant de rendre son verdict – condamnant les nombreux crimes de guerre américains et la guerre en elle-même, crime contre la paix en en tant que guerre d’agression. Anders assista aux deux sessions. Il « avait donc, dit Nicolas Briand, une connaissance de première main des événements du Vietnam, et Visit Beautiful Vietnam constitue en quelque sorte la retombée littéraire du procès ».
Un petit mot sur la forme de l’ouvrage : il s’agit d’un abécédaire – le sous-titre original est : ABC der Aggressionen (damals wie heute), ce que l’on pourrait traduire littéralement par : « ABC des agressions (hier[4] comme aujourd’hui) ». Les textes qui le composent sont classés suivant l’ordre alphabétique de leurs titres. On comprend que le titre de l’édition française n’ait pas cru bon de reprendre la notion d’abécédaire, puisque de facto, il était quasi impossible de reproduire le même ordre alphabétique, sauf à inventer des traductions par trop tordues. Par contre, je m’étonne un peu de ces agressions « contemporaines » – on aurait peut-être pu rester plus proche d’ « hier comme aujourd’hui ». Il me semble que cela peut induire un léger malentendu, ou du moins sous-estimer un des axes critiques suivis ici par Anders, soit la comparaison qui revient très souvent entre faits, discours, crimes de guerre nazis et américains. Nicolas Briand souligne à juste titre que l’intention du philosophe est, entre autres, de caractériser l’agression américaine contre le Vietnam comme inaugurant « une série de guerres d’un type nouveau, qu’il ne faut surtout pas confondre avec les précédentes, par exemple la Seconde Guerre mondiale. » Et de poursuivre : « Quelque cinq décennies après la fin de cette guerre [du Vietnam], [n]ous en avons compté quatre : Union soviétique vs Afghanistan, Usa vs Irak I, Usa vs Irak II, USA vs Afghanistan. Quant à l’actuelle guerre Russie vs Ukraine, elle est bien partie pour s’inscrire dans cette série. » À la différence des guerres de la France en Algérie et au Vietnam, par exemple, il ne s’agit plus de maintenir l’intégrité un Empire colonial. « La souveraineté formelle du vassal doit être maintenue. » Mais précisément, la guerre a pour but de maintenir cette souveraineté « creuse » et d’obliger le vassal à (re)faire allégeance au suzerain. En quoi les États-Unis comme l’URSS, malgré toute leur puissance militaire, ont échoué à peu près partout – sauf, dit Nicolas Briand, à l’issue de la première guerre du Golfe – mais, ajouterais-je, à court terme.
Cela dit, la comparaison avec la conduite de la guerre par les nazis est aussi un des axes structurants de l’ouvrage. Elle se développe sur plusieurs aspects. D’une part, l’industrialisation de la guerre – et du massacre. Lisez plutôt ce texte, intitulé « Les pauvres » (en allemand, Die Ärmsten – soit, littéralement : « Les plus pauvres ») :
Qui accuse ?
Nous ? Nous, le tribunal Russel ?
Cela ne nous est pas nécessaire. Nous rassemblons, vérifions et publions des documents.
Nous laissons aux Américains eux-mêmes le soin de s’accuser.
Car il n’est pas d’accusation plus terrible que ce rapport officiel sur les 77 000 tonnes de bombes du mois de mars 1967, au moyen desquelles l’armée de Johnson [le Président américain] a tenté d’exterminer le Vietnam, le cas échéant de sauver la liberté du monde libre. Aucun réquisitoire ne serait plus irréfutable que celui des Américains contre eux-mêmes.
77 000 tonnes. Que signifie ce chiffre ?
Que la Corée, qui dut subir le largage de seulement 17 000 tonnes par mois, dans ses jours les plus sombres, devait être un pays heureux.
Et que même l’Angleterre, pendant les jours effroyables du Blitz, fut sans doute une terre bénie, puisque la quantité de bombes qui s’est abattue sur le pays pendant toute la durée des cinq années de la Seconde Guerre mondiale est inférieure à celle larguée désormais mensuellement sur le Vietnam.
Non, aucun tribunal ne saurait proférer d’accusation plus accablante contre les Américains que celle qu’ils produisent eux-mêmes.
Empli d’angoisse et de pitié, on s’interroge : pour l’amour du ciel, comment les pauvres Johnson, Rusk [secrétaire d’État de 1961 à 1969], McNamara [secrétaire à la Défense de 1961 à 1968] et Westmoreland [général commandant des opérations au Vietnam entre 1964 et 1968] comptent-ils donc se défendre contre ce réquisitoire ?
Autre caractéristique de la guerre américaine, l’enrôlement des personnes de couleur contre d’autres personnes de couleur, dont Anders parle dans plusieurs textes, entre autres celui-ci : « Traité des couleurs[5] d’aujourd’hui : noir devant jaune devient blanc ». Ainsi :
Le droit des GI de couleur de se battre pour leur patrie, le cas échéant pour le « monde libre », et de tuer des Vietnamiens est trois à quatre fois plus élevé que celui de leurs concitoyens blancs. Tout au moins la population noire, qui ne constitue chez elle que 10% de la population totale, peut se vanter de représenter environ 20% de la puissance armée engagée au Vietnam. […]
Puisqu’il importe à la majorité de la population non noire de freiner pour le moins la lutte pour les droits civiques, c’est-à-dire de maintenir l’inégalité en l’état actuel le plus longtemps possible, il est opportun
1) de garder en dehors du pays le plus grand pourcentage possible des meilleures classes d’âge, susceptible d’accroître la force de frappe du mouvement des droits civiques ;
2) d’offrir aux sans-droits d’agir à leur tour en peuple de maîtres et de priver de droits d’autres gens. Dans le jeu des races mis en œuvre pour des raisons de classes se produisent les miracles les plus kaléidoscopiques de la métamorphose des couleurs : dans la lutte contre les Jaunes, les Noirs peuvent soudain se sentir Blancs. […]
La méthode consistant à consoler les sans-droits en leur accordant le droit d’ôter à leur tour le droit des autres, et d’en faire même un devoir national, correspond très exactement à celle introduite par le national-socialisme il y a trente-cinq ans[6]. De la même façon que Hitler offrit aux prolétaires, qu’il n’avait jamais eu l’intention, même en rêve, de libérer, les Juifs, soit un groupe de population face auquel les prolétaires obtenaient la chance de se sentir supérieurs et qu’ils avaient pour devoir national de maltraiter et de liquider ; de même aujourd’hui le gouvernement américain offre aux Nègres de son pays les peuples sous-développés hors de l’Amérique, en ce moment les Vietnamiens. Inversement ceux-ci, bombardés au napalm et carbonisés dans leurs villages, correspondent aux Juifs brûlés à Auschwitz. Comme on voit, les crimes d’aujourd’hui et leurs fonctions sociale et psychologique ressemblent beaucoup plus à ceux d’hier et à leur fonctions que supposé habituellement.
Mais ce qui compte ici est non seulement que la liberté de tuer au Vietnam, accordée aux hommes de couleur, est plus grande que toutes les libertés dont ils jouissent back home dans l’Amérique pacifique, mais aussi que celle de mourir s’est extraordinairement étendue pour eux sur le théâtre de guerre asiatique. Il serait certes exagéré d’affirmer que la dame blanche Amérique, qui proportionnellement envoie au Vietnam beaucoup plus de fils noirs que de fils blancs, vise directement à se débarrasser d’un grand nombre de ses enfants noirs. Mais la conséquence, à savoir que là où trois à quatre fois plus de gens se battent, trois à quatre fois plus tombent, ne lui est sûrement pas uniquement désagréable, même si elle s’en lave les mains sans arrêt. À l’ancienne devise, forgée à l’origine pour les autochtones : « The only good indian is a dead indian », s’est certainement substituée depuis longtemps la maxime, il est vrai sans qu’elle soit jamais prononcée à voix haute : « The only good nigger is a dead nigger ». […]
Autre texte qui développe la comparaison des méthodes américaines au Vietnam avec celles des nazis durant la Seconde Guerre mondiale – mais plutôt sur le plan de la communication, et surtout pour souligner cette fois la nouveauté radicale de la conduite des opérations au plan du discours. Il est titré : « La guerre consommée ».
Il m’apparaît aujourd’hui que les nazis n’étaient pas du tout d’une nouveauté aussi ahurissante que nous, naïfs, le pensions il y a trente-cinq ans. Car ils considéraient comme nécessaire, ou pour le moins comme opportun, de cacher leurs meurtres de masse et les méthodes qu’ils appliquaient. La réelle, l’historique nouveauté commence seulement avec les hommes d’aujourd’hui, avec ceux qui planifient la guerre au Vietnam, ou qui y prennent part , ou qui l’acceptent comme allant de soi, ou qui l’intègrent à leur industrie du divertissement. Car ces contemporains qui sont les nôtres ne se donnent plus la moindre peine de cacher ce qu’ils font ni les mesures qu’ils mettent en œuvre. Des expressions telles que le mot d’un général « to bomb them back into the stone age » [les renvoyer à l’âge de pierre à coups de bombes] ou le mot d’un comédien « the best slum clearing they ever had » [la plus belle rénovation de bidonvilles qu’ils aient jamais eue] ne passent absolument pas pour scandaleuses mais soit pour hawky [de hawk, faucon, soit intransigeant avec l’ennemi] – et ceci est, en toutes circonstances, patriotique –, soit pour funny. Comme il ne vient plus à l’idée de quiconque qu’il pourrait y avoir des instances devant lesquelles on pourrait avoir honte, ou plutôt puisqu’effectivement de telles instances n’existent plus, ils nous clouent le bec par ces mots qu’ils ne se lassent jamais de répéter : « We have nothing to hide. » [Nous n’avons rien à cacher.] Il est assez indifférent de les traduire par ceux-ci : « Of course, we are burning down villages » [Évidemment, nous brûlons des villages], ou par : « Of course, we are torturing people » [Évidemment, nous torturons des gens], ou par : « Of course, we are supposed to do it » [Évidemment, nous sommes censés le faire], aucune de ces traductions n’est moins bonne que les autres, chacune est tout aussi correcte qu’une autre. Car les journaux américains, et pas uniquement les organes d’opposition sans impact par leur faible tirage, mais, cela va de soi, ceux qui tirent à des millions d’exemplaires (et même les quatre ou cinq plus « raffinés » ne sont pas en reste), publient tous les jours des récits et des images des horreurs commises par « our boys ».[…]
Non, la morale n’est plus celle d’il y a un quart de siècle. Entre la situation de l’Allemagne nazie et celle des USA aujourd’hui, il existe une différence fondamentale, qui n’est absolument pas en faveur de ceux-ci. Quelque incontestable puisse être le fait qu’à l’époque des millions de gens en Allemagne étaient au courant, savaient telle ou telle chose des horreur commises dans les camps – malgré tout, celles-ci n’auraient jamais pu être reproduites ni leurs reproductions diffusées et projetées par millions, comme le sont aujourd’hui pour le public les horreurs américaines au Vietnam. Naturellement, ceci est devenu possible uniquement par le fait que les groupes économiquement dominants traitent la population exclusivement comme un public de consommateurs, et avec un tel succès que celle ci n’est déjà plus capable de se comporter autrement. Ce qu’on ne peut même pas lui reprocher. Ou bien est-on en droit d’attendre de millions de gens, à qui, bon an mal an, on a présenté tout et n’importe quoi (que ce soit des mariages de stars, des quartiers en feu à Watts [émeutes à Los Angeles en 1965], des inaugurations d’expositions universelles, des villages vietnamiens partant en fumée ou des feuilletons policiers) dans un état de totale déréalisation, à savoir sous forme de films ou de téléfilms, peut-on exiger de tels consommateurs de pictures que face à une sorte, une unique sorte spéciale d’images, ils adoptent soudain une attitude tout à fait nouvelle et inhabituelle, à savoir une attitude morale ?
Voici qui nous rappelle les thèses d’un contemporain d’Anders sur la société du spectacle. J’ai cru comprendre par des bribes de lecture à droite à gauche qu’il y avait eu – ou qu’il y avait encore – dispute sur le fait de savoir qui, du philosophe allemand ou de Guy Debord, avait influencé l’autre… Je ne suis pas assez savant pour en parler plus, mais quoi qu’il en soit, on peut constater certaines proximités entre les deux. Voyez ainsi ce début du texte titré « L’obsolescence du mensonge », qui semble faire écho à la thèse 9 de La Société du Spectacle[7] (à moins que ce ne soit l’inverse, encore une fois, je n’en sais rien, et je ne suis pas sûr que ce soit si important de le savoir), « Dans le monde réellement renversé, le vrai est un moment du faux » :
Affirmer que Johnson ment serait inexact. Johnson ne ment plus. Par quoi il ne faut évidemment pas comprendre qu’il était auparavant un imposteur et qu’il aurait pris goût désormais à la véracité. Bien plutôt que dans le monde auquel il appartient en tant qu’acteur et facteur, distinguer entre la vérité et le mensonge est déjà devenu futile et faux. Être constitué de mensonges fait partie de l’être ou du non-être de ce monde, le sien et le nôtre, d’une façon si évidente qu’en son sein mentir de surcroît devient superflu.
Ici, et sans vouloir en aucune manière faire assaut de pédanterie, on ne peut pas manquer de relever une autre proximité, au moins par la thématique traitée, soit la guerre du Vietnam et le mensonge pratiqué au plus haut niveau de l’État américain, avec Hannah Arendt (par ailleurs ex-épouse d’Anders) qui écrivit, à peu près à la même période qu’Anders, un essai sur le mensonge en politique[8] basé sur ce que l’on a appelé les « The Pentagon Papers » – soit 7 000 pages classées secret-défense, rédigées par trente-six officiers supérieurs et experts civils sur la conduite de la politique américaine au Vietnam de 1945 à 1967. Arendt analyse dans cet essai le décalage entre les informations précises et détaillées fournies par les services de renseignement et autres analystes militaires et spécialistes de l’Asie du Sud-Est et des relations internationales et les décisions prises par les dirigeants politiques, lesquels se souciaient moins de la situation réelle sur le terrain que – pour résumer brutalement – des élections et donc du conditionnement de l’opinion publique états-uniennne. « Aux nombreuses formes de l’art de mentir élaborées dans le passé, il nous faut désormais ajouter deux variétés plus récentes », écrit-elle. Les deux groupes à l’origine de ces innovations sont 1) les « responsables des relations publiques dans l’administration, dont les talents procèdent en droite ligne des inventions de Madison Avenue » – c’est-à-dire de l’industrie de la publicité, et 2) « les spécialistes de la résolution des problèmes ; ils sortaient des universités et de divers instituts de recherche pour entrer dans l’administration, certains solidement armés de l’analyse des systèmes et de la théorie des jeux, et prêts, pensaient-ils, à résoudre n’importe quel “problème” de politique étrangère. »
Et voici par où elle se rapproche plus particulièrement de Günther Anders dans son analyse du traitement de la guerre du Vietnam par les autorités états-uniennes :
Faire de la présentation d’une certaine image la base de toute une politique – chercher, non pas la conquête du monde, mais à l’emporter dans une bataille dont l’enjeu est « l’esprit des gens » – voilà bien quelque chose de nouveau dans cet immense amas de folies humaines enregistrées par l’histoire. […]
Ce qui surprend, c’est l’ardeur avec laquelle des douzaines d’« intellectuels » apportèrent leur soutien enthousiaste à cette entreprise axée sur l’imaginaire, peut-être parce qu’ils étaient fascinés par l’ampleur des exercices intellectuels qu’elle paraissait exiger. Répétons-le, pour ces spécialistes de la solution des problèmes, accoutumés à transcrire, partout où cela est possible, les éléments de la réalité dans le froid langage des chiffres et des pourcentages, il peut être tout aussi naturel de ne pas avoir conscience de l’effroyable et silencieuse misère que leurs « solutions » – la pacification et les transferts de populations, la défoliation, l’emploi du napalm et des projectiles antipersonnels – réservaient à un peuple « ami » qu’il leur fallait « sauver », et à un « ennemi » qui, avant que nous l’attaquions, n’avait ni l’intention ni le pouvoir de nous être hostile.
Sur ce , je m’arrête, car je crains de dériver encore longtemps parmi les écrits des opposants, trop rares bien sûr, mais néanmoins incontournables, à cette guerre. Je suppose que les écrits d’Arendt (pour ne pas parler de ceux de Debord) sont déjà largement connus. Une partie de ceux de Günther Anders l’étaient déjà aussi. Mais cette dernière publication vaut vraiment le détour. J’ai omis volontairement de reprendre les comparaisons – les échos – qu’a provoqués chez moi cette lecture avec le génocide toujours en cours à Gaza. Mais si vous lisez ce livre, ce que je vous recommande chaudement, vous en jugerez par vous-même.
Ce 29 décembre 2024, franz himmelbauer pour Antiopées.
[1] Bonne présentation du contexte et du contenu de l’ouvrage, si ce n’est que son auteur se laisse peut-être un peu emporter lorsque, après avoir souligner comment Anders cherche à gagner l’adhésion de ses lecteurs en utilisant « l’ironie, la satire, l’humour noir , l’art “karl krausien” du persiflage et l’allégorie littéraire comme autant de loupes grossissantes », observation tout à fait pertinente, il conclut ainsi son texte : « Günther Anders cultivait le même humour désespéré que Stanley Kubrick, celui de Docteur Folamour et de Full Metal Jacket. » Je ne trouve pas que ce soit le même humour dans les deux films je trouve même le second plutôt sinistre. Et c’est pourquoi je ne peux pas adhérer à la dernière phrase de Briand : « Si vous avez souri à la vision de Full Metal Jacket [non, en fait], alors vous allez rire aux éclats [de bombes ?] à la lecture de Visit beautiful Vietnam ». Hum… Je crains de ne pas partager le sens de l’humour qi s’exprime ici. Mais bon, ça ne change rien à la qualité de la traduction et du reste de la présentation.
[2] Je ne présente pas plus longuement Günther Anders, dont on trouvera facilement, si nécessaire, une biographie sur Wikipédia. Intellectuel allemand, premier mari d’Hannah Arendt et cousin de Walter Benjamin, il fuit le nazisme et rentre des États-Unis après-guerre, mais ne voudra pas retourner en Allemagne, où le philosophe Ernst Bloch lui proposait une chaire de philosophie à Halle, en RDA (Allemagne de l’Est), préférant s’établir en Autriche.
[3] Ralph Schoenman était le secrétaire personnel de Bertrand Russel. J’ai trouvé cette citation dans l’article de Wikipédia sur le Tribunal Russel. Je me demande ce qu’aurait dit Lord Russel sur les crimes de guerre du Hamas et le génocide commis par Israël à Gaza.
[4] J’avoue que je m’éloigne moi-même un peu de la littéralité : « damals » n’est pas littéralement « hier », mais plus tôt « alors », au sens de « à l’époque ».
[5] Allusion Traité des couleurs de Goethe.
[6] Pour mémoire, Hitler accède au pouvoir début 1933. Ce texte date donc probablement de 1968, année de la publication de l’abécédaire dont les textes ne sont pas datés, mais seulement, comme on l’a vu, classés par ordre alphabétique des titres – celui-ci figure au début du volume, ce qui indique au passage qu’Anders ne s’est pas contenté d’une sorte de « journal », mais a bien « composé » son ouvrage.
[7] Page 19 de l’édition en Folio à laquelle je me réfère (Gallimard 1992).
[8] Hannah Arendt, « Du mensonge en politique », in Du mensonge à la violence, Pocket Agora, 1994 [Calmann-Lévy 1972], p. 7-51.
