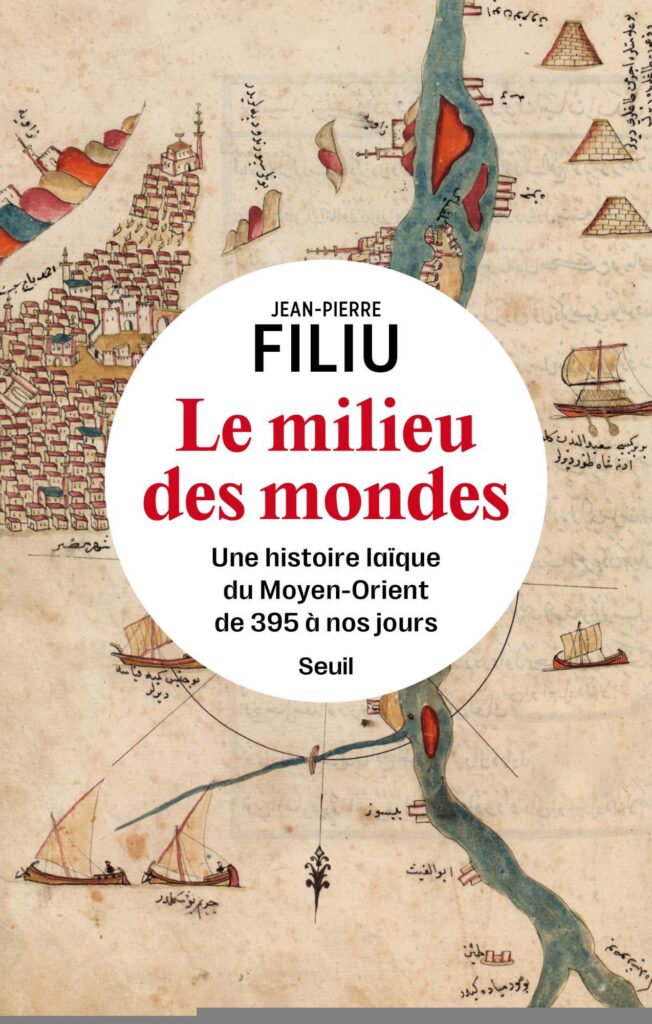 Jean-Pierre Filiu, Le Milieu des mondes. Une histoire laïque du Moyen-Orient de 395 à nos jours, Seuil, 2021
Jean-Pierre Filiu, Le Milieu des mondes. Une histoire laïque du Moyen-Orient de 395 à nos jours, Seuil, 2021
Le traitement de l’actualité internationale, et particulièrement de celle du Moyen-Orient, par les médias mainstream, peut faire croire que les conflits qui déchirent la région relèvent en dernière instance d’antagonismes religieux irréductibles – entre obédiences de l’islam : sunnites et chiites, ou entre juifs et musulmans (sans parler des autres « minorités » comme les Druzes ou les différentes Églises chrétiennes dites « d’Orient », entre autres). Le mérite de du livre de Jean-Pierre Filiu est de nous faire découvrir une histoire autrement complexe où les constructions étatiques et politiques, puis la colonisation et enfin les manœuvres des grandes puissances extérieures à la région tiennent au moins autant de place que les religions. Pour autant, il ne verse pas dans la mythification de cette complexité, trop souvent évoquée à travers cette citation du général de Gaulle : « Vers l’Orient compliqué, je volais avec des idées simples[1] ».
Bien au contraire, Jean-Pierre Filiu[2], professeur des universités en histoire du Moyen-Orient à Sciences Po Paris, propose avec ce livre un travail de vulgarisation au bon sens du terme. Et certes il n’est pas facile d’en rendre compte ici, tant la période couverte est longue et les événements à traiter nombreux.
Le choix d’une histoire politique, y compris dans le domaine religieux, prévient-il dans son texte d’ouverture : « Une histoire laïque », amène à accorder une attention prioritaire aux processus de constitution des pouvoirs et à leurs espaces de domination. C’est pourquoi les frontières et les batailles seront régulièrement évoquées, sans fascination aucune pour les développements militaires, mais parce qu’on se bat beaucoup au Moyen-Orient, et ce jusqu’à aujourd’hui[3]. Cette prégnance de la guerre a d’ailleurs transformé la région en une épouvantable « terre de sang » à au moins quatre reprises, lors des deux vagues d’invasions mongoles de 1256-1261 et de 1393-1404, au cours de la Première Guerre mondiale et depuis la contre-révolution arabe de 2011, voire dès l’invasion de l’Irak en 2003. L’approche ainsi privilégiée ne permet pas de développer une réflexion d’ampleur sur les sociétés concernées. Quant aux acteurs signalés, ils sont pratiquement tous masculins et les femmes ne sont mentionnées qu’en tant qu’épouses, à l’exception de la soufie Rabia al-Adawiyya[4], de la sultane Chajar al-Dour[5] ou des féministes de la Nahda[6]. Nul doute qu’une réflexion de longue durée, menée sous l’angle des sociétés ou du genre, serait passionnante. Tel n’est pas le propos de cet ouvrage (p. 17-18).
Ces réserves prises en compte, reste un excellent « guide-âne », un mémento très complet (380 pages grand format) si vous préférez. Rappelant dans ce même texte introductif qu’il a voulu répondre à « une forte attente […] de mise en perspective dans la très longue durée d’une actualité moyen-orientale qui suscite l’intérêt et les passions, mais aussi le trouble, voire l’angoisse », son auteur revendique l’« esprit didactique », inspiré des cours qu’il a donnés à Science Po, qui préside à l’organisation de l’ouvrage, dont chacun des dix chapitres (correspondant à dix périodes historiques) « est suivi d’une chronologie indicative et de suggestions bibliographiques » ; de plus figurent en fin d’ouvrage deux index très détaillés des noms de personnes et de lieux et, au milieu, « un cahier hors-texte de vingt cartes [qui] met en regard, pour chacun des chapitres, une vision d’ensemble du Moyen-Orient au début de la période concernée et une carte dédiée à une des dimensions de l’histoire régionale, à chaque fois différente », ce qui, au total, fait de ce livre un outil fort utile à qui, comme moi, ignore à peu près tout de l’histoire de ce « milieu des mondes ».
À propos, justement, de cette appellation, Jean-Pierre Filiu en donne la définition suivante :
La mer Noire, les contreforts du Caucase et la mer Caspienne définissent au nord les contours du Moyen-Orient, qui, au sud, se prolonge jusqu’en Haute-Égypte et inclut la péninsule Arabique. Ce sont le Sahara et son immense désert de Libye qui en représentent les limites africaines, forcément imprécises. La région s’étend à l’est jusqu’au Khorassan, le Levant de la Perse, dont les frontières fluctuent au cours des siècles, incorporant parfois une partie de l’Afghanistan et du Turkménistan actuels. […] Le Moyen-Orient, à cheval entre l’Asie et l’Afrique, s’impose en carrefour entre ces deux continents, ainsi qu’entre l’Asie et l’Europe. Il se trouve au centre névralgique de deux routes terrestres appelées à marquer leur temps, la « route de la Soie » vers l’Asie centrale et la Chine, et la « route des Indes » (p. 13)[7].
Quant aux limites temporelles de cet ensemble, Filiu, qui étend son étude jusqu’à nos jours, en a fixé le début en 395. Pourquoi cette date ?
[Ce choix] correspond à la fondation de l’Empire romain d’Orient. Le Moyen-Orient émerge alors en entité spécifique, dégagée d’une domination extérieure, tandis que s’affirme une Chrétienté d’Orient, tournée vers Byzance plutôt que vers Rome. Ce choix répond à la volonté de suivre des dynamiques proprement moyen-orientales, et non la simple projection dans cette région de rivalités de puissances extérieures, même si celles-ci auront toute leur place [dans ce livre], notamment à l’époque contemporaine. La borne de 395 permet aussi de poser le Moyen-Orient en pôle de stabilité étatique et de construction institutionnelle face à un « Occident » alors soumis aux invasions barbares et aux sacs successifs de Rome. Il n’est pas inutile de souligner un tel renversement de perspective, en ces temps où la Chrétienté inventait en Orient, hors de la hiérarchie cléricale, et parfois contre elle, le culte des saints et la vocation monastique, appelés à tant façonner l’« Occident chrétien ». De surcroît, 395 est, en tant qu’année d’établissement d’un ensemble politique, libérée de la charge attachée aux dates fondatrices des calendriers monothéistes que sont 0 et 622. Elle offre ainsi une plus sûre opportunité de s’émanciper de l’emprise symbolique de ces deux années zéro, tout en intégrant l’importance d’un monothéisme disparu, le zoroastrisme, religion d’État de la Perse sassanide.
Ce livre est une véritable mine d’informations historiques, géographiques et géopolitiques. À mon sens, il ne faut pas forcément chercher à le lire d’un bloc, comme je l’ai fait, car forcément, la répétition des guerres, des prises de terres par les uns puis les autres, des ascensions et des chutes des empires, tout cela peut lasser. Par contre, il me semble qu’on devrait toujours l’avoir à portée de main lorsque l’on s’intéresse à la région. Car si l’histoire ne détermine pas fatalement le présent, elle en explique bien des aspects qui nous paraissent obscurs à première vue, et surtout, elle nous permet aussi de décrypter, au moins en partie, les discours et les stratégies des acteurs d’aujourd’hui.
On aura bien compris que je ne vais pas me lancer dans un « résumé » impossible (et insensé) de cette histoire. Toutefois, je voudrais revenir sur au moins un point qu’il me paraît important de souligner, celui de l’« invention du Middle East » – titre d’une section du chapitre 6 : « L’expansion coloniale (1798-1912) » – et je terminerai par là cette brève recension, en recommandant vivement la lecture (même fractionnée, comme je le disais plus haut) de ce livre.
La consolidation de l’empire des Indes [britannique] et de [son] grand dessein africain[8] s’accompagne d’une avancée méthodique sur les rivages de la péninsule Arabique. C’est d’abord le port stratégique d’Aden qui est occupé par les forces britanniques en 1839, avant […] de se retrouver au centre d’un faisceau d’accords de « protection » avec les tribus environnantes. C’est ensuite la très redoutée « côte des Pirates » qui est pacifiée en 1853 en « côte de la Trêve » sur le territoire actuel des Émirats arabes unis. La puissance du sultanat d’Oman est affaiblie, en 1861, par la mainmise britannique sur Zanzibar, source du précieux clou de girofle. Londres arbitre aussi les rivalités entre les familles Al-Thani au Qatar et Al-Khalifa au Bahreïn, celle-ci devant reconnaître l’indépendance de celle-là, en 1868, avant que le Bahreïn ne passe sous protectorat britannique en 1880. Une série de traités accentue progressivement le contrôle de Londres sur la rive méridionale du golfe Persique. Ce dispositif est couronné en 1899 par le basculement de l’émirat du Koweït sous la tutelle de Londres. Le camouflet est cinglant pour l’Empire ottoman, dont la province d’Irak n’a plus accès au golfe Persique que par l’étroite embouchure du Chatt al-Arab, la « rive des Arabes », soit l’estuaire commun au Tigre et à l’Euphrate. La Sublime Porte en nourrit un irrédentisme virulent à l’encontre du Koweït ainsi « protégé ». De telles revendications annexionnistes seront reprises en Irak par le nationalisme arabe, durant la seconde moitié du XXe siècle. [Ici, on se souviendra de la première guerre américaine du Golfe, menée contre l’Irak de Saddam Hussein en 1991 afin de « libérer » le Koweït de l’occupation irakienne.]
Cet apogée impérial inspire une conceptualisation inédite du Middle East par le futur amiral américain Alfred Mahan. Très influent professeur d’académies militaires [celui-ci] affirme [en 1902] dans la revue des conservateurs britanniques, que la clef de l’hégémonie mondiale réside dans le contrôle du « Moyen-Orient », un terme inventé pour l’occasion. Ce carrefour de trois continents se situe en effet à la croisée du canal de Suez et de la route des Indes, donc des axes terrestre et maritime de communication entre l’Europe et l’Asie. Un tel espace est alors désigné sous le nom générique d’« Orient », en référence à la question du même nom, après avoir été longtemps appelé « Levant » […] Orient et Levant correspondent tous deux à la notion arabe de Machrek, opposé au Maghreb, cet Occident d’Afrique qui n’a jamais été qualifié de « Ponant ». Mahan énonce, depuis l’hémisphère occidental, la centralité géopolitique d’un Orient devenu par la même « Moyen ». Sa vision du Moyen-Orient comme gisement de puissance, bien antérieure à l’exploitation des hydrocarbures, demeure d’une troublante actualité (p. 202-203).
franz himmelbauer, pour Antiopées, le 12 mai 2024.
[1] « Rarement phrase de Charles de Gaulle aura été autant citée hors de son contexte, voire à contre-sens », écrivait par ailleurs Jean-Pierre Filiu (dans un post de retronews.fr), à quoi il ajoutait : « Cette phrase ouvre le chapitre “L’Orient” du premier tome des Mémoires de guerre. Nous sommes en avril 1941 et c’est vers Le Caire que “vole” l’homme de l’appel du 18 juin. Après des premiers succès militaires, surtout sur le continent africain, il veut désormais implanter la France libre au Levant. »
[2] En rédigeant cette note, je réalise que j’avais déjà rendu compte d’un livre de Jean-Pierre Filiu : Algérie, la nouvelle indépendance, paru au Seuil fin 2019. On trouvera par ici la recension de cet ouvrage consacré au « hirak », ce formidable mouvement du peuple algérien de 2019-2020.
[3] Je me permets de rappeler que ce « aujourd’hui » date de l’année de publication de l’ouvrage : 2021 – et ce même si l’on ne se bat pas moins au Moyen-Orient aujourd’hui en 2024…
[4] Rabia al-Adawiyya (713-801). Jean-Pierre Filiu la cite, en même temps qu’un autre ascète de Bassora, comme elle, le prêcheur Hassan al-Basri (642-728), comme l’une des premières inspiratrices du soufisme.
[5] Chajar al-Dour, littéralement « l’Arbre aux joyaux », esclave affranchie et épouse favorite du sultan Salih, souverain de l’Égypte au moment du débarquement de la septième croisade, en 1259, fut proclamée sultane (après la mort de Salih) par les Mamelouks. Ceux-ci, eux-mêmes anciens esclaves (Mamelouk signifie « Possédé » en arabe) recrutés par le sultan afin d’assurer sa garde prétorienne et des fonctions militaires, finirent par exercer la réalité du pouvoir en Égypte – mais avant de se décider à nommer officiellement l’un d’entre eux au sultanat, ils passèrent par la désignation de cette sultane éphémère (son règne ne dura que trois mois).
[6] Nahda (littéralement : « Renaissance ») : il s’agit d’un mouvement d’émancipation arabe du XIXe siècle que l’on a souvent comparé aux Lumières européennes, cette comparaison présentant toutefois le défaut majeur de laisser à penser que ces « Lumières arabes » auraient été importées d’Europe avec les premières entreprises à visée coloniale, particulièrement celle, en 1798, de Bonaparte en Égypte. Cependant, comme l’écrit Jean-Pierre Filiu, « les processus de modernisation qui […] traversent [les sociétés arabes] ont […] leur logique propre, parfois encouragée par la pression extérieure, mais souvent bridée, voire brisée, par l’aveuglement colonial » (p. 213).
[7] À qui s’intéresserait de plus près à l’appellation de « Moyen-Orient », je conseille vivement la lecture de trois articles très instructifs de Vincent Capdepuy, tous trois disponibles en ligne sur Orient XXI : Moyen-Orient, une géographie qui a une histoire, parties 1 et 2, et Comment fut inventé le Moyen-Orient. Comme on peut s’en douter, cette géographie est celle des Occidentaux, et avant tout celle de la colonisation anglaise et française – avant l’américaine, une histoire que raconte aussi en détail Le Milieu des mondes.
[8] Ce « grand dessein africain » s’est matérialisé, entre autres, en 1898, quand « la plus forte résistance militaire africaine fut écrasée » lors de la bataille d’Omdurman, au Soudan. L’armée de Sa Gracieuse Majesté, son artillerie, ses mitrailleuses et ses armes automatiques taillèrent en pièces une armée indigène d’insurgés qui avaient défié l’Empire britannique durant quelques mois. Dans Exterminez toutes ces brutes (éd. française Le Serpent à Plumes, 1998, section 55), Sven Lindqvist cite le récit de Winston Churchill qui participa à cette bataille en tant que jeune officier – il avait alors vingt-quatre ans :
Les drapeaux blancs [de l’armée du Mahdi, soit un prophète venu réhabiliter l’islam face aux envahisseurs étrangers] avaient presque dépassé la crête. Encore une minute, ils seraient pleinement visibles par les batteries. Se rendaient-ils compte de ce qui les attendait ? Ils formaient une masse dense [c’était une armée de 15 000 hommes environ], à 2 800 yards de la 32e batterie de campagne et des canonnières. Les portées étaient connues. C’était une simple question mécanique…
L’esprit était fasciné par l’horreur à venir. Je la voyais déjà. […] Ils franchirent la crête et se trouvèrent pleinement exposés à la vue de toute notre armée. Leurs bannières blanches les mettaient bien en évidence. Lorsqu’ils virent le camp de leurs ennemis, ils déchargèrent leurs fusils dans un grand vacarme et augmentèrent l’allure… Pour un moment, les drapeaux blancs avancèrent en bon ordre, toute la division franchit la crête et fut exposée au feu.
Environ vingt obus les frappèrent dans la première minute. Certains explosèrent en l’air, d’autres au milieu de leurs visages. D’autres, encore, s’enfoncèrent dans le sable et, en explosant, projetèrent des nuages de poussière rouge, des éclats et des balles dans leurs rangs. Les drapeaux blancs pointèrent dans toutes les directions. Pourtant, ils se relevèrent immédiatement, comme d’autres hommes s’avancèrent pour mourir pour la cause sacrée des Mahdis et pour la défense du successeur du Vrai Prophète et du Seul Dieu. […]
À huit cents yards, une ligne inégale d’hommes s’approcha désespérément. Des bannières blanches vacillèrent et tombèrent, des silhouettes blanches s’écroulèrent par douzaines…
Les fantassins tiraient régulièrement et impassiblement, sans hâte ni excitation, car l’ennemi était loin… En outre, les soldats étaient pris par leur tâche et faisaient de leur mieux. Mais, bien vite, cet acte purement mécanique devint monotone.
Les fusils devinrent chauds – si chauds qu’il fallut les changer pour ceux des compagnies de réserve. Les mitrailleuses Maxim épuisèrent toute l’eau contenue dans leurs manchons… Les douilles vides tombaient en tintant sur le sol et formèrent bientôt un tas sans cesse croissant à côté de chaque homme.
Et durant tout ce temps, sur la plaine, les balles fendaient les chairs, brisaient les os en éclats ; le sang giclait de blessures terribles ; des hommes vaillants avançaient dans un enfer de métal sifflant, d’explosions d’obus et de nuées de poussière – ils souffraient, perdaient espoir et mouraient. […] (Le soulignement est de Lindqvist)
La grande armée des Derviches qui avait avancé au lever du soleil, pleine d’espoir et de courage, fuyait désormais dans la plus extrême déroute, poursuivie par le 21e lanciers, et laissait derrière elle plus de neuf mille morts et davantage encore de blessés.
«Ainsi s’acheva la bataille d’Omdurman – la plus éclatante victoire jamais remportée sur les barbares par les armes de la science. En cinq heures, la plus forte armée de sauvages jamais dressée contre une puissance européenne moderne avait été détruite et dispersée, sans guère de difficultés, avec, en comparaison, peu de risques et des pertes insignifiantes pour les vainqueurs. (Ici, c’est moi qui souligne.)
