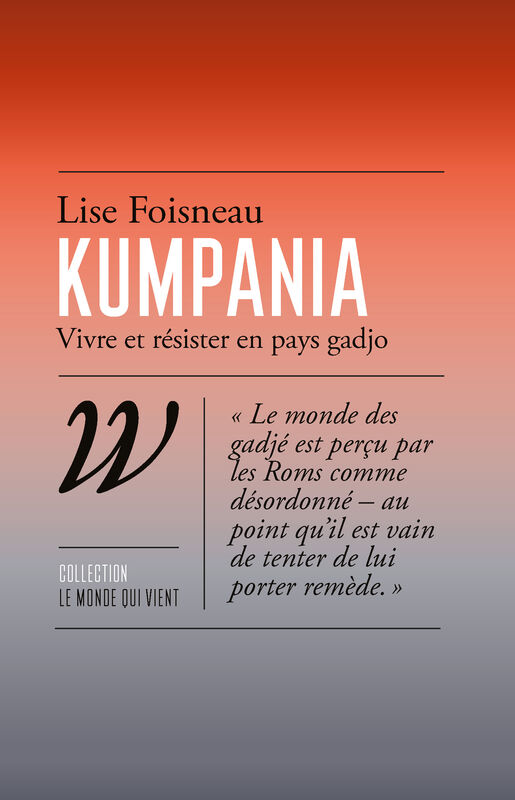Lise Foisneau, Kumpania. Vivre et résister en pays gadjo, Wildproject, 2023.
Qu’est-ce qu’une kumpania ? C’est tout l’objet de ce livre que de répondre à cette question. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ce n’est pas simple, tant cette formation sociale, que j’aurais tendance à nommer une « forme-de-vie », est déroutante (sans jeu de mots, même s’il est ici aussi question de routes) pour nous autres gadjé (pluriel de gadjo, qui désigne en romanès les sédentaires, soit ceux qui ne font pas partie des kumpanji, voire même qui auraient plutôt tendance à les harceler, en temps de paix, à les persécuter en temps de guerre – tel l’État français de Vichy qui collabora activement à l’entreprise d’extermination des « tziganes » par les nazis).
Voici donc un essai d’anthropologie, une ethnographie dont la première et essentielle qualité vient du point de vue adopté, qui est, autant que possible, le point de vue de celles dont elle parle[1]. Car Lise Foisneau, afin de mener à bien son étude sur les « Roms de Provence » (on reviendra sur cette appellation), a vécu avec eux, tout simplement, plusieurs années en caravane – avec elles, en fait, puisqu’elle a surtout partagé la vie des femmes, tandis que son compagnon Valentin, lui, partageait celle des hommes. Autant dire tout de suite que ce livre m’a énormément plu – et appris. Une fois n’est pas coutume, je citerai ici un extrait du dossier de presse de l’éditeur, dont je partage complètement l’avis, et qui cite lui-même Michel Stewart[2], auteur de travaux reconnus sur les Roms : « Un immense plaisir de lecture. Une avancée significative dans la connaissance des Roms de France. Une enquêtrice hors du commun. Une nouvelle voix puissante et significative en anthropologie. »
Lise Foisneau et son compagnon ont donc adopté le statut de « gens du voyage », catégorie administrative qui englobe des collectifs très différents les uns des autres, particulièrement les kumpanji – donc les Roms – et les Voyageurs, lesquels, si j’ai bien compris, ne partagent pas du tout le même type de vie collective (j’ai failli écrire « d’organisation collective », mais le terme d’« organisation » me semble très éloigné du monde que nous fait découvrir ce livre). Quand je dis « vie collective », il ne faut pas se méprendre : ceux que Lise Foisneau appelle souvent ses « voisins », parce qu’ils ont placé leurs caravanes sur la même « aire d’accueil[3] » ou sur la même « place » pour un certain temps, sont des individus à part entière, si j’ose dire : « Fondamentalement, écrit-elle, la structure du collectif des Roms de Provence est individualiste, au sens où chaque caravane forme une entité autonome, et égalitaire, dans la mesure où aucune caravane n’est considérée comme supérieure aux autres, et qu’il n’y a pas de chef de la kumpania. » Par ailleurs, si le monde des kumpanji existe depuis longtemps et semble devoir perdurer encore longtemps, chaque kumpania, elle, est éphémère : elle s’agrège et se désagrège au gré des rencontres, des antipathies et des sympathies ainsi que des possibilités matérielles – des lieux, essentiellement. La kumpania est « un assemblage d’éléments singuliers, dans un lieu lui aussi singulier, assemblage appelé à se fragmenter et à se recomposer de façon imprévisible dans un autre lieu, ouvrant de la sorte de nouvelles possibilités de cohabitation ». Lise Foisneau se réfère à Patrick Williams, autre célèbre anthropologue[4], qui avait « proposé de définir la kumpania comme “l’échantillon de la société rom” ». « Cette qualification en termes d’échantillon est particulièrement pertinente car elle exprime au mieux le rapport quasi métonymique qui existe entre une kumpania déterminée et l’ensemble dans lequel elle s’inscrit : il ne s’agit pas de la partie figée d’un tout fermé, mais d’un fragment ouvert d’un ensemble en mouvement. » Elle précise ensuite qu’elle préfère remplacer le terme de « société » par celui de « collectif ». « Cette substitution a un corollaire épistémologique important : plutôt que de dire que l’échantillon “représente” la société rom, nous mettrons en évidence les relations qui font de chaque échantillon un tout selon un principe de mise en abyme ou de relation microcosme-macrocosme. » J’ai souligné ce mot : relations, car il me semble essentiel ici. En effet, comme on peut l’observer parmi d’autres groupes non occidentaux, l’individualisme rom ne se conçoit que comme système de relations. C’est ainsi qu’à son tour, chaque individu est lui-même, elle-même, un échantillon de la kumpanija. Ou, pour le dire mieux avec Lise Foisneau : « Chaque personne est ainsi, littéralement, un point de rencontre qui singularise la multiplicité des relations constitutives de la kumpania. » Elle cite aussi l’anthropologue Marilyn Strathern décrivant ce qu’est la personne en Mélanésie : « La personne singulière peut-être imaginée comme un microcosme social. »
Comment est-il possible que ce collectif des Roms de Provence[5] ait réussi à se maintenir en vie envers et contre, au mieux, l’incompréhension, au pire l’hostilité ambiante des gadji et les multiples tentatives de l’État de les empêcher de vivre comme ils l’entendent ? C’est ce que décrit Kumpania, dont il faut répéter ici le sous-titre : Vivre et résister en pays gadjo. Le « et » est important : car il ne faudrait pas réduire les formes-de-vie originales des Roms à la seule « résistance » contre les préjugés, les humiliations, les mesures de contrôle social qui leur sont imposées. Bien loin de là, ce livre décrit les usages quotidiens au sein d’une kumpania, ses modes d’apparition – de rencontres – et de disparition (Lise Foisneau parle de leur ressemblance avec les « sociétés fugitives » de la Zomia décrites par James C. Scott, ces groupes humains des collines et montagnes du Sud-Est qui, cherchant à échapper à l’emprise des États des rizières établis dans les vallées, avaient développé tout un « art de ne pas être gouvernés[6] ») : « Telles que les Roms de Provence les forment, les kumpanji sont des unités flexibles de taille variable qui gardent leur forme et leurs règles lorsque les individus qui les composent et les relations qu’ils entretiennent changent. » Le livre s’organise « autour de l’étude des rencontres qui structurent ces collectifs : la première partie, “Former une kumpania” [décrit] les rencontres des personnes qui forment les compagnies, la seconde partie, “Un monde de lieux” [montre] en quoi les lieux sont des membres à part entière des compagnies, et la dernière partie, “Kéthané, ‘être ensemble’ : les rythmes de la kumpania”, [retrace] le tissage de la multiplicité des rencontres qui assure la vitalité quotidienne des compagnies et qui président à leur fragmentation et à leur reconfiguration ».
Je ne vais pas m’aventurer ici à les résumer. Avant de conclure, je dirai tout de même que ces trois parties sont absolument passionnantes à lire, car elles regorgent de descriptions très concrètes de la vie quotidienne d’une kumpania depuis sa formation jusqu’à sa déagrégation (volontaires l’une comme l’autre), descriptions dont se nourrit la réflexion théorique.
Je voudrais simplement terminer sur ce que m’a inspiré cette lecture : tout d’abord une certaine perplexité, puis un vague sentiment de vertige, comme lorsque l’on perd ses repères. Car c’est un monde bien différent du nôtre (du mien en tout cas) que j’y ai découvert. Puis, petit à petit, j’ai commencé à me familiariser avec les voisins et voisines de Lise et Valentin – la dernière scène du livre a lieu dans une maternité : les deux gadji deviennent marraine et parrain de Moïse, enfin, Moïse « pour les papiers », dans la vie ce sera Noé. Comme quoi, ils sont devenus membres à part entière de la kumpania. Lise Foisneau a très bien réussi à rendre sensible cette aventure de la rencontre, et à nous y associer, en quelque sorte. « Mais, prévient-elle, devenir membre d’une kumpania exige l’apprentissage d’un art politique : celui de savoir se positionner, d’interrompre les relations lorsque l’équilibre vacille, et de se repositionner au bon moment. » Et c’est bien l’évocation de cet « art politique » qui, finalement, a métamorphosé ma perplexité initiale en une vision sûrement un peu folle – mais pourquoi s’interdire de rêver ? – : et si nous autres qui, longtemps, avons galéré entre les « organisations » héritées du mouvement ouvrier et les « communautés » de la soi-disant « alternative » post-68, nous mettions à l’école des kumpanji ? Après tout, c’est un peu ce qu’ont fait Lise et Valentin, comme en témoignent ces derniers mots du livre, qui seront aussi les derniers de cette petite recension d’un grand livre, à lire toutes affaires cessantes si, comme moi, vous rêvez d’un renouvellement radical de nos pratiques collectives :
« Le jour de la naissance de Noé, mes voisins se sont plus à l’imaginer en gadjo, donnant un nouveau sens à leur rencontre avec des ethnographes avec lesquels ils étaient “restés[7]” pendant plusieurs années. C’était aussi une façon de nous inviter à former de nouvelles compagnies avec eux. Car ces dernières sont ouvertes sur le monde et agrègent chaque jour, et depuis toujours, des individus isolés, errant eux aussi dans les interstices du naturalisme[8]. Au sein de nos États européens, au détour d’une route, sur un parking, sur un stade, dans un champ, les Roms (ceux qui s’assemblent en compagnies) montrent que des collectifs aux formes politiques acéphales n’ont pas encore capitulé face à la machine étatique et hiérarchique. Loin de toute utopie, les compagnies des routes sont là. »
Le 23 avril 2023, franz himmelbauer pour Antiopées.
[1] Lise Foisneau s’en explique dans son Introduction : « Le défi d’une ethnographie des Roms de Provence est d’éclairer l’extraordinaire vitalité de ce collectif en tirant de l’ombre l’histoire qu’il a traversée et en montrant le type de contraintes auxquelles il est soumis. L’histoire de ce collectif n’a été jusqu’ici envisagée que du point de vue de l’administration ou de l’étude de phénomènes migratoires. Or, pour lui restituer toute son épaisseur, cette histoire doit aussi être écrite par “en bas”, du point de vue de ses acteurs, à la façon dont les historiens ont mis en œuvre de nouvelles méthodes pour décrire les groupes dominés. » Et elle donne en référence, à titre d’exemple, la Contre-Histoire des Etats-Unis de Roxanne Dunbar-Ortiz, parue également chez Wildproject en 2018, et dont j’ai rendu compte ici-même il y a peu.
[2] De lui, on peut lire : Michel Stewart & Patrick Williams (dir.), Des Tziganes en Europe, Éditions de la maison des Sciences de l’homme, 2015 (y figure entre autres son texte : « Une catastrophe invisible. La Shoah des Tziganes »).
[3] « Aire d’accueil » mérite vraiment ses guillemets, car avec l’accueil, cela n’a pas grand-chose à voir. Créées par la loi Besson de 1990, ce sont en général des « non-lieux » bétonnés, grillagés et surveillés, dotés de quelques équipements sanitaires, de prises d’eau et d’électricité (que les « gens du voyage » doivent payer d’avance, faute de quoi les « fluides » sont coupés) et de bureaux où siègent des assistantes sociales et autres représentants de l’hospitalité républicaine… le tout généralement coincé entre autoroutes et voies de chemins de fer, quand ce n’est pas à côté d’usines dangereuses classées Seveso – on rappellera que l’une de ces aires de reléguation était (et, je suppose, est toujours) située juste à côté de l’usine Lubrizol dans les faubourgs industriels de Rouen, laquelle engendra le sinistre que l’on sait, sans que personne ne se préoccupe outre-mesure des gens qui « restaient » juste à côté… En théorie, chaque commune de plus de 5 000 habitants doit créer une « aire d’accueil ». En pratique, c’est loin d’être le cas. Or, les « interstices » – particulièrement les terrains communaux – où se formaient des kumpanji se sont drastiquement réduits, pour ne pas dire qu’ils ont totalement disparu avec l’avancée en forme de rouleau compresseur du capitalisme sous sa forme néolibérale qui a « zoné » et privatisé la quasi-totalité des terres. Dès lors, les Roms et autres Voyageurs sont contraints de se rabattre sur ces aires, sauf à « ouvrir des places » ailleurs, sur des stades, des parkings de zones commerciales et autres – ce qu’ils font aussi régulièrement, mais qui, en même temps qu’une place, ouvre la plupart du temps des conflits avec les populations des villes ou villages concernés et leurs autorités, lesquelles ne voient toujours pas d’un bon œil arriver des « nomades » – passion triste du même qui persiste au pays des droits de l’homme…
[4] « Son existence de gadjé parmi les Roms, écrit Le Monde au moment de sa disparition en 2021, le métamorphosa en ethnologue, entré au CNRS en 1984, année de parution de sa thèse […] : Mariage tsigane. Une cérémonie de fiançailles chez les Roms de Paris (1984). » (Thèse publiée chez L’Harmattan. Patrick Williams avait aussi publié « Nous on en parle pas ». Les Vivants et les morts chez les Manouches, à La Maison des sciences de l’homme en 1995, « son plus beau livre », selon son collègue et ami Alban Bensa.)
[5] Ces Roms sont dits « de Provence » par Lise Foisneau car leur aire de parcours s’étend, en gros, sur le sud-est de la France – ce qui ne les empêche pas, à l’occasion de tel ou tel événement (mariage, enterrement, convention évangélique, de se déplacer beaucoup plus loin s’il le faut – et parfois sans la caravane, si j’ai bien compris). Ils font partie d’un groupe plus large : les Roms dits « Hongrois » arrivés en France pendant la « grande migration des chaudronniers » qui commença en 1860 depuis les pays d’Europe centrale et orientale.
[6] James C. Scott, Zomia ou l’art de ne pas être gouverné, Seuil, 2013 [2009].
[7] Dans le lexique de la kumpania, « rester », c’est en faire partie quelque temps, demeurer avec sur un « terrain désigné » (une « aire d’accueil ») ou une « place ».
[8] Lise Foisneau fait ici allusion aux quatre régimes ontologiques proposés par Philippe Descola, caractérisant différentes formes-de-vie, et dont Nastassja Martin donne un aperçu synthétique dans une note de bas de page de son dernier opus, À l’Est des rêves (voir ma recension par ici) : « Le naturalisme [que N. Martin choisit « délibérément » de faire coïncider avec le capitalisme] est défini comme une ontologie au sein de laquelle les “intériorités” (les âmes) des êtres qui peuplent le monde sont pensées comme discontinues et diverses, alors que les “physicalités” (les corps) sont le produit d’une continuité biologique, l’histoire de l’évolution nous liant au reste du vivant. En face du naturalisme on trouve l’animisme, où tous les êtres sont réputés dotés d’une âme (les “intériorités” sont continues) alors que ce sont les corps, conçus comme des habits parfois interchangeables, qui diffèrent. L’analogisme [auquel tendrait le régime ontologique des Roms, selon Lise Foisneau] présente quant à lui une discontinuité des âmes comme des corps, il faut donc trouver des moyens de connecter et de faire résonner toutes les parties fragmentaires qui constituent un monde [en l’occurrence, celui de la kumpania, lui-même fragment du monde des kumpanji, soit du monde rom]. Il est le pendant inverse du totémisme, où coïncident les intériorités et les physicalités, les corps et les âmes étant issues d’un même moule ontologique pour les personnes d’un même groupe totémique. »