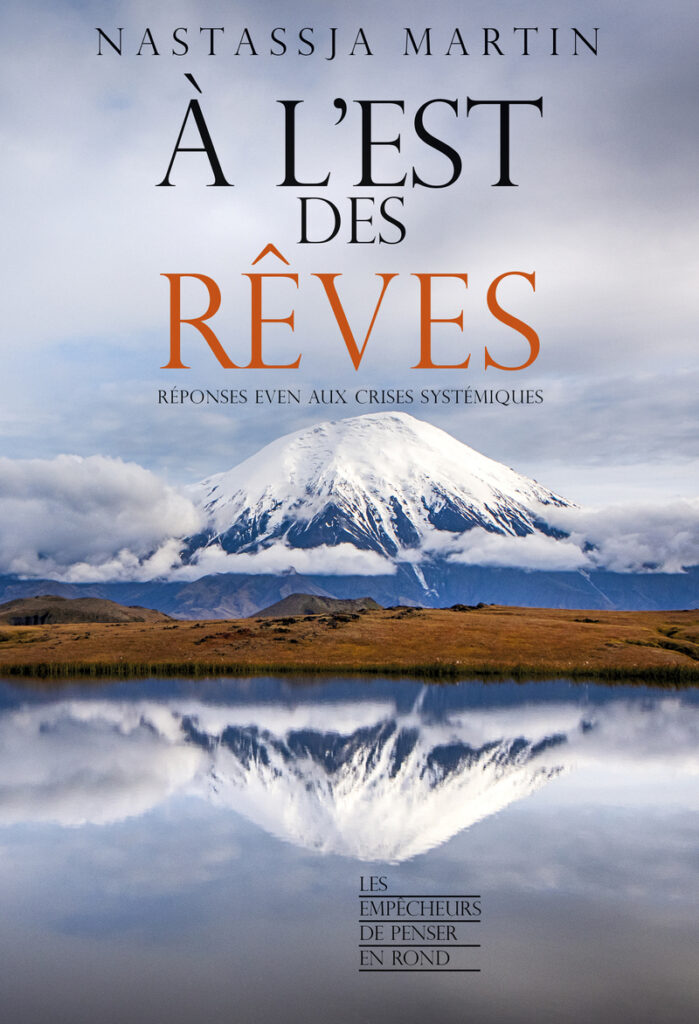 Nastassja Martin, À L’Est des rêves. Réponses Even aux crises systémiques, La Découverte, coll. Les Empêcheurs de penser en rond, 2022.
Nastassja Martin, À L’Est des rêves. Réponses Even aux crises systémiques, La Découverte, coll. Les Empêcheurs de penser en rond, 2022.
Un jour, la lumière s’est éteinte et les esprits sont revenus
In memoriam Maïté, une qui était partie[1]
De la même auteure, nous avions lu Les Âmes sauvages et Croire aux fauves[2]. On verra que j’avais beaucoup aimé le premier en lisant la recension que j’en avais donnée peu après sa publication[3]. C’est peu de dire que j’apprécie celui qui vient de sortir… Il présente les mêmes qualités que le premier : clarté d’exposition qui n’empêche en rien la profondeur de la réflexion, regard sans complaisance et empathique sur son « terrain » , comme on dit en sciences sociales, et « retour » critique sur l’anthropologie et le monde qui l’a inventée – soit le mien et le vôtre, à vous qui me lisez – l’Occident naguère colonisateur et aujourd’hui « post » dont l’avidité et la cupidité exercent partout leurs ravages, lesquels se font encore plus sentir dans les vastes « marges » habitées, entre autres, par les Gwich’in en Alaska et les Even au Kamtchatka. À ce propos, et ce sera un de mes, sinon mon seul bémol dans cette note, je regrette que l’éditeur n’ait pas inséré une carte (comme cela avait été fait dans les Âmes sauvages) qui situe le lieu de l’action. Bon, il y a Internet, dont je ne me suis pas privé afin de situer cette péninsule de l’Extrême Orient ex-soviétique[4]. Mais on n’y trouve pas localisés certains des sites évoqués dans le livre. Et puis aussi, une carte à plus grande échelle aurait pu contribuer à mettre en perspective les deux « terrains », Alaska et Kamtchatka. Bref. Pourquoi le Kamtchatka ? Nastassja Martin le raconte dans sa préface : un jour, Dacho et Clint, deux Gwich’in, l’entraînent en forêt dans une balade qui n’en est pas vraiment une. Au bout d’une heure de marche rendue pénible par les bourrasques de neige, ielles débouchent dans une clairière au milieu de laquelle trône un objet étrange, une « sphère blanche et facettée d’un diamètre imposant, juchée sur une structure métallique qui la tient suspendue en l’air ». Il s’agit d’un radar comme il y en a semble-t-il des dizaines dans la région, implantés au moment de la guerre froide afin de surveiller l’Union soviétique. Dacho regarde le radar sans rien dire et Nastassja le questionne sur ce qu’il pense. Chaque fois qu’il vient là, répond-il, il se demande ce que pensent les autres, de l’autre côté du détroit de Béring, quand ils passent devant le même type de radars, orientés, eux, vers les États-Unis… « Tu crois qu’ils sont comme nous ? Qu’ils vivent comme nous ? » l’interroge-t-il à son tour. Elle ne sait pas. Mais : « Il y a parfois sur un terrain – rarement – des moments qui sont comme des fulgurances. Brèves, infimes. Des points de détail. Qui se détachent pourtant du flux de l’expérience. Et qui font prendre à votre vie, à votre trajectoire de recherche, un tournant décisif. Les yeux de Dacho posés sur le radar américain qui regarde la Russie sont de ceux-là. Ce fut à la fois beau et douloureux, comme une évidence tue qui éclate enfin au jour : le monde que j’avais essayé de décrire était désespérément plus ouvert, il débordait, encore une fois, les pauvres limites que j’avais tenté d’esquisser autour de lui pour mieux le saisir. » Nastassja comprend alors qu’elle doit élargir son « terrain » en allant voir de l’autre côté du détroit comment les gens, là-bas, font face à l’Occident et aux métamorphoses environnementales.
De plus, autre chose l’a attirée vers le Kamtchatka : le fait que, profitant de la crise systémique de l’URSS à la fin des années 1980, de nombreux habitants des régions de l’Arctique sibérien étaient « retournés » en forêt – des chercheurs avaient observé la reprise des pratiques traditionnelles de chasse et même un « resurgissement du chamanisme ». Ainsi, en compagnie d’un autre anthropologue français, Charles Stepanoff[5], Nastassja est-elle partie « Chercher ceux qui sont partis » (titre de son introduction).
Ici, il faut rappeler que les Soviétiques, progressistes s’il en fût, n’avaient pas voulu laisser ces pauvres peuples semi-nomades, éleveurs de rennes ou chasseurs cueilleurs, moisir dans leur sous-développement (et peut-être bien aussi, voire surtout ? échapper à leur contrôle sans participer à l’édification du socialisme). Ils avaient donc entrepris de les regrouper en villages, d’envoyer leurs enfants à l’école (souvent en pension à des centaines de kilomètres de leurs parents) et de rationaliser leurs activités en les organisant en sovkhozes et kolkhozes. Les Even auxquels s’est intéressée Nastassja Martin étaient anciennement des nomades qui suivaient leurs rennes là où l’herbe était verte. Certains d’entre eux, venus de Sibérie centrale, étaient arrivés jusqu’au Kamtchatka. Alors, ils ne possédaient guère que quelques rennes par famille, des bêtes qu’ils montaient, auxquelles ils parlaient, comme aux personnes douées d’une âme, telles qu’ils les considéraient. Les planificateurs soviétiques mirent fin à ces aberrations et, une fois les gens regroupés en villages, regroupèrent aussi les rennes en troupeaux de milliers de têtes anonymes, gardés par des bergers devenus professionnels. En même temps que leur mode de vie traditionnel, les Even perdirent leur « arrière-monde », leur relation aux esprits et aux « âmes sauvages ». Cependant, les Soviétiques ne voulurent pas laisser se perdre les formes de la culture traditionnelle : et c’est pourquoi une grande partie des indigènes du Kamtchatka sont employés par l’industrie touristique. Ils font partie de troupes de danseurs, ils donnent en spectacle d’anciens rituels soigneusement scénarisés par des professionnels venus de Russie, d’Ukraine ou d’ailleurs, et il arrive même qu’ils montent des rennes pour le plaisir des yeux – et des appareils photos, bien sûr – des touristes. Ils ont été « folklorisés » à mort, comme toutes les cultures de l’ex-URSS. Le folklore, c’est la représentation d’une culture coupée de la praxis qui l’avait fait naître. Évidemment Nastassja Martin ne voulait pas s’en tenir là, à observer des « coutumes » détachées de leur contexte et mises en scène de façon totalement artificielle. Et elle a fini par réussir à passer « de l’autre côté », à rejoindre un clan familial Even dirigé par une femme, Daria, avec laquelle elle est devenue très amie au fil des mois et des années, au point de faire désormais partie de la famille (ce qui, me semble-t-il, est bien différent de ce qu’elle avait vécu en Alaska, où elle s’était certes fait des amis, mais pas une « famille » Gwich’in, et qui donne une charge émotionnelle plus grande à ce second opus[6]).
C’est elle, Daria, qui dit : « Un jour, en 1989, la lumière s’est éteinte et les esprits sont revenus. » Le 3 novembre de cette année-là, soit quelques jours seulement avant la chute d’un mur qui fit du bruit en Occident, elle prit ses cliques et ses claques, ses trois enfants en bas âge et (re)partit s’installer en forêt, non loin de sa mère Memme qui, elle, n’avait jamais voulu la quitter. D’autres membres du clan familial étaient déjà partis et toutes et tous s’étaient installés dans la région d’Icha, près des berges de la rivière du même nom, quelque part sous le volcan Ichinsky. Si vous tapez « rivière Icha » sur Internet, vous ne trouverez pas de photos des membres du clan de Daria, mais des sites genre planetflyfishing.com ou lepoissonvoyageur.com affichant des photos de fiers mâles blancs qui présentent à l’objectif de superbes spécimens de saumons et autres truites tout juste pêchés entre leur aller et leur retour à Paris-Roissy ou ailleurs. Je ne pense pas qu’il leur soit venu à l’idée que des gens vivent là en permanence, tirant leur subsistance de la rivière et de la forêt… Les Even de la famille élargie de Daria (si je comprends bien, une cinquantaine de personnes dispersés sur des centaines, voire des milliers de kilomètres carrés) vivent là en chasseurs cueilleurs, eux qui étaient jadis (avant la sédentarisation forcée) plutôt éleveurs de rennes. Daria a expliqué à Nastia, comme on l’appelle affectueusement là-bas, que les chamanes avaient disparu en même temps que disparaissaient les anciens modes de vie. Elle-même, qui était née dans la forêt avant de vivre longtemps « en ville » (à Esso, qui est plutôt un gros village – 2000 habitants selon Wikipédia), avait été sauvée dans les jours suivant sa naissance par le dernier d’entre eux : en ses premiers jours, elle n’arrêtait pas de pleurer et refusait de manger. Le chamane, après avoir jeûné et rêvé pour elle, avait expliqué à sa mère qu’elle avait choisi un mauvais nom pour sa fille (elle voulait l’appeler Ouliana) : elle devait s’appeler Daria (prénom de sa grand-mère), sinon elle mourrait. Aussitôt dit, aussitôt fait, et le bébé s’arrêta de pleurer et s’alimenta normalement. Elle était âgée de près de soixante ans et était la cheffe du clan familial lorsque Nastassja la rencontra. C’est avec elle, surtout, que l’anthropologue a appris comment vivent ces gens qui sont repartis dans la forêt quasiment sans bagage et en ayant presque tout oublié des anciennes coutumes, des anciens modes de faire et de s’entretenir avec les esprits. Il n’y a plus de chamanes pour les aider, alors Daria improvise. Elle parle, elle chante, s’adressant au feu, à la rivière, aux esprits de la forêt. Elle (ré)apprend en marchant. Et rêve aussi. Beaucoup. Et s’intéresse aux rêves de celles et ceux qui dorment dans sa yourte. C’est que souvent les âmes des animaux s’adressent à eux, leur disant qu’ils s’offriront à eux demain, à tel endroit, ou les prévenant de tel ou tel aléa climatique.
« Un […] matin d’hiver, je me réveille, j’avise les garçons et Matchilda, le beau-fils de Daria, accoudé à la petite table près du poêle. Je le fixe sans but, la tête vide, pensant vaguement à la longue journée probablement ennuyeuse qui m’attend. Elle est déjà partie, me dit-il sans me regarder. Elle a dû rêver, dit-il encore, ses traces partent vers la rivière… Elle a rêvé c’est sûr. Il a l’air agacé, presque jaloux. Je m’habille à la hâte, enfile mes bottes et sort dans l’air brillant. Avant même que j’aie pu atteindre le bout du camp, je vois la silhouette de Daria qui se découpe au fond de la clairière sur le petit chemin de neige qui remonte de la rivière. Je m’arrête, la regarde s’approcher. Elle a le sourire aux lèvres, elle est fière comme une gamine qui aurait attrapé son premier papillon, sur son épaule se balance un sac humide. Elle le dépose à nos pieds, l’ouvre et me montre les truites arc-en-ciel. Cette nuit je les ai vues, elles m’ont parlé, elles m’ont dit l’endroit où elles allaient être, dit-elle sans se départir de son large sourire. J’ai su qu’elles allaient se donner.je me suis dépêchée, je suis allée à l’endroit que j’ai vu en rêve. Elles sont venues presque tout de suite.
« Plus tard dans la journée, devant la maison sur le petit banc, assises sous les quelques rayons de soleil du jour, nous pouffons de rire : Matchilda revient de la rivière, bredouille. Tu es né hier ou quoi ? lui lance Daria. Tu sais que ça ne sert à rien d’y aller, si tu n’as rien vu la nuit ! On peut toujours essayer, marmonne Matchilda en nous passant devant, l’air renfrogné. »
L’anthropologue observe comment celles et ceux qui sont devenus sa famille s’affrontent au changement climatique qui leur apporte des catastrophes météo, modifie les comportements des animaux, voire les fait disparaître. Comment aussi ils et elles sont bien obligés de passer des compromis avec la civilisation afin de se procurer de l’argent et surtout les produits indispensables (ou pas) à la survie en climats extrêmes (comme par exemple essence et pièces détachées pour les motoneiges, ou cigarettes). Comment ils vivent tous les petits détails (qui n’en sont pas) de la vie quotidienne, loin de toute facilité et de tout élément de confort « tout fait ». C’est vraiment un très beau livre. De plus elle entrelace à ces considérations une sorte de cours d’anthropologie pour débutants dans mon genre, parlant des mythes, des tricksters (ces êtres du passage, des limites, de la transgression créatrice), des rêves et de ce qu’elle nomme les « cosmogonies accidentelles » – c’est-à-dire nées de rencontres, de circonstances fortuites, d’accidents en somme, et pas d’Un à majuscule qui se ramène et proclame que la lumière soit et la lumière fut etc., si vous voyez ce que je veux dire. Lisez-le absolument, c’est une grande leçon.
Bon, je vais trop vite, c’est entendu. Mais l’idée est d’inciter à lire, non de faire semblant d’avoir tout bien compris, tout bien digéré et de vous le rapporter tel un oiseau rapportant la becquée à ses petits. Pourtant, je vais encore m’attarder sur la cinquième partie du livre, intitulée « Tempête », et qui me semble formuler des propositions que je n’avais guère entendues jusqu’ici.
Ça commence par une tempête, des trombes d’eau puis le regel – qui tue des dizaines d’animaux aux alentours, dont huit des dix chevaux de la famille de Daria, incapables de casser la couche de glace au-dessus de la neige afin de trouver encore un brin d’herbe dessous… Jusqu’ici les anthropologues se sont peu intéressés aux relations entretenues par les collectifs indigènes aux flux géophysiques – d’abord parce qu’eux-mêmes n’étaient pas encore sensibilisés à la question des bouleversements du climat, mais aussi pour une autre raison, selon Nastassja Martin : « Pour mieux saisir ce silence des anthropologues, il faut d’abord comprendre qu’ils n’ont pas seulement hérité du grand partage entre culture et nature, même si nombre d’entre eux se sont attachés à le défaire ces dernières décennies. À un niveau infra, ils sont porteurs de divisions plus profondes encore : celle entre vivant et non-vivant, en résonance avec la césure animé et inanimé, héritée de l’Antiquité et retravaillée au début de la modernité. » Le milieu était vu comme un environnement abiotique (physique, chimique, géologique), soit un donné inerte. Mais plus récemment, « diverses disciplines scientifiques ont montré que ces milieux étaient en réalité construits par et pour les êtres vivants, et en étaient donc une extension. » C’est, en gros, l’effet de l’« hypothèse Gaïa », soit la Terre vue comme organisme vivant.
Du point de vue Even, cela se traduit par des adresses directes aux éléments. On l’a dit, Daria s’adresse au feu, à la rivière. Mais elle raconte aussi à Nastia ses souvenirs de rituels exécutés par ses parents afin de faire changer une météo défavorable. Elle-même ne sait plus accomplir ces rituels ; par contre, elle cherche toujours à parler, à communiquer avec les éléments. Prendre Daria au sérieux, c’est essayer de comprendre pourquoi elle le fait, au nom de quelle vision du monde. C’est un monde où tout n’est pas vivant, au sens biologique du terme, mais ou tout – humains, animaux, pierres, vent, feu, eau – est traversé par un « principe d’animation » que les Even nomment Ivki. Comme dans d’autres cas – le manitou, ou le Grand Esprit des Indiens d’Amérique – les Blancs ont eu tendance à assimiler ces notions au Dieu monothéiste. « Pour sortir de [cette] affiliation notable mais réductrice […], il me semble, dit Nastassja Martin, que le fil conducteur n’est pas à chercher dans l’idée partagée qu’il existerait une force toute-puissante extérieure à ce monde qui serait néanmoins à son origine. Bien plutôt, il nous faut porter l’attention vers ce qui est réputé être distribué chez tous les êtres, éléments et entités qui composent ce monde. Ce que toutes ses composantes reçoivent en partage est une capacité de métamorphose. » C’est l’auteure qui souligne. Cela me paraît assez vertigineux : car cela remet radicalement en question nos conceptions occidentales – la politique, l’économie, l’État, le Droit, etc., toutes fondées sur la notion d’Institution majuscule, soit quelque chose censé être solide, robuste, stable, en somme : immuable. Mais poursuivons avec Nastassja Martin à propos des éléments et d’Ivki : « Le feu, la rivière et les conditions atmosphériques sont perçus comme bougeant en amont des humains, des animaux et des plantes, plus vite et plus fort qu’eux ; ils n’en deviennent pas pour autant des “personnes” ou des “gens” au même titre que les animaux par exemple, puisqu’ils n’ont pas d’âme individuelle ; ils pourraient néanmoins être vus comme des méta-personnes, traversant toutes choses, traversées par toutes choses. Ce qui leur est reconnu est une puissance propre, une animation qui dépasse, en intensité, tout ce que les animaux et les humains peuvent faire ou dire, ainsi que leur manière de se métamorphoser. Ivki, en relation avec l’instabilité des formes de ces derniers, peut être compris comme la capacité métamorphique que manifestent ces éléments. Ivki n’est pas supérieur, nous dit Daria, mais traverse toute chose. Cela veut dire que même les entités réputées “animées” au plus haut niveau, comme le feu, l’eau et les conditions atmosphériques, sont elles-mêmes traversées par un principe d’animation qui tend, en quelque sorte, les relations entre tous les êtres – un “vent” qui fait bouger les branches des grands arbres et frémir les toutes petites herbes. »
Pour conclure, je reprendrai un extrait de la conclusion d’À l’est des rêves, tout aussi belle et profonde que le reste du livre.
« Daria et sa famille ont, plusieurs fois, tout perdu. Nous aussi, nous sommes à l’orée d’une perte si abyssale que nous en restons stupéfaits[7]. Alors ? Reposons la question : vers quoi œuvrons-nous[8] ? Le maintien de leurs formes et des nôtres ? Le maintien de nos structures et des leurs ? À quel prix ? Les Even d’Icha répondraient : au prix des relations. Nos livres et toutes nos restitutions[9] sont-ils appelés à devenir autant de musées où sont conservées les formes stables – et donc rassurantes – des traditions autochtones ? Si la réponse est négative, alors leurs manières de vivre recomposées, qui déboussolent les nôtres face aux métamorphoses systémiques actuelles, doivent être absolument repolitisées en même temps que défolklorisées. Il faut entendre les rencontres interspécifiques, les mythes, les rêves et les adresses aux éléments comme autant de façons de dire que le monde pourrait être autre. »
Un grand livre, décidément.
franz himmelbauer, pour Antiopées, le 4 septembre 2022
[1] Maïté, parisienne pur jus, était partie à la fin des années 1960, comme beaucoup d’autres, s’installer dans un coin reculé de la haute Ardèche, juste sous le Gerbier-de-Jonc, afin d’y construire une vie plus solidaire entre humains, plantes et animaux. Et elle avait réussi. Comme Daria, dont parle Nastassja Martin dans son livre, et qui était repartie vivre en forêt en 1989, elle avait été longtemps cheffe de clan. À l’est des rêves s’ouvre sur la mort de la mère de Daria et une cérémonie émouvante de funérailles dans la forêt. Celle qui a accompagné Maïté dans son dernier voyage, voici quelques jours, fut aussi très belle.
[2] Les Âmes sauvages. Face à l’Occident, la résistance d’un peuple d’Alaska, La Découverte, 2016 ; Croire aux fauves, Verticales, 2019.
[3] J’avais aussi aimé Croire aux fauves, mais je pense que je l’avais mal compris avant la lecture de À l’est des rêves. En effet, il y avait un côté un peu « sensationnel », rocambolesque, dans ce combat entre une femme et un ours… Cet aspect me semblait reléguer en arrière-plan le magnifique travail d’ethnographie des Âmes sauvages. Or j’ai relu Croire aux fauves après À l’est des rêves, et il m’est apparu tout autrement, aussi comme un essai réflexif sur l’anthropologie – sans parler de ses considérations ethnographiques comparatives sur les systèmes de soins russes et français…
[4] 1380 km de long sur 430 dans sa plus grande largeur, 270 000 km2, soit environ la moitié de la France, pour une population de 330 000 habitants (dixit Wikipédia). La péninsule est en quelque sorte « prolongée » vers le sud par les îles Kouriles, qui forment un arc de cercle très ouvert jusqu’à l’île japonaise d’Hokkaido. Les quatre îles proches de cette dernière sont l’enjeu d’un conflit territorial entre Russie et Japon. Les Japonais les nomment « Territoires du Nord » et les Russes « Kouriles du Sud ». Suite à leur annexion par l’URSS à la fin de la Seconde Guerre mondiale, le différend n’est toujours pas réglé à ce jour, empêchant la signature d’un traité de paix entre URSS, puis Russie, et Japon. Celui-ci s’étant associé aux sanctions occidentales contre la Russie après le déclenchement de la guerre en Ukraine, la Russie a dénoncé son « attitude inamicale » et abandonné la négociation de ce fameux traité…
[5] Même si le travail de Charles Stepanoff (du moins ce que j’en ai lu) ne présente pas le côté très personnel, qui touche à l’intimité du chercheur lui-même, que l’on trouve chez Nastassja Martin, je m’en voudrais de ne pas recommander ici Voyager dans l’invisible. Techniques chamaniques de l’imagination, avec une préface de Philippe Descola, La Découverte, coll. Les Empêcheurs de penser en rond, 2019. C’est une très belle étude sur le chamanisme, basée sur les enquêtes de terrain de l’auteur et « l’ample littérature ethnographique décrivant les traditions autochtones du nord de l’Eurasie et de l’Amérique » (extrait de la quatrième de couverture). Son très grand intérêt vient de ce qu’elle met au jour des différences entre pratiques chamaniques qui semblent traduire une sorte d’évolution vers la spécialisation des praticiens et donc une certaine hiérarchisation qui pourrait (c’est mon commentaire) peut-être se retrouver au cours du développement de nombreuses religions, avec l’apparition progressive d’une caste de prêtres, d’un savoir réservé aux élites, etc. On peut aussi voir sur Lundi soir un entretien avec Charles Stepanoff à propos de son dernier livre L’Animal et la mort. Chasses, modernité et crise du sauvage. C’est par ici.
[6] Ici, je ne peux pas ne pas penser à Barbara Glowczewski qui, elle aussi, a été adoptée par une famille aborigène en Australie. Voir https://antiopees.noblogs.org/post/2015/10/22/barbara-glowczewski-les-reveurs-du-desert-et-reves-en-colere/ et aussi ce récent « Lundi soir ».
[7] Nastassja Martin en sait quelque chose, elle qui habite, lorsqu’elle est en France, au pied de la Meije, dans le massif des Écrins : elle qui est amoureuse de la montagne voit l’effet du réchauffement climatique sur le glacier du même nom, comme on peut l’observer à travers toute la chaîne des Alpes.
[8] Nous : les anthropologues.
[9] Nastassja Martin a aussi participé à la réalisation de deux films documentaires : Kamtchatka, un hiver en pays évène (2018) et Kamtchatka : un été en pays évène (2020).
