Les ami·e·s de l’école de philosophie ont publié dans Lundi matin #447 « Une bibliographie non-exhaustive pour (re)penser la Palestine » dont je prends ici la suite. En effet, il semble qu’en ce début 2025, il n’est plus temps d’oublier la Palestine (si cela l’a jamais été) – Gaza, mais aussi Jérusalem et la Cisjordanie, où l’entreprise coloniale se fait plus féroce que jamais.
Je commence par deux ouvrages historiques qui sont bien complémentaires : Palestine Israël. Une histoire visuelle, de Philippe Rekacewicz et Dominique Vidal[1], et La Conquête de la Palestine. De Balfour à Gaza, une guerre de cent ans, par Rachad Antonius[2]. Le premier, comme son titre le suggère, s’est donné pour objet de donner à voir la conquête de la Palestine par Israël en « plus de quatre-vingts documents cartographiques [qui] retracent un siècle et demi d’histoire ».
 Philippe Rekacewicz est un des animateurs de l’excellent site visionscarto.net sur lequel on trouvera – entre de très nombreuses autres contributions toutes plus intéressantes les unes que les autres une présentation de Palestine Israël : « Parce que l’histoire ne commence pas le 7 octobre ». Il travaille et réfléchit depuis longtemps aux manières de rendre vivante et accessible la géographie – Visionscarto se veut « un lieu où doivent se sentir à l’aise toutes les personnes qui souhaitent réfléchir sur des concepts originaux de cartographie — comme la cartographie participative, la cartographie radicale ou la cartographie narrative ». Quant à Dominique Vidal, il est bien connu pour son engagement propalestinien et son travail de journaliste et d’intellectuel sur le Proche-Orient en général et Israël-Palestine en particulier. Il est proche d’Alain Gresh, qui anime orientxxi.info, dont je ne recommanderai jamais assez la lecture. Bref, la collaboration entre le journaliste et le cartographe a donné un livre très pédagogique. Il est découpé en six chapitres correspondant aux étapes importantes du sionisme d’abord, puis de la création de l’État d’Israël et des guerres qu’il a menées jusqu’à aujourd’hui. Chacun comprend donc plusieurs cartes et/ou infographies, des encadrés sur telle ou telle question particulière, et une narration qui court tout le long du livre – le tout montrant le déroulement implacable (on a envie d’écrire : le rouleau compresseur) de l’entreprise du « settler colonialism » sioniste. On commence à savoir que ce que nous traduisons en français par « colonialisme de peuplement », et qui correspond, entre autres, à la forme de l’emprise coloniale sur Abya Yala (baptisée Amérique par qui vous savez), est une entreprise structurellement génocidaire. Car il s’agit bien d’éliminer les autochtones afin de voler leurs terres et de s’établir à leur place. Ôte-toi de là que je m’y mette, en somme. Une seule carte, page 33, pourrait suffire à établir l’intention qui a présidé à ce projet criminel. On y voit, délimitée par une ligne rouge, la zone revendiquée par les sionistes pour l’établissement de leur « Foyer national » en Palestine lors de la conférence de paix de Paris en 1919. Rappelons qu’il s’agissait des négociations entre les protagonistes de la Première Guerre mondiale, qui consacrèrent la disparition des « Empires centraux » – allemand et austro-hongrois – et de l’Empire ottoman. Les puissances impérialistes victorieuses obtinrent, elles, des « mandats » de la SDN (société des nations), euphémisme pour « droit de domination coloniale ». Celui de la Palestine fut attribué au Royaume-Uni. On sait par ailleurs que la première reconnaissance officielle par un État du projet sioniste (de « Foyer national juif » en Palestine) était venue de Lord Balfour, secrétaire au Foreign Office, en 1917. Quoi qu’il en soit, les dirigeants israéliens n’ont semble-t-il jamais perdu de vue le tracé de cette « ligne rouge » comme objectif de leur diplomatie – et surtout de leurs entreprises militaires – je ne mentionnerai ici que le Golan (syrien) et le Sud-Liban. Tout récemment, l’armée israélienne a profité de la situation d’interrègne en Syrie pour investir encore un peu plus avant la région du Golan, et a imposé au Hezbollah un retrait d’une trentaine de kilomètres au nord de la frontière – ce qui correspond (plus ou moins, je ne connais pas précisément les distances) à la ligne de la revendication territoriale de 1919… Le défaut de ce livre tient à ses qualités : il est extrêmement touffu et bourré d’informations – si bien que l’on a parfois un peu de mal à s’y retrouver, et qu’il n’est pas facile à lire d’une traite. Mais toutes ces informations, ces chronologies, ces portraits et surtout ces cartes en font cependant une très bonne boîte à outils que l’on fera bien de garder à portée de main afin de s’y référer pour mettre l’actualité en perspective.
Philippe Rekacewicz est un des animateurs de l’excellent site visionscarto.net sur lequel on trouvera – entre de très nombreuses autres contributions toutes plus intéressantes les unes que les autres une présentation de Palestine Israël : « Parce que l’histoire ne commence pas le 7 octobre ». Il travaille et réfléchit depuis longtemps aux manières de rendre vivante et accessible la géographie – Visionscarto se veut « un lieu où doivent se sentir à l’aise toutes les personnes qui souhaitent réfléchir sur des concepts originaux de cartographie — comme la cartographie participative, la cartographie radicale ou la cartographie narrative ». Quant à Dominique Vidal, il est bien connu pour son engagement propalestinien et son travail de journaliste et d’intellectuel sur le Proche-Orient en général et Israël-Palestine en particulier. Il est proche d’Alain Gresh, qui anime orientxxi.info, dont je ne recommanderai jamais assez la lecture. Bref, la collaboration entre le journaliste et le cartographe a donné un livre très pédagogique. Il est découpé en six chapitres correspondant aux étapes importantes du sionisme d’abord, puis de la création de l’État d’Israël et des guerres qu’il a menées jusqu’à aujourd’hui. Chacun comprend donc plusieurs cartes et/ou infographies, des encadrés sur telle ou telle question particulière, et une narration qui court tout le long du livre – le tout montrant le déroulement implacable (on a envie d’écrire : le rouleau compresseur) de l’entreprise du « settler colonialism » sioniste. On commence à savoir que ce que nous traduisons en français par « colonialisme de peuplement », et qui correspond, entre autres, à la forme de l’emprise coloniale sur Abya Yala (baptisée Amérique par qui vous savez), est une entreprise structurellement génocidaire. Car il s’agit bien d’éliminer les autochtones afin de voler leurs terres et de s’établir à leur place. Ôte-toi de là que je m’y mette, en somme. Une seule carte, page 33, pourrait suffire à établir l’intention qui a présidé à ce projet criminel. On y voit, délimitée par une ligne rouge, la zone revendiquée par les sionistes pour l’établissement de leur « Foyer national » en Palestine lors de la conférence de paix de Paris en 1919. Rappelons qu’il s’agissait des négociations entre les protagonistes de la Première Guerre mondiale, qui consacrèrent la disparition des « Empires centraux » – allemand et austro-hongrois – et de l’Empire ottoman. Les puissances impérialistes victorieuses obtinrent, elles, des « mandats » de la SDN (société des nations), euphémisme pour « droit de domination coloniale ». Celui de la Palestine fut attribué au Royaume-Uni. On sait par ailleurs que la première reconnaissance officielle par un État du projet sioniste (de « Foyer national juif » en Palestine) était venue de Lord Balfour, secrétaire au Foreign Office, en 1917. Quoi qu’il en soit, les dirigeants israéliens n’ont semble-t-il jamais perdu de vue le tracé de cette « ligne rouge » comme objectif de leur diplomatie – et surtout de leurs entreprises militaires – je ne mentionnerai ici que le Golan (syrien) et le Sud-Liban. Tout récemment, l’armée israélienne a profité de la situation d’interrègne en Syrie pour investir encore un peu plus avant la région du Golan, et a imposé au Hezbollah un retrait d’une trentaine de kilomètres au nord de la frontière – ce qui correspond (plus ou moins, je ne connais pas précisément les distances) à la ligne de la revendication territoriale de 1919… Le défaut de ce livre tient à ses qualités : il est extrêmement touffu et bourré d’informations – si bien que l’on a parfois un peu de mal à s’y retrouver, et qu’il n’est pas facile à lire d’une traite. Mais toutes ces informations, ces chronologies, ces portraits et surtout ces cartes en font cependant une très bonne boîte à outils que l’on fera bien de garder à portée de main afin de s’y référer pour mettre l’actualité en perspective.
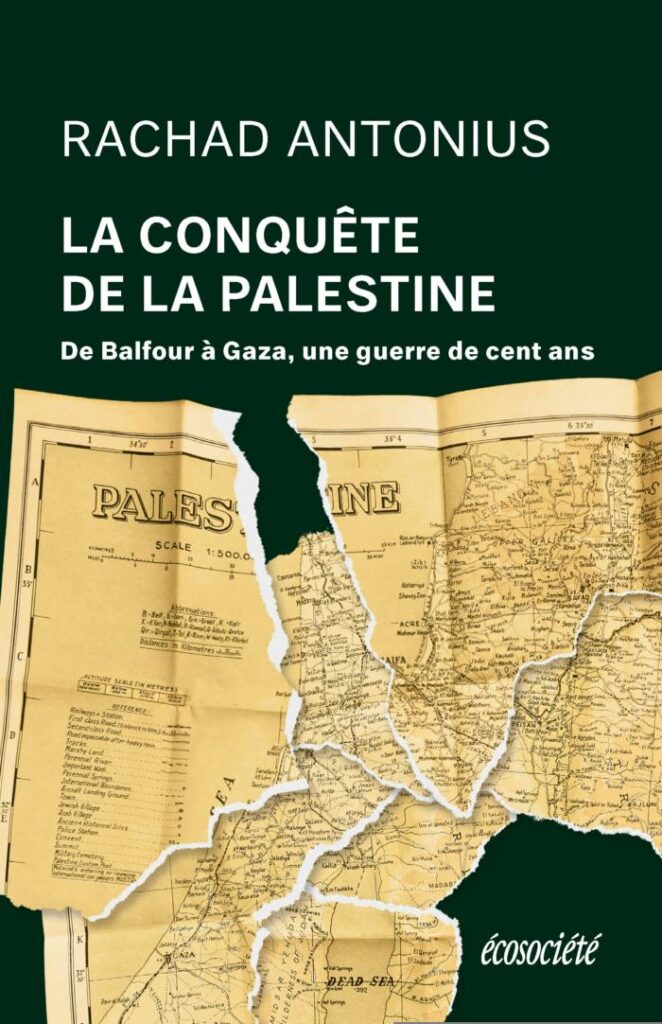 La Conquête de la Palestine vient très utilement en renfort, en quelque sorte, de la lecture du premier. Car il propose une narration beaucoup plus synthétique. « [Ce] n’est pas une histoire du conflit entre Israël et la Palestine, prévient son auteur d’entrée de jeu. Il n’aborde qu’un seul aspect de ce conflit, qui est le plus central : l’histoire de ma mainmise graduelle du mouvement sioniste sur la terre de Palestine. » De Balfour à Gaza, une guerre de cent ans : le sous-titre est assez éloquent à cet égard. Le livre, qui se lit vite et facilement (160 pages en style alerte et sans jargon), répond d’une autre manière à la même urgence qu’Israël Palestine : défaire la forgerie de la hasbara (la propagande israélienne) qui voudrait faire accroire que « l’histoire [de Gaza] commence le 7 octobre ». Il est ainsi organisé en deux parties : tout d’abord, l’histoire de cette « guerre de cent ans » (jusqu’au 7 octobre), puis « Un autre regard sur le conflit » (après le 7 octobre). Je trouve particulièrement utile la première partie (la seconde est également très intéressante, mais probablement moins originale en ce qu’elle aborde des questions qui ont déjà été soulevées dans plusieurs ouvrages dont j’ai moi-même rendu compte ici[3] ou/et qui sont mentionnés dans la « bibliographie non-exhaustive » de l’école de philo. Le tour de force, si j’ose dire, de cette première partie est de donner une vision d’ensemble claire et précise de la conquête de la Palestine par le mouvement sioniste (et ses premières institutions proto-étatiques) appuyé sur l’Empire britannique d’abord, puis par l’État d’Israël soutenu par l’ensemble de la communauté internationale à ses débuts (vote majoritaire de l’Assemblée générale de l’ONU en 1947), puis par le seul ensemble occidental (Europe-États-Unis), qui a lui aussi tendance à se restreindre mais qui suffit encore largement à assurer la supériorité militaire à son protégé. J’aurais tendance à dire qu’il faudrait le lire avant ou en même temps que Palestine Israël, car sa présentation synthétique de l’histoire et des enjeux actuels rend plus facilement accessible la multitude d’informations détaillées fournies par le premier.
La Conquête de la Palestine vient très utilement en renfort, en quelque sorte, de la lecture du premier. Car il propose une narration beaucoup plus synthétique. « [Ce] n’est pas une histoire du conflit entre Israël et la Palestine, prévient son auteur d’entrée de jeu. Il n’aborde qu’un seul aspect de ce conflit, qui est le plus central : l’histoire de ma mainmise graduelle du mouvement sioniste sur la terre de Palestine. » De Balfour à Gaza, une guerre de cent ans : le sous-titre est assez éloquent à cet égard. Le livre, qui se lit vite et facilement (160 pages en style alerte et sans jargon), répond d’une autre manière à la même urgence qu’Israël Palestine : défaire la forgerie de la hasbara (la propagande israélienne) qui voudrait faire accroire que « l’histoire [de Gaza] commence le 7 octobre ». Il est ainsi organisé en deux parties : tout d’abord, l’histoire de cette « guerre de cent ans » (jusqu’au 7 octobre), puis « Un autre regard sur le conflit » (après le 7 octobre). Je trouve particulièrement utile la première partie (la seconde est également très intéressante, mais probablement moins originale en ce qu’elle aborde des questions qui ont déjà été soulevées dans plusieurs ouvrages dont j’ai moi-même rendu compte ici[3] ou/et qui sont mentionnés dans la « bibliographie non-exhaustive » de l’école de philo. Le tour de force, si j’ose dire, de cette première partie est de donner une vision d’ensemble claire et précise de la conquête de la Palestine par le mouvement sioniste (et ses premières institutions proto-étatiques) appuyé sur l’Empire britannique d’abord, puis par l’État d’Israël soutenu par l’ensemble de la communauté internationale à ses débuts (vote majoritaire de l’Assemblée générale de l’ONU en 1947), puis par le seul ensemble occidental (Europe-États-Unis), qui a lui aussi tendance à se restreindre mais qui suffit encore largement à assurer la supériorité militaire à son protégé. J’aurais tendance à dire qu’il faudrait le lire avant ou en même temps que Palestine Israël, car sa présentation synthétique de l’histoire et des enjeux actuels rend plus facilement accessible la multitude d’informations détaillées fournies par le premier.
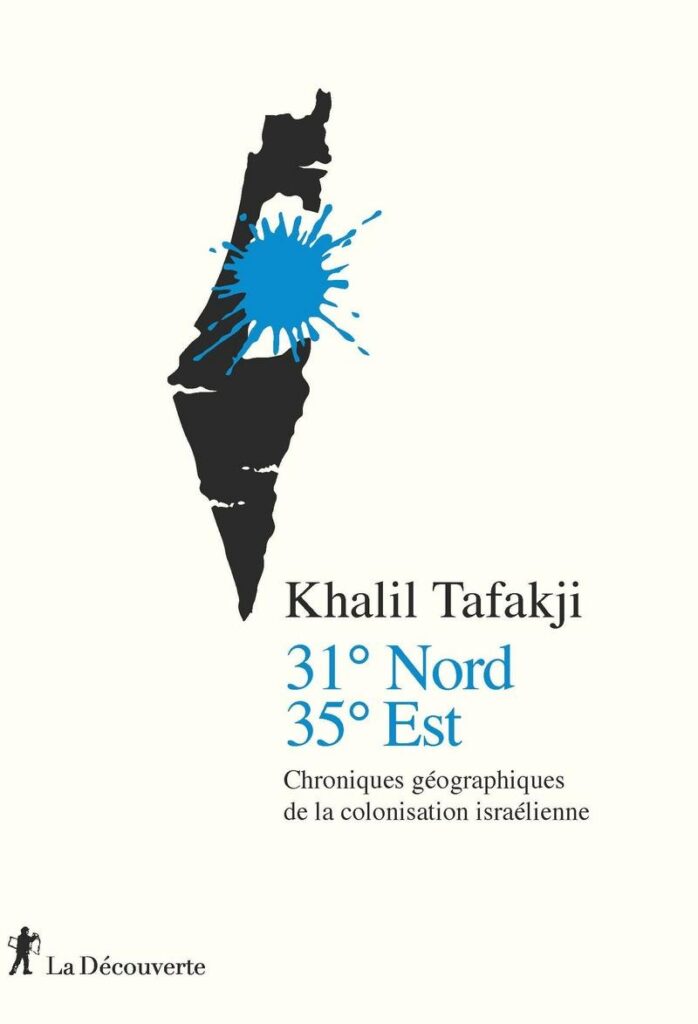 Voici quelques années déjà qu’est paru le livre de Khalil Tafakji (avec Stéphanie Maupas) 31° Nord 35° Est. Chroniques géographiques de la colonisation israélienne[4]. Né après la Nakba, c’est un enfant de Jérusalem. Membre de la délégation palestinienne lors des pourparlers de paix et directeur du département de cartographie de la Société d’études arabes, Khalil Tafakji a sillonné son pays, la Palestine, pendant trente ans et cartographié la colonisation des Territoires occupés. En 1995, au moment des « accords » d’Oslo, il avait été invité à Jéricho par Yasser Arafat qui voulait prendre connaissance de ses recherches sur la l’état de la colonisation israélienne.
Voici quelques années déjà qu’est paru le livre de Khalil Tafakji (avec Stéphanie Maupas) 31° Nord 35° Est. Chroniques géographiques de la colonisation israélienne[4]. Né après la Nakba, c’est un enfant de Jérusalem. Membre de la délégation palestinienne lors des pourparlers de paix et directeur du département de cartographie de la Société d’études arabes, Khalil Tafakji a sillonné son pays, la Palestine, pendant trente ans et cartographié la colonisation des Territoires occupés. En 1995, au moment des « accords » d’Oslo, il avait été invité à Jéricho par Yasser Arafat qui voulait prendre connaissance de ses recherches sur la l’état de la colonisation israélienne.
Plus je progressais dans ma démonstration, raconte-t-il, plus mes auditeurs se raidissaient. Le futur chef de l’Autorité palestinienne balançait nerveusement ses jambes, et je pouvais percevoir un léger tremblement sur ses lèvres. Il me fusilla du regard lorsque j’annonçai : « Je ne sais pas si quelqu’un vous a promis un État, mais je parle à partir des cartes et, si l’on regarde les cartes, il n’y a pas d’État palestinien… Vous n’avez rien. »
La suite lui a malheureusement donné, et continue de lui donner raison. L’intérêt de son livre est de montrer la mécanique concrète de la colonisation, à ras de terre si l’on peut dire, mais aussi à « ras de murs », dans Jérusalem, entre autres. Il réside aussi dans la découverte d’un « honnête homme », qui ne se paye pas de mots mais accomplit un travail aussi indispensable que discret. Une personnalité attachante dont on apprit l’arrestation et le saccage de ses bureaux – et de ses cartes – par la police israélienne en juillet 2020, peu de temps après la parution de son livre en France – coïncidence ? D’après les dernières déclarations que j’ai pu lire de lui (en juin dernier, sur les plans d’annexion de la Cisjordanie de Smotrich, le ministre des finances fasciste de Netanyahou), il semble qu’il soit « libre » (si l’on peut dire cela d’un Arabe palestinien en Israël aujourd’hui) et toujours actif.
 Voici maintenant un petit livre : Palestine. Pour un féminisme de libération[5]. Professeure et militante palestinienne vivant aux États-Unis, son auteure, Nadia Elia, tout en déconstruisant les associations fallacieuses entre antisionisme et antisémitisme, veut ici rappeler la place des femmes et des personnes queers dans la lutte de libération de la Palestine. Extrait :
Voici maintenant un petit livre : Palestine. Pour un féminisme de libération[5]. Professeure et militante palestinienne vivant aux États-Unis, son auteure, Nadia Elia, tout en déconstruisant les associations fallacieuses entre antisionisme et antisémitisme, veut ici rappeler la place des femmes et des personnes queers dans la lutte de libération de la Palestine. Extrait :
Sur le plan théorique, il est accepté que l’hypermilitarisme, l’occupation et le colonialisme de peuplement sont inévitablement accompagnés de violence fondée sur le genre. Le langage même que nous utilisons pour désigner les actes d’appropriation des terres reflète cette violence. Pensons à l’expression « pénétrer en terre vierge », assez courante à l’époque de la conquête européenne du continent africain, ou au « viol de Gaza », que nous entendons à chaque assaut israélien sur la région assiégée. Et les hommes dont la terre est conquise sont considérés comme « émasculés », puisque leur incapacité à protéger la terre signifierait qu’ils sont « efféminés ». Il s’agit d’un langage de domination et de violence hautement sexualisé. Bien sûr, nous sommes malheureusement habitué·es aux termes « pillage » et « incendie » qui accompagnent la conquête, et nous savons que les femmes sont des « butins de guerre ». Où que nous regardions, la violence fondée sur le genre est une partie intégrante du colonialisme de peuplement. En tant que puissance d’occupation militaire brutale qui étend illégalement ses colonies, Israël ne fait pas exception à ce constat. Plus précisément, si Israël considère une certaine population – soit une population autochtone occupée, dépossédée, et privée de ses droits – comme une « menace démographique », alors son attitude est à la fois raciste et genrée.
Le contrôle raciste de la population repose spécifiquement sur la violence contre les femmes. Il n’est donc pas surprenant que Mordechai Kedar, un ancien officier de renseignement militaire israélien devenu universitaire, suggère de manière pragmatique que « violer les femmes et les mères des combattants palestiniens » dissuaderait les militants du Hamas d’attaquer. De même, la députée israélienne Ayelet Shaked a ouvertement appelé au meurtre d’enfants palestiniens, en affirmant que les femmes palestiniennes doivent aussi être tuées, car elles donnent naissance à de « petits serpents ».
Pour autant, Nadia Elia refuse les discours qui parlent de nombres disproportionnés de victimes femmes et enfants :
En réalité, chaque politique israélienne, chaque assaut israélien, chaque massacre peut être nommé « Opération tuez tout le monde » : hommes, femmes, enfants, personnes âgées, hétérosexuelles et LGBT+, chrétiennes et musulmanes. Le féminisme ne devrait pas s’intéresser à un seul segment de la population, et ignorer d’autres communautés opprimées ; l’ensemble des Palestinien·nes sont opprimé·es par Israël. […]
Même si nous nous concentrons sur la manière dont les politiques d’Israël affectent les femmes, les enfants et les personnes queers de la Palestine, nous devons garder à l’esprit que le féminisme intersectionnel ne se limite pas à améliorer les conditions de certaines personnes en particulier. L’ensemble des Palestinien·nes souffrent de l’occupation israélienne, tout comme l’ensemble des Autochtones d’Amérique ont souffert du vol de cette terre par l’Europe, et tout comme l’ensemble des Afro-Américain·es ont souffert de l’esclavage et continuent de souffrir du racisme institutionnel et de la violence structurelle.
J’ai encore dans ma musette le dernier numéro (25, sorti en novembre 2024) de la Revue du Crieur – dernier au deux sens du terme : le dernier en date, mais aussi le dernier tout court, puisque cette revue publiée depuis 2015 par les éditions La Découverte et Mediapart a choisi de tirer sa révérence. Dommage, c’était une revue intéressante qui donnait toujours de quoi penser… Son dernier numéro, donc, ne déroge pas à la règle et consacre un dossier conséquent à « La solitude de Gaza ».
 Thomas Vescovi donne un article sur les opposants israéliens à la guerre : traumatisés comme le reste de la société israélienne par l’attaque du 7 octobre 2023, les militants pacifistes, progressistes ou révolutionnaires doivent se positionner face à la guerre – mais comment s’opposer, en Israël, à une opération militaire soutenue par l’ensemble de la société ? Thomas Vescovi enquête ainsi sur un « camp de la paix déboussolé mais toujours existant ». Meryem Belkaïd, elle, décrit le « bras de fer mondial autour de la colonialité d’Israël », qui fait l’objet d’un débat acharné. Invisibilisée par les défenseurs de la politique israélienne, qui taxent d’antisémitisme tout regard critique sur l’histoire d’Israël, elle est au cœur due l’argumentation des militants de la cause palestinienne, qui s’appuient notamment sur l’historiographie du colonialisme de peuplement. Marion Slitine s’intéresse à l’aspect culturel, plus exactement de « culturicide » de la guerre contre Gaza. « Nous combattons des animaux humains et nous agirons en conséquence » , a osé Yoav Gallant, ministre israélien de la Défense, le 9 octobre 2023. On a encore parlé, à la fin de l’année 2024 et au début 2025, de la destruction ou de la mise hors service des derniers hôpitaux de Gaza. Il faut y ajouter la destruction systématique des universités, des lieux de culte musulmans et chrétiens, des sites patrimoniaux – monuments anciens, musées, archives : c’est le traitement réservé aux « animaux humains ». Marion Slitine conclut ainsi son article :
Thomas Vescovi donne un article sur les opposants israéliens à la guerre : traumatisés comme le reste de la société israélienne par l’attaque du 7 octobre 2023, les militants pacifistes, progressistes ou révolutionnaires doivent se positionner face à la guerre – mais comment s’opposer, en Israël, à une opération militaire soutenue par l’ensemble de la société ? Thomas Vescovi enquête ainsi sur un « camp de la paix déboussolé mais toujours existant ». Meryem Belkaïd, elle, décrit le « bras de fer mondial autour de la colonialité d’Israël », qui fait l’objet d’un débat acharné. Invisibilisée par les défenseurs de la politique israélienne, qui taxent d’antisémitisme tout regard critique sur l’histoire d’Israël, elle est au cœur due l’argumentation des militants de la cause palestinienne, qui s’appuient notamment sur l’historiographie du colonialisme de peuplement. Marion Slitine s’intéresse à l’aspect culturel, plus exactement de « culturicide » de la guerre contre Gaza. « Nous combattons des animaux humains et nous agirons en conséquence » , a osé Yoav Gallant, ministre israélien de la Défense, le 9 octobre 2023. On a encore parlé, à la fin de l’année 2024 et au début 2025, de la destruction ou de la mise hors service des derniers hôpitaux de Gaza. Il faut y ajouter la destruction systématique des universités, des lieux de culte musulmans et chrétiens, des sites patrimoniaux – monuments anciens, musées, archives : c’est le traitement réservé aux « animaux humains ». Marion Slitine conclut ainsi son article :
Ce qui se passe en Palestine – et à Gaza en particulier – est un acte qui va au-delà de la destruction physique et qui s’apparente bel et bien à un génocide culturel. Le musellement des voix créatives palestiniennes s’intègre à une politique générale visant à briser également les Palestiniens sur le plan psychique et émotionnel et s’inscrit dans un processus colonial de destruction qui suppose l’annihilation de l’identité palestinienne. En coupant le peuple palestinien de sa propre culture, en tentant de rompre les liens entre son passé et son présent, Israël cherche à effacer tous ses horizons et à le déposséder de son avenir, tout en créant de nouveaux traumatismes qui perdureront sur des générations.
Ce dossier comprend aussi un article passionnant d’Eyal Weizman : « Génocides en miroir. Une histoire allemande » Au printemps 2024, alors qu’Israël écrasait la bande de Gaza sous les bombes, Weizman enquêtait en Namibie pour son organisation Forensic Architecture sur les traces du génocide perpétré par l’Allemagne en 1904 contre les Ovaherero (plus connus en Europe comme « Herero ») et les Nama, dans sa colonie qu’elle nommait Sud-Ouest africain – la future Namibie. Cent vingt ans après ce qui fut probablement le premier génocide du XXe siècle, le 11 janvier 2024, l’Afrique du Sud attaquait Israël devant la Cour internationale de justice à la Haye pour ses actions de « nature génocidaire » contre les Palestiniens. Les avocats qui présentaient la requête estimaient alors le nombre de morts palestiniens à 23 000[6] et mentionnaient la destruction de toutes les infrastructures de vie, dont les écoles et les hôpitaux, et le déplacement forcé de la quasi-totalité de la population de Gaza. Israël se défendit le lendemain en objectant que « si actes de génocide il y a[vait], ils [avaie]nt été perpétrés contre Israël ».
Moins de deux heures après qu’Israël eut rendu ses conclusions, écrit Weizman, l’Allemagne se jeta à son secours en annonçant qu’elle intervenait en tant que « tierce partie ». Tout pays signataire de la Convention sur le génocide de 1948 peut en effet présenter des arguments en vue de trancher un contentieux concernant l’interprétation du traité. […]
Un porte-parole de Berlin déclara qu’« à la lumière de l’histoire de l’Allemagne et du crime contre l’humanité – la Shoah –, le gouvernement fédéral se [considérait] comme particulièrement attaché à la Convention de Genève ». En d’autres termes, l’Allemagne estimait détenir une expertise sur ces questions qui lui permettait d’affirmer que les accusations contre Israël n’avaient « strictement aucun fondement » […]
Le 13 janvier 2024 […], le président de la Namibie, Hage Geingob […] rétorqua que l’Allemagne ne pouvait se prévaloir « moralement de son attachement à la Convention de Genève sur le génocide […] dans la mesure où elle apporte son soutien à l’équivalent d’un holocauste et d’un génocide à Gaza ». Il ajouta que l’on attendait toujours du gouvernement allemand qu’il « reconnaisse pleinement le génocide commis sur le sol namibien ».
C’est précisément ce dernier génocide, et la façon dont on en a effacé les traces, que Weizman a été documenter en Namibie. Forensic Architecture s’est en effet engagée depuis plusieurs années à assister les représentants des Ovaherero et des Nama dans leurs recherches pour localiser les anciens villages détruits lors du génocide, de même que les camps de concentration et les charniers, dans le but de pouvoir présenter une demande de préservation de ces sites, de réparations et de restitution des terres. En effet, il faut savoir que bien souvent, ce sont des descendants de la « Schutztruppe », soit la milice qui perpétra les massacres, qui possèdent les fermes et les terres agricoles installées sur ces sites…
On ne peut qu’être frappé, écrit encore Weizman, par les « préoccupantes similitudes entre ce qui s’est joué dans le Sud-Ouest et ce qui se joue aujourd’hui à Gaza », ainsi que Didier Fassin l’a noté quelques semaines après l’attaque du 7 octobre 2023.
C’est une autre de ces similitudes entre les génocides que souligne Mona Chollet dans le « Petit traité de déshumanisation des Palestiniens » qui ouvre ce dossier du Crieur : « Commettre un génocide, dit-elle, implique toujours de commencer par dénigrer la population dont on veut se débarrasser, de la présenter comme une nuisance, comme une menace. » Et de passer en revue les discours haineux et racistes diffusés par la propagande israélienne et complaisamment repris par les médias et les dirigeants politiques occidentaux. Discours qui ont bien souvent atteint leur but : déréaliser la violence déchaînée par l’armée israélienne contre les Palestiniens de Gaza (et de Cisjordanie). Ainsi, dit-elle,
Face à ceux qui expriment leur épouvante devant les crimes perpétrés à Gaza, le premier réflexe de beaucoup de gens est de les soupçonner d’antisémitisme. Cela dit bien l’inconsistance désespérante à laquelle ces crimes restent confinés dans leur esprit, et leur incapacité à percevoir les Palestiniens comme des êtres humains à part entière, avec une individualité, une sensibilité, une valeur, des droits élémentaires ; comme des gens qui aiment, réfléchissent, souffrent, rêvent, et qui méritent la considération, la protection, la liberté, la justice.
Afin de prendre conscience de cette réalité, il n’est rien de plus efficace que de lire deux livres récemment parus dans la collection dirigée par Orient XXI chez les amis de Libertalia : le Journal de bord de Gaza de Rami Abou Jamous et Que ma mort apporte l’espoir. Poèmes de Gaza[7].
 Journaliste palestinien de 46 ans vivant à Gaza, Rami Abou Jamous tient depuis février 2024 ce « journal de bord » publié chaque semaine sur Orient XXI.
Journaliste palestinien de 46 ans vivant à Gaza, Rami Abou Jamous tient depuis février 2024 ce « journal de bord » publié chaque semaine sur Orient XXI.
[L]e génocide, mot prononcé sans hésitation[8], écrit Pierre Prier[9] dans sa présentation, Rami l’illustre […] en racontant sa propre histoire et celle de sa famille, son épouse Sabah, leur fils Walid, âgé de 3 ans, et les trois fils de Sabah, Moaz, Sajid et Anas, nés d’un premier mariage. Après le 7 octobre, ils entament un itinéraire sans but qui les conduit dans des « cages », selon sa propre expression, de plus en plus exiguës : expulsés sous les balles de leur appartement de Gaza en même temps que des dizaines de milliers de Gazaouis, ils trouvent refuge dans une seule pièce à Rafah, la ville frontière avec l’Égypte, au sud, qu’ils doivent quitter en catastrophe sous la menace des chars israéliens pour planter une tente à Deir El-Balah, dans le centre de la bande, sur le terrain appartenant à un ami. Leur espace se rétrécit encore avec l’arrivée de nouveaux déplacés.
Rami Abou Jamous décrit sans détour la « non-vie » qui est devenue la sienne, où le mot « humiliation » revient comme un leitmotiv. L’humiliation de ne pouvoir acheter du poulet à un enfant qui a faim, l’humiliation de vivre sous une tente[10] avec les mouches et les serpents, l’humiliation de vivre de plus en plus en haillons, avec un seul pantalon qui se déchire. Il est à la fois l’observateur et le sujet. Il fait partie de la catastrophe, et il a décidé qu’il ne pouvait plus la décrire de l’extérieur, comme si elle ne lui arrivait pas à lui aussi. Avec l’obsession de garder malgré tout la dignité, vertu enseignée par son père. Même si pour cela Rami a dû, comme il le dit « sacrifier sa vie privée ». le prix à payer est élevé quand on appartient à une société conservatrice qui place très haut la pudeur et le respect de l’intimité familiale. […]
Au-delà du témoignage, la langue de Rami Abou Jamous ajoute un chapitre à l’histoire de l’anéantissement, auprès de Primo Levi ou d’Imre Kertész.
Et Pierre Prier cite un passage du Journal qui m’avait moi-même frappé lorsque je l’avais lu en ligne sur Orient XXI[11] :
Cette guerre, c’est comme vivre vingt-quatre heures sur vingt-quatre dans une tornade qui tourne et qui tourne… Nous sommes tous dans cette espèce de mixeur. De temps en temps, quelqu’un est éjecté du mixeur parce qu’il est mort. Mais nous on reste là, dans le mixeur. Il nous mixe dans la misère et la peur, dans l’inquiétude, dans le danger, dans les bombardements, les massacres et les boucheries. Et dans le mixeur nous n’arrivons même pas à exprimer notre tristesse, pour saluer les morts comme ils le méritent.
Il faut absolument lire ces chroniques poignantes, pleines de colère, d’angoisse et de tendresse, qui restituent « aux Palestiniens leur identité, leur humanité, leurs souffrances et leurs cauchemars , mais aussi leurs rêves et leur attachement à la vie[12] ».
Le Journal de bord de Gaza a remporté deux récompenses au prix Bayeux des correspondants de guerre le 12 octobre 2024 : le prix de la presse écrite et le prix du quotidien Ouest-France.
Les Poèmes de Gaza sont une lecture tout aussi indispensable, me semble-t-il. Voici un extrait de la préface de la traductrice Nada Yafi, qui peut d’ailleurs aussi bien s’appliquer au journal de bord de Rami Abou Jamous, même s’il peut paraître plus prosaïque au premier abord.
Dans la langue arabe, le même mot chahada signifie à la fois « martyre » et « témoignage[13] ». Face à une offensive qui s’en prend aux forces de l’esprit autant qu’aux moyens de subsistance, en visant tant les habitations, les hôpitaux, les services sociaux que les lieux de culte et de culture, écoles, universités, théâtres, archives et musées, et jusqu’aux cimetières, lieux de mémoire, en ciblant pareillement, parmi les civils, médecins, intellectuels et journalistes, eh bien face à une telle entreprise éradicatrice, la pensée poétique est à sa manière un acte de résistance, qui s’oppose à la volonté d’annihiler un peuple, une patrie. La poésie est alors un message qui transcende la mort.
La mort a emporté Refaat Alareer le 6 décembre 2023 lors d’un bombardement israélien sur Gaza. Si vous avez tant soit peu suivi l’actualité de Gaza, vous avez probablement déjà lu ce poème, écrit en novembre 2023. Nous terminerons cette revue d’écrits de et sur la Palestine avec lui.
S’il est écrit que je dois mourir
Il vous appartiendra alors de vivre
Pour raconter mon histoire
Pour vendre ces choses qui m’appartiennent
Et acheter une toile et des ficelles
Faites en sorte qu’elle soit bien blanche
Avec une longue traîne
Afin qu’un enfant quelque part à Gaza
Fixant le paradis dans les yeux
Dans l’attente de son père
Parti subitement
Sans avoir fait d’adieux
À personne
Pas même à sa chair
Pas même à son âme
Pour qu’un enfant quelque part à Gaza
Puisse voir ce cerf-volant
Mon cerf-volant à moi
Que vous aurez façonné
Qui volera là-haut
Bien haut
Et que l’enfant puisse un instant penser
Qu’il s’agit là d’un ange
Revenu lui apporter de l’amourS’il était écrit que je dois mourir
Alors que ma mort apporte l’espoir
Que ma mort devienne une histoire
Le 11 janvier 2025, franz himmelbauer, pour Antiopées
[1] Philippe Rekacewicz & Dominique Vidal, Palestine Israël. Une histoire visuelle, Le Seuil, 2024.
[2] Rachad Antonius, La Conquête de la Palestine. De Balfour à Gaza, une guerre de cent ans, éd. Écosociété (Montréal, Québec), 2024.
[3] Voir, entre autres : https://antiopees.noblogs.org/post/2024/10/06/if-not-now-when/
[4] Khalil Tafakji (avec Stéphanie Maupas), 31° Nord 35° Est. Chroniques géographiques de la colonisation israélienne, éd. La Découverte, 2020.
[5] Nadia Elia, Palestine. Pour un féminisme de libération, éd. du Remue-ménage, (Montréal, Québec), 2024.
[6] Aujourd’hui (début janvier 2025) ce nombre s’élève à 46 000 selon les autorités de Gaza, et de nombreux observateurs disent que la mortalité directe et indirecte (maladies, malnutrition, fausses couches et mortalité infantile) peut être plutôt estimée à 300 000, soit 10 à 12% de la population de Gaza. Voir « Un projet génocidaire », interview du Dr Ghassan Abu Sittah, sur le site de l’Agence médias Palestine.
[7] Rami Abou Jamous, Journal de bord de Gaza, éd. Libertalia, coll. Orient XXI, 2024, et Que ma mort apporte l’espoir. Poèmes de Gaza, édition bilingue arabe-français, textes sélectionnés et traduits par Nada Yafi, Libertalia, coll. Orient XXI, 2024.
[8] Rami utilise aussi le mot « Gazacide ». Voir le titre de sa chronique du 26 septembre 2024 : « Pour qualifier ce qui se passe, je ne trouve que “Gazacide”. »
[9] Ancien correspondant en Israël-Palestine, membre du comité de rédaction d’Orient XXI.
[10] Encore la tente est-elle presque un luxe par rapport aux pauvres morceaux de plastique sous lesquels beaucoup d’autres sont contraints de « s’abriter » – les guillemets sont de rigueur, comme l’hiver qui est arrivé à Gaza. Il ne faut pas chercher très longtemps sur le web pour trouver des images d’abris inondés par la pluie au milieu de « camps » envahis par la boue. Rami décrit aussi le manque d’habits – et le froid qui fait grelotter tout le monde, hommes, femmes et enfants qui subissent aussi la malnutrition.
[11] Extrait du Journal daté du 1er juin 2024 : « Une tornade qui tourne, qui tourne, qui nous emporte. »
[12] Extrait de la préface de Leïla Shahid (déléguée générale de Palestine en France 1993-2005).
[13] Même origine du mot français – même si le sens a désormais changé. Le mot vient du latin ecclésiastique martyr : « qui a souffert de la torture et est mort pour attester la vérité de la religion chrétienne ». Il s’agit, selon le Dictionnaire historique de la langue française (Robert), « d’un emprunt au grec martur, forme tardive pour martus, marturos « témoin » (dans la langue juridique), puis, chez les auteurs chrétiens, “celui qui témoigne de la vérité par son sacrifice”. »
