Julie Gervais, Claire Lemercier & Willy Pelletier, La Haine des fonctionnaires, Éditions Amsterdam, 2024
 Il s’agit bien de la haine contre les fonctionnaires, pas de celle de ceux-ci contre je ne sais qui. Même s’ils ont des raisons de haïr – et probablement certain·e·s haïssent – les cabinets de conseils genre McKinsey qui se font payer très cher des boulots que les serviteurs de l’État accomplissent gratos, la « très haute » fonction publique, passée de « noblesse d’État » (Bourdieu, c’était une autre époque) à « noblesse managériale (selon les auteur·e·s du livre), les think tanks à la française (genre cette fondation à dormir debout, l’Ifrap « pour la recherche sur les administrations et les politiques publiques », dirigée par des patrons de grandes entreprises… privées, cela va de soi) qui refilent des études bidonnées aux médias, lesquels en font leurs choux bien gras – « il faut être réaliste, le public sera toujours moins efficace que le privé ». Tous phénomènes qui, si l’on y ajoute les restrictions budgétaires (les « dépenses publiques » à diminuer, sujet d’actualité s’il en est) et la « dématérialisation » des services publics, valent aux fonctionnaires, qui n’en peuvent mais, une animosité de plus en plus affirmée de la part… du public, justement.
Il s’agit bien de la haine contre les fonctionnaires, pas de celle de ceux-ci contre je ne sais qui. Même s’ils ont des raisons de haïr – et probablement certain·e·s haïssent – les cabinets de conseils genre McKinsey qui se font payer très cher des boulots que les serviteurs de l’État accomplissent gratos, la « très haute » fonction publique, passée de « noblesse d’État » (Bourdieu, c’était une autre époque) à « noblesse managériale (selon les auteur·e·s du livre), les think tanks à la française (genre cette fondation à dormir debout, l’Ifrap « pour la recherche sur les administrations et les politiques publiques », dirigée par des patrons de grandes entreprises… privées, cela va de soi) qui refilent des études bidonnées aux médias, lesquels en font leurs choux bien gras – « il faut être réaliste, le public sera toujours moins efficace que le privé ». Tous phénomènes qui, si l’on y ajoute les restrictions budgétaires (les « dépenses publiques » à diminuer, sujet d’actualité s’il en est) et la « dématérialisation » des services publics, valent aux fonctionnaires, qui n’en peuvent mais, une animosité de plus en plus affirmée de la part… du public, justement.
Or il ne vous aura pas échappé que les récriminations contre les fonctionnaires, les caricatures qui circulent à leur propos – genre ces types de l’Équipement, au bord de la route, qui sont toujours plusieurs à glander pendant qu’il n’y en a qu’un qui bosse, ces infirmières qui papotent autour d’un café au lieu de s’occuper de vous, ces gens dans les bureaux dont on ne sait pas ce qu’ils foutent, à part vous faire perdre votre temps – à vous qui pourtant n’en avez pas de reste, « Je bosse, moi, Monsieur ! », il ne vous aura pas échappé, donc, que ce concert ininterrompu de médisances (passez donc un moment au zinc d’un bistrot, pour voir, ou plutôt entendre cette basse continue) embrunit nos atmosphères… Quoi que l’on pense des fonctionnaires et du service public (donc de l’État, même si certains fonctionnaires bossent dans le privé et si nombre de services publics sont « délégués » au privé), il faut s’interroger sur les effets de ce dénigrement et de ces mensonges, sur qui les entretient et à qui il profitent – et on voit bien que ce n’est pas à la gauche plus ou moins sociale-démocrate. Il est d’ailleurs assez significatif que cette même gauche ait tout récemment proposé, comme prétendante au poste de Premier ministre, Lucie Castets, une haute fonctionnaire cofondatrice, en 2021, du collectif Nos services publics.
Julie Gervais, Claire Lemercier et Willy Pelletier s’attachent donc, dans ce livre (très) utile qui vient de paraître chez Amsterdam, à démonter les fakes, décortiquer les ragots/rumeurs qui courent sur les fonctionnaires et à comprendre quelle logique politique les sous-tend pour quels résultats, politiques eux aussi, dont on constate la traduction en termes électoraux, entre autres. Ils n’en sont pas à leur coup d’essai : « Le livre que vous avez dans les mains, écrivent-ils (p. 233) résulte de nos rencontres, depuis trois ans, autour d’un premier livre, La Valeur du service public. »
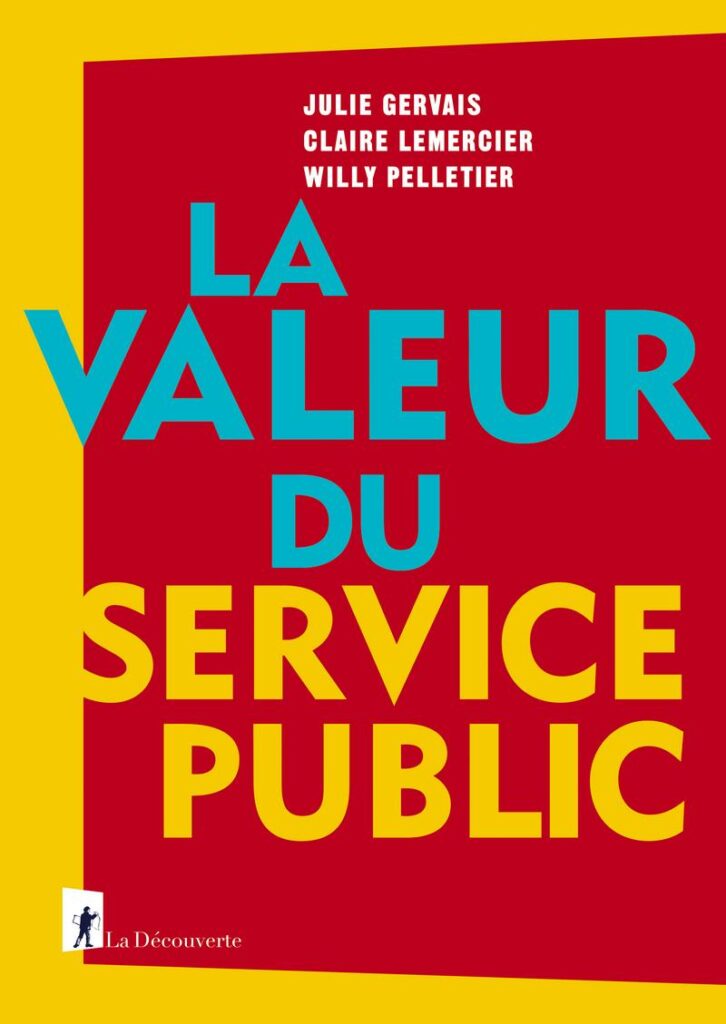 Un gros travail de 450 pages ainsi présenté par l’éditeur (La Découverte) :
Un gros travail de 450 pages ainsi présenté par l’éditeur (La Découverte) :
Des décennies de casse sans relâche : les dernières crises sanitaire et économique en montrent l’ampleur et les dangers. Mais qui veut la peau du service public ? Pourquoi, et au détriment de qui ? Qui sont les commanditaires et les exécuteurs du massacre en cours au nom de la modernisation ? Quels sont leurs certitudes, leur langage, leurs bonheurs et leurs tourments ? Comment s’en tirent les agents du service public quand leurs métiers deviennent missions impossibles ? Comment s’en sortent les usagers quand l’hôpital est managérialisé, quand les transports publics sont dégradés ? Ce livre raconte les services publics : ceux qui ont fait vivre des villages et ceux qui ont enrichi des entreprises, les guichets où on dit « non » et ceux qui donnent accès à des droits. Il combat les fausses évidences qui dévalorisent pour mieux détruire – les fonctionnaires trop nombreux, privilégiés, paresseux. Il mène l’enquête pour dévoiler les motifs des crimes et leurs modes opératoires, des projets de réforme à leurs applications. On entre dans les Ehpad, aux côtés des résidents et du personnel soignant, on pousse la porte des urgences, on se glisse dans les files d’attente de la CAF ; on s’aventure dans les grandes écoles, on s’infiltre dans les clubs des élites, au gré de récits et d’images qui présentent les recherches universitaires les plus récentes.
Oh, direz-vous, « massacre », le mot est un peu fort, non ? Voici pourtant ce qu’en disaient les auteur·e·s dans ce premier livre :
Nous utilisons les mots au sens propre. Les « modernisations » entreprises dans les services publics sont, de fait, des massacres. Des violences de masse. Les mots utilisés pour en parler sont trop calmes, impuissants à dire la brutalité. Et c’est à froid, tranquillement, qu’on les lit. Nous restons, quelque effort que l’on fasse, à l’extérieur des peines telles qu’elles sont vécues. Nous qui les écrivons, et qui les traduisons, nous les trahissons[1].
Trahison assez bien ressentie par les premiers et les premières concernées, pour qu’ielles en « rajoutent une couche », comme on dit, lors de rencontres autour du livre.
Souvent des agents publics, en activité ou en retraite, des fils ou nièces de fonctionnaires et de précaires du public aussi, marqués par la souffrance, le dévouement ou le ras-le-bol de leur mère ou de leur oncle. Des gens qui nous ont raconté ce qui s’était passé depuis l’écriture de ce premier livre, le raz-de-marée de la dématérialisation en particulier, emportant pour certains le dernier espoir d’un service public humain.
Donc nos auteur·e·s ont remis l’ouvrage sur le métier. Cela donne un livre plus bref (250 pages), probablement plus « nerveux » (je dis probablement car je n’ai pas lu le premier, qui pourtant semble valoir le détour si j’en juge par l’extrait publié sur Contretemps), et toujours d’une grande actualité : j’ai déjà évoqué la question de la soi-disant indispensable « réduction des dépenses publiques » qui est un des mantras du gouvernement actuel comme de son prédécesseur – dans ce contexte, parions que les « massacres à la modernisation » des services publics, vont se poursuivre et, les accompagnant et les justifiant, le bashing systématiquement organisé contre les fonctionnaires. Celui-ci « procède, pour une large part, d’une rencontre de trois mouvements de longue durée, qui se renforcent mutuellement ». Tout d’abord, poursuivent Gervais, Lemercier et Pelletier dans une heureuse formule : « la réévaluation des idées du marché sur le marché des idées, à l’œuvre depuis quarante ans ». Des pseudo-intellos se sont bâtis des carrières en assénant des lieux communs du genre « l’argent va aux salaires de la fonction publique au lieu d’aller aux entreprises ». Il fallait de la « flexibilité », du risque, de l’initiative, des privatisations, en somme.
Cet éloge du privé, sans cesse appuyé sur la caricature des fonctionnaires, s’est, depuis les années 1980, diffusé au fur et à mesure de l’expansion et des transformations d’un journalisme économique, de plus en plus dépendant des recettes publicitaires, recrutant en section « éco-fi » (avec formation à la finance) de Sciences Po ou en écoles de commerce. Et propageant le « réalisme économique » et ses « critères d’efficacité » […] Ensuite se sont ajoutés à cela, activant en permanence les mêmes caricatures, une série de fondations financées par des entreprises (comme l’Ifrap ou l’Institut Montaigne) et des professionnels de la politiques liés aux entreprises. De sorte que ces caricatures sont devenues, en certains milieux, comme l’air que l’on respire (pour reprendre ce que le sociologue Émile Durkheim disait des lieux communs).
Deuxième mouvement, l’arrivée d’une vague de managers « réformateurs » (formés dans les mêmes écoles que les journalistes mentionnés plus haut).
[Ils sont] fixés sur le bilan comptable, armés de consultants, validés par des commissions de « personnalités qualifiées » où prédominent les dirigeants d’entreprises. L’inefficacité des agents publics est posée comme postulat. Car « cadrer avec » les compressions de budget devenues lois, ou transférer au privé les segments de secteurs publics profitables à certaines firmes, tout cela s’appuie sur l’inefficience du Public, la lenteur du fonctionnaire peu « activable ».
La diminution du nombre de fonctionnaires (non-renouvellement des départs à la retraite, non-recrutements pour faire face aux nouveaux besoins, etc.) s’accompagne du recrutement massif de contractuels, évidemment plus précaires et donc plus dociles, pardon, « flexibles ».
Un troisième mouvement […] s’accomplit au gré des hostilités quotidiennes (minuscules parfois) et des répulsions spontanées qui opposent les manières d’être et de faire propres à certains milieux populaires, aux façons de se tenir, de parler, d’agir de salariés un peu plus diplômés ou issus des classes moyennes.
Les gens des bureaux, quoi. Ce que l’on oublie alors, c’est que 1), ce genre d’emploi n’est pas toujours très drôle non plus, encore moins dans le contexte de « modernisation » et de dématérialisation évoqué plus haut (plus de contact avec les usagers, ou très peu, et pression incessante des managers) et 2) qu’une très grande partie des agents du service public sont des prolos comme les autres – ainsi par exemple, les agents d’entretien fonctionnaires, toutes spécialités confondues, sont environ 600 000…
Alors, trop de fonctionnaires qui se gavent de nos impôts ? demande le titre d’un des chapitres du livre. Les auteur·e·s relèvent malicieusement cet autre titre de l’historien Émilien Ruiz : Trop de fonctionnaires ? Histoire d’une obsession française (XIXe-XXIe siècle), paru au Seuil en 2021. Émilien Ruiz y montre que ce discours du « trop de fonctionnaires » est apparu en même temps que le mot « fonctionnaire », soit au moment de la Révolution française… Cependant, on n’a jamais été trop d’accord sur quels fonctionnaires seraient surnuméraires, ou, au contraire, indispensables – en gros, flics, gardiens de prisons, infirmières ou enseignants ? Par contre,
Ce que montre Émilien Ruiz, c’est qu’un changement s’est opéré dans ces débats à la fin du XXe siècle. Depuis une trentaine d’années, un seul argument a polarisé tous les débats sur les fonctionnaires et a motivé bien des lois qui ont saccagé leurs conditions de travail : l’argent.
Ritournelle de la dépense publique, etc. Pourtant, comme le font observer nos auteur·e·s, « rien n’interdit d’augmenter les impôts – ou, déjà, d’arrêter de les diminuer – et de débattre de qui, alors devrait payer davantage pour les services publics. » Et de mentionner, entre autres super-riches, les très grandes entreprises. En note de bas de page, ils nous rappellent que
L’économiste Anne-Laure Delatte a chiffré les 185 milliards d’euros par an (en moyenne depuis 2010) offerts en subventions ou, plus souvent, en allègement d’impôts ou de cotisations sociales, sans aucune contrepartie (sans obligation, et souvent, on peut le démontrer, sans résultat en termes d’emploi, de recherche ou autres buts allégués, aux plus grandes entreprises[2].
Un pognon de dingue, comme dirait l’autre. Il est vrai qu’on pourrait peut-être mieux utiliser les deniers publics.
Depuis la loi organique relative aux lois de finances (« LOLF » pour les intimes) de 2001, des règles juridiques et comptables se sont accumulées, difficiles à changer, qui limitent énormément les possibilités quant à la manière de dépenser un budget, une fois que les élus [d’une collectivité, depuis la commune jusqu’à la nation] ont décidé de son volume. Et c’est toujours dans le même sens que cet espace des possibles a été limité : cela conduit à réduire le nombre de fonctionnaires, quitte à dépenser davantage d’argent public pour faire la même chose (ou pour faire moins bien). En demandant au cabinet de conseil McKinsey d’organiser un colloque sur l’avenir du métier d’enseignant pour 496 800 euros, par exemple, alors que des professeurs d’université en sciences de l’éducation font la même chose plusieurs fois par an, sans demander rien en plus de leur salaire d’enseignants-chercheurs. Mais pas seulement : le scandale des cabinets de conseils n’est que la partie émergée de l’iceberg.
Ici, Gervais, Lemercier et Pelletier citent l’humoriste Waly Dia qui s’insurgeait en 2022 contre la règle de la « fongibilité asymétrique ». Avant de l’écouter[3], allez voir en ligne qu’est-ce que c’est que ce truc[4] – ça porte un nom à coucher dehors, mais c’est relativement simple. Résultat, estimé en 2021 par le collectif Nos services publics : « l’État, les hôpitaux et les collectivités payent chaque année à des entreprises (de Challancin [très grosse boîte de nettoyage/entretien] à McKinsey en passant par les sociétés d’autoroutes et Suez) [environ] 160 milliards d’euros ». Merci la fongibilité asymétrique !
Dans le même genre – je veux dire, dans le genre qui se prêterait bien à un sketch de Waly Dia, il y a aussi cette histoire de la dématérialisation des services publics qui déprime tout le monde, en premier lieu les usagers qu’on fait bosser à la place des fonctionnaires pour monter leurs dossiers. Mais bon, déjà, faut savoir faire. Pas évident. Et contrairement à ce qu’on pense généralement, il ne s’agit pas que d’un problème de vieux malhabiles avec les ordis. Ce n’est pas parce que les 18-24 ans ont grandi avec les réseaux sociaux qu’ils maîtrisent la démarche en ligne pour déposer plainte, établir une procuration de vote ou s’inscrire à la fac – logique : c’est assez différent de poster une vidéo sur TikTok. En 2020, un quart d’entre eux ont déclaré avoir rencontré des difficultés pour des démarches numériques : davantage que parmi les adultes plus âgés. Et bien sûr, en plus de la déshumanisation propre au monde des « relations » numériques, il y a encore et toujours ceux qui en tirent profit. C’est là qu’on en arrive au sketch.
Dans les années 2010, une « start-up d’État » (on notera le choc des mots) baptisée « Mes-aides » développe des bases de données colossales – sur fonds publics, donc – permettant de créer un simulateur d’aides. La start-up […] parvient à cartographier le maquis des aides aux individus : pas seulement celles qui s’adressent aux plus pauvres, comme le RSA, mais tout l’argent que chaque personne serait en droit de demander à l’État, pour telle ou telle raison (de l’aide au logement à celle à l’emploi d’une nounou) : plus de mille démarches différentes. La base de données qui les recense, avec leurs conditions d’obtention, porte le doux nom d’OpenFisca.
Dans les années 2020, cette base de données est devenue la base du chiffre d’affaires de différentes sociétés privées, comme mes-allocs.fr ou Wisbii Money, qui fournissent un service de découvertes d’aides publiques et de réalisation de démarches, contre un abonnement mensuel, voire contre un pourcentage des aides récupérées.
Dans le domaine de l’assurance retraite aussi, des entreprises font payer de 300 à 7000 (!) euros par personne les assurés qui veulent savoir ce qu’il en sera de leur pension – vu les conditions de travail des agents des caisses nationales d’assurance vieillesse, et la diminution de leur nombre, ils n’ont plus les moyens de faire correctement leur travail, et la Cour des comptes chiffrait le nombre d’erreurs sur le calcul des nouvelles retraites à une sur sept, et cela en 2022, soit avant la mise en œuvre de la trop fameuse réforme qui va encore compliquer les calculs…
Bon, il y en a – des fonctionnaires – qui n’ont pas ce genre de problème, ce sont les cadres de la « haute fonction publique ». La dernière partie du livre leur est consacrée. Je ne m’y attarderai pas, histoire de ne pas tomber à mon tour dans le « fonctionnaires-bashing ». En effet, le sujet est plus complexe qu’il n’y paraît, et il n’y a semble-t-il qu’une petite partie de (très) hauts fonctionnaires, ceux-là justement qui définissent et appliquent les nouvelles règles genre fongibilité asymétrique, avant d’aller occuper un poste dans le privé, puis de revenir dans un cabinet ministériel, etc. (ce que l’on appelle le « pantouflage ») dont le statut de « noblesse managériale » nous pousserait à des extrémités regrettables… Mais cette troisième partie mérite elle aussi d’être lue, on comprendra mieux comment fonctionne ce « monstre froid » qui nous administre.
Je ne peux que recommander la lecture de ce livre – il ne s’agit pas de se mettre à militer pour une réorganisation « « sociale » de l’État, hein, ce n’est pas dans mes projets… Mais bon, je pense qu’il est important de comprendre un peu mieux comment ça fonctionne, et aussi de se rendre compte qu’il y a parmi ces fonctionnaires pas mal de gens exploités, surmenés et méprisés au même titre que les autres prolétaires[5].
Le 26 septembre 2024, franz himmelbauer pour Antiopées.
Post-scriptum
Ce samedi 28 septembre, je viens d’entendre à France Inter (juste après des infos durant lesquelles a été annoncée, entre deux bombardements au Liban, que l’État français supprimait 50 millions d’euros de sa contribution au budget de La Poste) une émission qui illustre de façon proprement cauchemardesque le propos des auteurs de La Valeur du service public et de La Haine des fonctionnaires : « Secrets d’infos », que l’on peut encore écouter en ligne (prenez la demi-heure nécessaire, ça vaut le détour, sauf évidemment si vous avez le cœur fragile et craignez une montée de colère trop brusque, ou une sensibilité qui ne vous permettrait pas de supporter les situations atroces qui sont évoquées là).
C’est une affaire hors-norme qui sera jugée du 14 au 18 octobre 2024, devant le tribunal de Châteauroux. 19 personnes comparaissent pour, entre autres chefs d’accusations, graves maltraitances sur une vingtaine d’enfants qu’ils ont hébergés entre 2010 et 2017 dans l’Indre, la Haute-Vienne et la Creuse. En toute illégalité. Ces “familles d’accueil” n’ont en réalité jamais obtenu l’agrément officiel des autorités et se sont pourtant vu confier des dizaines d’enfants par l’Aide sociale à l’enfance (Ase) du Nord. (Chapô de l’article publié sur le site de France Inter.)
Un jour un de ces mômes s’est retrouvé au CHU de Limoges, gravement blessé. Après une semaine de coma, lorsqu’il se réveille, il supplie les soignants de ne pas le renvoyer à l’homme chez qui il a été placé, qu’il accuse de traitements violents et inhumains, que l’on peut qualifier de tortures physiques et psychologiques. Enquête, etc. On découvre alors que deux types ont monté une structure d’accueil d’enfants placés, laquelle structure n’a jamais obtenu l’agrément pourtant nécessaire pour se voir confier des enfants. Au cours de l’enquête, on retrouve 19 mineurs passés dans cet enfer et qui ont subi les mêmes maltraitances (coups, menaces, administration de drogues, agressions sexuelles, sans parler des travaux de bâtiments qu’ils devaient exécuter pour leurs bourreaux) que celui qui a le premier donné l’alerte… 19, comme le nombre de familles « d’accueil » (il faut vraiment beaucoup de guillemets) qui marchaient dans la combine. Il faut dire que c’était lucratif : l’État (enfin, l’Ase du Nord) allongeait plusieurs centaines d’euros par enfant et par jour… Au total plusieurs centaine de milliers d’euros. Les deux responsables de l’asso (« Enfance et bien-être », il fallait oser !), qui n’avaient jamais rien déclaré aux impôts, avaient réussi à en exporter une bonne partie en Roumanie, où ils comptaient, ont-ils déclaré, monter… une ferme pédagogique !
C’est vraiment dégueulasse, ça fait penser aux Thénardier… Pourtant, on n’est plus au XIXe, quand Hugo écrivait Les Misérables. Non, mais ce n’est guère mieux : aujourd’hui, ce sont donc les départements qui ont la charge de l’Aide à l’enfance. Dans le Nord, en l’occurrence, le nombre d’enfants placés a beaucoup augmenté : + 13,2% en trois ans, tandis que le nombre de places d’accueil, lui, a diminué pendant la même période. C’est le Département qui a supprimé 400 de ces places. Réductions budgétaires, encore une fois. Sauf que la débrouille de la direction de l’Ase coûte beaucoup plus cher à la collectivité : dans le système officiel, « normal », de placement, les familles perçoivent une centaine d’euros par jour par enfant placé. Elles ont un statut d’agent public. Mais quand le département a recours à des « privés », ou des associations, le débours quotidien peu monter jusqu’à 600 euros ! C’est bien le même processus que celui décrit dans les deux livres dont nous avons parlé ci-dessus : pourquoi faire mieux et moins cher dans le public que quand on peut faire pire hors de prix dans le privé…
L’émission de France Inter décrit aussi le désarroi des éducateurs du Nord, leur détresse même, lorsqu’ils ont appris ce qu’avait fait leur direction. Encore s’agit-il d’un cas extrême. De toute façon, la vie quotidienne de ces éducateurs est rendue de plus en plus difficile par les restrictions de crédits et l’absence de solutions pour prendre en charge les mômes qui en ont besoin – nombre d’entre elleux dépriment, font des burn-out, démissionnent. Même chose, semble-t-il, chez les juges pour enfants. Quand on vous parlait de « massacre » des services publics…
[1] Extrait piqué sur l’excellent site https://www.contretemps.eu/.
[2] Anne-Laure Delatte, L’État droit dans le mur. Rebâtir l’action publique, Fayard 2023.
[4] Sur Wikipédia, par exemple, il y a un article assez clair là-dessus.
[5] Par ailleurs, il faut insister sur les conséquences politiques du massacre des services publics. À cet égard, on trouve un passage très éloquent dans l’extrait auquel j’ai déjà fait référence (note 1) du livre La Valeur du service public :
« De ces “modernisations” décidées très loin, ailleurs, qui subit les effets ? Dans l’Aisne, les communes quasi ruinées, où les anciens sont trop pauvres pour secourir leurs enfants et où les enfants sont trop pauvres pour secourir leurs parents. Dans l’Aisne, les bourgs où déjà il n’y a plus ni bureau de poste, ni classes de primaire, ni médecins, ni infirmières, ni pharmacie, quasiment plus de bistrots, des accès Internet défaillants, et des magasins clos. Pas d’emplois. Dans chaque village, des maisons détériorées, des voitures cabossées, presque hors d’usage, ou seulement des mobylettes pour se déplacer. Les dégradations des routes, leurs usages difficiles ne sont jamais vus par celles et ceux qui ne vivent pas là. Alors qu’ils avivent l’enclavement des plus mal lotis, les solitudes remplies d’amertume. Et ces impuissances face à l’écroulement d’un monde qui ne tient plus, retournées en aigreurs envers quiconque paraît déranger davantage l’ordonnancement de l’univers d’avant. Celui où l’on avait encore l’impression d’avoir tout de même sa place. Les gens qui vivent là, atomisés, avec de moins en moins de relations entre eux, et dépourvus de la force sociale nécessaire pour se faire entendre, sont réduits au silence, si ce n’est au mépris public.
Ces enchaînements inaperçus conduisent aux scores élevés du Rassemblement national. Pour ne citer que quelques communes rurales pauvres de l’Aisne, entre lesquelles beaucoup de routes sont mal entretenues et où les services publics ont fermé, Marine Le Pen a obtenu 59 % des voix à Blérancourt, 61 % à Morsain, 62 % à Saint-Aubin, 63 % à Vézaponin, 68 % à Camelin, 69 % à Selens, au second tour de l’élection présidentielle, en 2017.
Les “modernisations” sont des massacres ? Mais pour qui ? Des nécessités ? Mais pour qui ? Et quels écheveaux de relations donnent force aux “modernisateurs»” ? En quoi leurs forces sont-elles faites de nos faiblesses ? »
