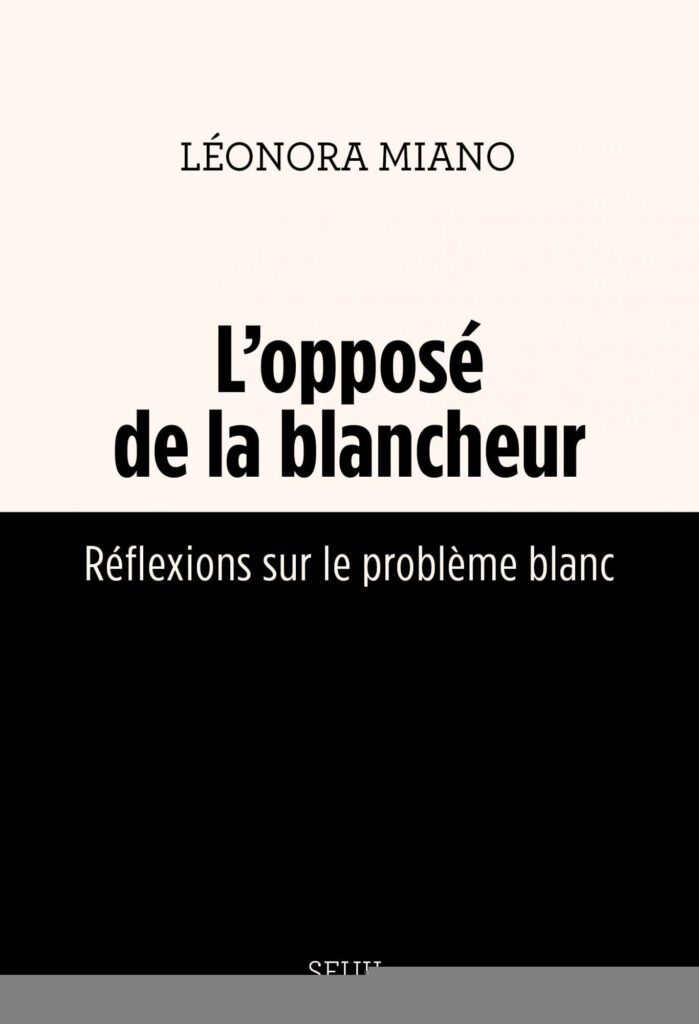 Léonora Miano, L’Opposé de la blancheur. Réflexions sur le problème blanc, Éditions du Seuil, 2023
Léonora Miano, L’Opposé de la blancheur. Réflexions sur le problème blanc, Éditions du Seuil, 2023
Dès le sous-titre, Léonora Miano annonce la couleur, si je puis dire : non, il n’y a pas de « problème noir », pas plus qu’il n’y a de « problème de l’immigration » ou de « problème de genre ». Il n’y a qu’un seul problème, et il est blanc. Homme blanc, dont l’archétype est le Wasp (White Anglo-Saxon Protestant). « La domination d’un Occident raciste, à l’intérieur de ses frontières et au-delà, n’a pu que renforcer les préjugés à l’encontre des personnes définies comme Noires. Parce qu’il en est ainsi, il est illusoire de se dire Blanc par simple convention, sans le moindre rapport avec l’histoire qui créa cette catégorie. » (Quatrième de couverture.) Celui qui rédige ces lignes est blanc, et il a appris quelques petites choses importantes à la lecture de ce livre. Bon, je ne vais pas continuer à la troisième personne, hein.
« Ce que les Blancs doivent faire, c’est essayer de trouver, au fond de leur cœur, pourquoi il fut nécessaire d’avoir un nègre pour commencer. Parce que je ne suis pas un nègre. » James Baldwin
Première chose que j’ai apprise : « La blanchité n’est pas la blancheur ». C’est le titre du premier chapitre. Si j’ai bien compris, le terme sert à désigner un rapport social, pardon racial, et n’a rien à voir avec la couleur[1]. Ce rapport de domination implacable s’établit dès la monstrueuse genèse du capitalisme au sein de la plantation esclavagiste[2]. Et il se maintient depuis, de mal en pis. « Pour que plus d’un milliard et demi d’êtres humains – pour aller vite – soient encore de nos jours incarcérés[3] dans une condition symbolique et politique due à la racialisation négative qui frappa leurs ascendants il y a de cela plusieurs siècles, il faut que se soit mis en place un système particulier. Il faut que l’on veille, de façon plus ou moins consciente, à ce qu’il se maintienne. » (p. 15) Je souligne le « on »… On aura compris qu’il ne s’agit pas des « personnes défavorablement racialisées », comme dit Miano.
« Ce que les Blancs doivent faire, c’est essayer de trouver, au fond de leur cœur, pourquoi il fut nécessaire d’avoir un nègre pour commencer. Parce que je ne suis pas un nègre. » (James Baldwin, cité et traduit par l’auteure, p. 23.) Or nous en sommes loin. C’est ce que Léonora Miano s’attache à démontrer dans ce livre, en s’appuyant sur des lectures, certes, mais aussi beaucoup sur la culture populaire formée par le cinéma et la télévision. Elle montre très bien comment les représentations « naturalisent » le fait racial, à travers toute une série d’analyses de films et de séries, américaines mais aussi françaises.
Ces fictions populaires sont accessibles sans coût exorbitant, la majorité des foyers étant dotés d’un téléviseur. Les choses sont en train de changer, mais la télévision eut longtemps une influence considérable sur la formation des imaginaires. […] Ces fictions se révèlent un riche terrain pour recueillir des informations que des individus n’auraient pas volontiers livrées. En outre, ces productions, dont la narration s’attache à des époques différentes, montrent aussi la manière dont la culture populaire, sans nécessairement que ce soit son objectif, expose le fonctionnement de la blanchité (Introduction, p. 12-13).
Lisant cela, il m’a été difficile de ne pas faire le rapprochement avec la vulgate marxiste que l’on m’avait enseignée, dans ma jeunesse, particulièrement sur le thème de l’« idéologie dominante », d’autant plus invisible qu’elle est dominante (oui, je le reconnais, c’est peut-être très raccourci et simpliste, mais voilà, c’est ce que j’en avais retenu dans ma période gauchiste, c’est vous dire si c’est vieux !). L’idéologie, c’est toujours celle des autres – enfin, celleux qui sont du mauvais côté du manche… Sempiternelle rengaine de la bourgeoisie[4].
Le premier chapitre, donc, est essentiellement consacré à l’analyse, d’abord de la blanchité américaine puis de la blanchité française, et ce à travers de nombreux exemples tirés de films et de séries TV. Même si les deux partagent un fond commun : le suprémacisme blanc, le racisme s’y est affirmé au cours d’histoires différentes – lesquelles se rencontrent en de nombreuses occasions, et plus particulièrement lors de la traite négrière. J’en donnerai seulement deux exemples. Tout le monde sait, ou croit savoir, comme c’était mon cas, que les États du nord et du sud des États-Unis se sont affrontés au cours de ce que l’on a appelé « guerre de Sécession » ou tout simplement guerre civile, laquelle dura de 1861 et 1865 et fut, aux dires de certains historiens, la première des guerres modernes : une guerre totale, industrielle, politique et idéologique. Très meurtrière (de 750000 à 850000 morts selon les estimations les plus récentes, et cela sans compter les très nombreuses victimes civiles), elle eut pour principal motif, nous dit-on, le maintien ou l’abolition de l’esclavage. Or, selon Leonora Miano,
une fois incorporée et intériorisée, la blanchité n’a[vait] plus besoin de l’environnement esclavagiste. Elle s[u]t en transférer les structures, les hiérarchies, dans tout autre milieu. Bien qu’ayant aboli l’esclavage plusieurs décennies avant leurs compatriotes [du Sud], les yankees éprouv[ai]ent à l’égard des descendants de Subsahariens déportés et réduits en esclavage le même sentiment de supériorité, le même mépris que ceux manifestés par les plus racistes parmi les Sudistes. L’Amérique [étai]t à eux, et rien [n’aurait pu] les contraindre à partager ce bien avec des êtres inférieurs (p. 44-45).
En France, les choses étaient différentes : on se livrait au trafic du « bois d’ébène[5] » et on pratiquait l’esclavagisme de plantation, mais pas en métropole. Là existait de longue date un ancien usage qui voulait que le sol français rende libre : un esclave qui y posait le pied se trouvait automatiquement affranchi. Louis XVI y mit bon ordre en 1777 par sa « Déclaration pour la police des Noirs » interdisant que « les Afrodescendants des colonies soient amenés en France hexagonale pour servir leurs maîtres » (p. 59-60). Auparavant, il arrivait que des esclaves échappent à leur propriétaire lors d’un séjour en métropole et deviennent ainsi des hommes libres.
La déclaration de Louis XVI balaie toutes les possibilités qui existaient jusque-là. Et pour s’en assurer, elle n’autorise les coloniaux qu’à amener un seul esclave afin de les servir lors de la traversée. Pendant leur séjour en métropole, cet esclave est remis à un dépôt – sorte de centre de rétention avant l’heure – qu’il ne quitte qu’au moment de retourner aux colonies (p. 61).
À l’école primaire, j’avais appris que Louis XVI était un roi un peu effacé, dont le plus grand plaisir était de s’adonner à l’horlogerie. Je me demande aujourd’hui si l’on ne m’avait pas menti – et si l’on n’a pas bien fait de lui couper la tête, finalement.
« La blanchité lave plus blanc », c’est le titre du second (et dernier) chapitre de ce livre. Leonora Miano y poursuit sa démonstration. Comme l’on dit qu’en démocratie, tous sont égaux, mais que certains sont plus égaux que les autres, sous le régime de la blanchité, parmi les « Blancs », certains sont plus blancs que les autres. Et il ne s’agit toujours pas d’une question de couleur. Voyez par exemple la différence de traitement réservée en Europe de l’Ouest aux Ukrainiens et aux Tchétchènes. Cela se passe de commentaire. De l’autre côté, si je puis dire, un Africain-Américain est un Noir en Amérique, mais un Américain en France. Si vous ne voyez pas ce que cela signifie, lisez le beau roman de William Gardner Smith, Le Visage de pierre[6]. C’est l’histoire d’un Africain-Américain victime de discrimination, comme toutes les personnes de couleur aux États-Unis, et d’une grave agression qui l’a laissé borgne ; il se retrouve à Paris au moment de la guerre d’Algérie. Il se sent d’abord complètement libéré du poids du racisme qui pesait en permanence sur ses épaules dans son pays et trouve que la France est un pays merveilleux. Puis il noue des liens d’amitié avec des Algériens et découvre la réalité qui est la leur, et qui ressemble beaucoup à ce qu’il subissait lui-même aux États-Unis…
Comme toujours dans mes notes de lecture, je n’aurai abordé ici qu’une toute petite partie de l’argumentation serrée de Leonora Miano. Je voudrais cependant conclure avec elle en citant des extraits de sa conclusion, dans laquelle elle se demande : « Que faire de la blanchité ? ». Reprenant la citation de James Baldwin (« pourquoi il fut nécessaire de trouver un nègre pour commencer »), elle ajoute :
Se définir comme Blanc ne fut pas dire comment on avait été constitué physiquement par la nature, par le hasard. Cela consista à se donner le droit de nier l’humanité d’autres, de leur imposer une manière d’être au monde, de piller leurs ressources, de redéfinir leur espace de référence, de les mettre à mort quand ils refusaient de se soumettre[7]. La violence de la blanchité a ceci de particulier, par rapport à toutes celles dans lesquelles les humains ne cessent d’exceller, qu’elle se donna pour justification le racisme (p. 148).
On voit bien les dégâts que cela a produits et, depuis des siècles que cela se perpétue, comment les « Blancs » ne peuvent échapper à la blanchité que par un effort conséquent de « déconstruction ». Après avoir cité la définition qu’en donne Derrida[8] , Miano poursuit ainsi :
En ce qui concerne le sujet qui nous intéresse, non seulement cette opération est-elle nécessaire, mais c’est aussi de l’intérieur qu’elle devrait s’effectuer. Or, nous connaissons les réticences d’une majorité de concernés. Ils refusent d’être culpabilisés. Ils en ont assez de rendre des comptes pour des faits s’étant déroulés en leur absence. Ce sont les mêmes qui ne sont pas disposés à restituer les artefacts consignés dans les musées occidentaux[9]. Ce sont les mêmes qui se soucient peu du coût réel de leur confort[10]. Ce sont les mêmes qui ne s’émeuvent guère des traumatismes découlant de la violence coloniale et des empêchements qu’ils induisent[11]. La liste est longue, des hauts faits de la blanchité. La question qui se pose aux sociétés occidentales championnes de la liberté et de l’égalité, est de savoir ce que signifie désormais la blanchité dans la relation avec les peuples du monde. Et pour y répondre valablement, la part silencieuse du discours sur le colonialisme doit commencer à s’énoncer. Qu’est-ce que cette histoire a produit chez les conquérants ? Dans leur intimité, dans leur exercice du pouvoir sur la scène internationale, dans leur traitement des groupes minorisés au sein de leurs sociétés. Il s’agit là d’un travail collectif. Qu’il soit effectué isolément, par quelques personnes de bonne volonté, ne suffira pas à transformer les choses pour nous permettre d’accéder à un autre moment de l’histoire, de créer un monde dans lequel le bien-être des uns ne dépende pas de l’abaissement des autres (p. 151-152).
Mais ce « travail collectif » réclame aussi – avant tout ? – de se rendre capable d’écouter :
L’Europe de l’Ouest continue de faire silence sur la manière dont ses identités furent altérées au contact de l’Afrique. Elle refuse encore de connaître et de revendiquer sa filiation subsaharienne, d’exposer ce qui s’est logé en elle lors du contact avec d’autres. Or, il s’agit bien d’une histoire commune, les mutations qu’elle induit sont observables de part et d’autre. Elles ne se limitent pas à la présence de corps différents dans l’espace public. Elles ont à voir avec le caractère lui-même, la sensibilité, la vision du monde. Les Afrodescendants sont, dans l’Occident postcolonial, ces parents que l’on n’admet pas à la table mais que l’on ne peut chasser de la maison. À travers les pratiques sociales et artistiques qu’ils créent dans les marges où leurs pays les logent, ils dévoilent de plus en plus l’empreinte de l’Afrique sur l’Occident, sur l’Europe de l’Ouest en particulier. Accepter cette marque indélébile, s’en réjouir même, puisqu’elle témoigne d’une imprégnation par l’autre, est le premier acte du désamorçage de la fiction raciale. C’est ce qui pourrait arriver de mieux à la blanchité (p. 162-163).
Tels sont les derniers mots de L’Opposé de la blancheur. Ce qui pourrait nous arriver de mieux pourrait commencer par lire ce livre.
franz himmelbauer, pour Antiopées, samedi 27 janvier 2024.
Post-scriptum : je découvre après l’écriture de cette note que Léonora Miano, en plus de plusieurs autres livres, dont le très beau La Saison de l’ombre[12], a également rédigé l’« Épilogue » de la somme sur Les Mondes de l’esclavage[13]. Justement, ce texte fait écho à La Saison de l’ombre, en ce qu’il traite comme lui des conséquences de la traite sur les côtes d’Afrique de l’Ouest et vers l’intérieur du continent, tâchant de démêler avec finesse les responsabilités diverses de ce crime contre l’humanité, sans occulter celles des Africains qui lançaient des razzias sur des villages afin d’approvisionner les « grossistes » de la côte, lesquels traitaient à leur tour avec les acheteurs Européens. Pour autant, on l’aura compris à la lecture de ce qui précède, elle ne renvoie pas dos à dos les « négriers » blancs et leurs victimes, sous prétexte que celles-ci leur auraient été livrées par des gens originaires du même continent qu’elles. C’est évidemment un peu plus complexe que cela. Craignant probablement, à juste titre, que d’aucuns s’engouffrent dans ce qu’ils croient être une brèche dans la culpabilité des Européens, elle s’autorise tout de même cette mise au point :
Outre un caractère massif que seule l’ampleur du trafic humain oriental supplante, ce qui singularise de manière criante l’esclavage colonial pratiqué par les Européens de l’Ouest dans leurs colonies de l’Amérique et de l’océan Indien, c’est d’abord sa racialisation affichée. C’est d’avoir mis en place ce que la langue française désigne encore ouvertement sous les appellations « Traite des Noirs » ou « Traite négrière », et d’avoir créé des sociétés longtemps fondées sur une hiérarchie raciale. Ensuite, c’est le fait que cette opération transcontinentale ait en grande partie façonné le monde actuel et continue d’influencer les imaginaires contemporains, ce qui n’est le cas d’aucun autre type d’esclavage, quelle qu’en ait été la cruauté. […] La figure du Noir, telle que le monde la connaît aujourd’hui, voit le jour avec l’esclavage colonial européen. Les discriminations dont elle pâtit, les brutalités policières parfois létales qui lui sont infligées dans les pays occidentaux sous le regard effaré du monde, reconduisent les violences d’autrefois et installent, au cœur des rapports humains, la présence d’un passé que l’on n’a pas su transcender. De ce fait, l’humanité n’a pas retrouvé sa conscience d’elle-même comme un corps dont tous les membres sont égaux. L’autre, racialisé, n’est pas le reflet de soi-même[14].
Mais elle plaide dans ce texte en faveur d’une reconnaissance, précisément, de cette complexité, sans laquelle, dit-elle, il ne sera pas possible pour les pays d’Afrique subsaharienne de se (re)construire. Finalement, cet Épilogue forme en quelque sorte le pendant de L’Opposé de la blancheur : si ce dernier est consacré aux effets de l’esclavage sur les descendants des esclavagistes, et à la nécessité qui est la leur de « travailler » cette histoire – les Allemands ont un verbe que je trouve mieux adapté : bewältigen[15] : die Vergangenheit [le passé], ein traumatisches Erlebnis [une expérience traumatisante], ein Trauma [un traumatisme] bewältigen –, l’Épilogue plaide en faveur de la même Bewältigung, mais plus spécialement en Afrique. Par ailleurs, ce qui ne gâte rien, c’est vraiment un très beau texte dans le registre de l’essai, tout comme La Saison de l’ombre l’est dans celui du roman.
[1] Pas plus que l’ordre du genre n’a à voir avec le sexe. Colette Guillaumin nommait « sexage » l’appropriation des « femmes » par les « hommes », par analogie avec l’esclavage, appropriation des « Noirs » par les « Blancs ». Sur la soi-disant « blancheur », on peut aussi renvoyer au livre De quelle couleur sont les Blancs ?, de Sylvie Laurent et Thierry Leclère (dir.), paru à La Découverte en 2013, et qui revient en détail sur la construction historique de cette non-couleur. Et sur la question de la race, le classique récemment traduit en français : Le Contrat racial, de Charles W. Mills, traduit de l’anglais (États-Unis) par Aly Ndiaye alias Webster, Montréal, Québec, éd. Mémoire d’encrier, 2023 [1997].
[2] Ici Léonora Miano cite l’excellente synthèse d’Aurélia Michel (Un Monde en nègre et blanc. Enquête historique sur l’ordre racial, Points/Seuil, 2020, à lire absolument si l’on veut s’instruire sur ces questions) : « Dans la proposition de la Révolution française comme américaine, tout homme pouvait devenir parent, tout homme était naturellement parent. C’est ici que l’expérience atlantique est fondamentale, car, terrifiés à l’idée que les nègres puissent devenir leurs parents, leurs égaux, les élites ont brandi le Blanc, c’est-à-dire un attribut qui ne s’acquiert que d’une seule manière : par la filiation biologique, par la reproduction “naturelle” […] la fiction blanche se nourrit donc d’un fantasme de toute-puissance, en dehors de toute autorité ni juridiction, si ce n’est la loi de la nature qui tend toujours à être celle du plus fort. » (Ibid., p 345-346). Sur le lien entre capitalisme et esclavage, voir Capitalisme et esclavage, d’Eric Williams, 1964 pour l’édition originale, trad. de l’anglais, éd. Présence Africaine, 2020 (1968), et la discussion de sa thèse par Jean-Yves Grenier dans « Capitalisme », in Paulin Ismard (dir.), Les Mondes de l’esclavage. Une histoire comparée, éd. Seuil 2021, p. 907-921.
[3] Incarcérés au propre comme au figuré : voyez plutôt le livre de Michelle Alexander, La Couleur de la justice. Incarcération de masse et nouvelle ségrégation raciale aux États-Unis, Éditions Syllepse, trad. de l’anglais (États-Unis) par Anika Scherrer, 2020 [2010]. Extrait de la quatrième de couverture : « Il y a plus d’adultes africains-américains sous main de justice aujourd’hui – en prison, en mise à l’épreuve ou en liberté conditionnelle – qu’il n’y en avait réduits en esclavage en 1850. L’incarcération en masse des personnes de couleur est, pour une grande part, la raison pour laquelle un enfant noir qui naît aujourd’hui a moins de chances d’être élevé par ses deux parents qu’un enfant noir né à l’époque de l’esclavage. »
[4] Et bam, ça n’a pas manqué : j’avais arrêté de rédiger cet article hier soir (vendredi, avant de le reprendre ce matin samedi 27 janvier) – un peu fatigué, et puis je n’ai pas toujours la plume, pardon le clavier facile, et encore me manque le superbe esprit de synthèse de ces soi-disant experts que l’on entend partout et qui savent tout sur rien ou rien sur tout, bref, deux exemples flagrants de ce que je venais d’écrire me sont tombés dans l’oreille d’abord, puis sous les yeux. Hier soir, j’ai ouï à la radio un certain arch… pardon Attal Gabriel annoncer à des agriculteurs en colère le renvoi aux calendes grecques de la taxation sur le désormais fameux GNR – gasoil non routier –, ajoutant pour faire bonne mesure que c’en est une, justement, de « bon sens paysan ». Lol. Outre que le terme « paysan », selon moi, est quelque peu anachronique, le « bon sens », c’est une locution généralement utilisée pour dire autre chose. Décryptage : « La terre ne ment pas [Pétain] et en plus vous êtes réputés voter (pas comme ces migrants, là) et voter bien [à droite], donc je vous donne ce que vous demandez, même si j’aurais réservé un autre vocable, et l’accueil qui va avec, mettons, à des manifestants écologistes, vous voyez, comme les écoterroristes de Sainte-Soline, par exemple. Mais là, heu, comme dit mon collègue et néanmoins concurrent Darmanin, “on ne répond pas à la souffrance en envoyant des CRS”. » ReLol. Et ce matin, lisant le journal au comptoir de mon zinc préféré, je découvre l’inépuisable sourire scotché sur deux pattes qui nous sert de premier magistrat municipal, se rengorgeant devant l’assistance – entre autres, le préfet, la présidente du Conseil général, etc. – parce que notre bled vient d’être « labellisé » (novlangue de rigueur) « petite ville d’avenir ». Il kiffe. Et voici ce qu’il lâche, l’édile : « On agit en fonction des besoins, pas d’une idéologie. » Ben voyons. C’était déjà son thème central de campagne en 2020 : à lui le concret, le pratico-pratique, le ras des pâquerettes, à ses adversaires (qui n’étaient même pas d’ici, tandis que lui, hein, emmerdait déjà ses petits camarades au collège de la ville)… l’idéologie « gauchiste » . Il n’avait pas été jusqu’à dire, comme l’affirmaient sans vergogne ses prédécesseurs, les « notables » de la IIIe République, que ces affreux communistes (pléonasme dans leur bouche) allaient tout nous prendre, qu’ils voulaient tout mettre en commun – y compris nos femmes – et dépouiller les propriétaires, mais il se situait bien dans le même esprit.
[5] Bernard Michon, « Atlantique : La France a déporté 1,3 millions d’Africains », in Pierre Singaravélou (dir.), Colonisations. Notre histoire, éd. du Seuil, 2023, p. 651.
[6] Christian Bourgois éditeur, trad. de l’anglais (États-Unis) par Brice Matthieussent, 2021 [1963].
[7] Là-dessus, on peut lire, entre autres, Rosa Amelia Plumelle-Uribe, La Férocité blanche. Des non-Blancs aux non-Aryens : génocides occultés de 1492 à nos jours, éd. Albin Michel, 2001, et Jack D. Forbes, Christophe Colomb et autres cannibales, trad. de l’anglais (États-Unis) par Frédéric Moreau, Le Passager clandestin, 2018 [1979, 2008]. J’ai aussi rendu compte ici-même de la Contre-Histoire des États-Unis de Roxanne Dunbar-Ortiz (Wild Project, 2018).
[8] « Il faut entendre ce terme de “déconstruction” non pas au sens de dissoudre ou de détruire, mais d’analyser les structures sédimentées qui forment l’élément discursif, la discursivité philosophique dans laquelle nous pensons. » Jacques Derrida, « Qu’est-ce que la déconstruction ? », Commentaire, vol. 108, n°4, p. 1099-1100.
[9] Vient de paraître à ce sujet À qui appartient la beauté ? de Bénédicte Savoy, avec Jeanne Pham Tran, éd. La Découverte, janvier 2024. Bénédicte Savoy avait déjà publié en 2023 aux éditions du Seuil Le Long combat de l’Afrique pour son art. Histoire d’une défaite postcoloniale.
[10] Là-dessus, deux références : l’excellent Extractivisme de Anna Bednik aux éditions Le Passager clandestin, 2019 [2016], et un compte rendu (encore fait par moi, je recycle) de quatre livres sur « Le dérèglement climatique, les ultras riches, les bobos-bios et les quartiers populaires », à lire ici.
[11] À lire absolument, selon moi, Le Trauma colonial, de Karima Lazali, La Découverte, 2018. Celui-là aussi, j’en ai rendu compte ici.
[12] Prix Femina 2013, ce roman, d’abord paru chez Grasset, est désormais disponible chez Pocket.
[13] Paulin Ismard (dir.), Les Mondes de l’esclavage, op. cit. Ces 1150 pages valent le détour, non seulement pour l’Épilogue, mais aussi pour tout ce qu’elles nous apprennent, et pour la belle ambition de l’ouvrage : « […] si le crime que fut l’esclavage est bien irréparable, au sens où les compensations matérielles et les restitutions, aussi légitimes soient-elles, n’auront jamais le pouvoir de réparer, un futur est à inventer depuis le lieu de ce savoir. “Le futur n’a pas d’ancrage plus solide que le passé car le passé est le seul avenir avéré que nous connaissions ; le passé est la seule preuve que le futur a, en effet, existé”, écrivait Carlos Fuentes. Nous ne pouvons donc “séparer ce que nous sommes capables d’imaginer de ce que nous sommes capables de nous remémorer”. Il existe bel et bien une mémoire du futur, et l’esclavage est une question qui provient de l’avenir, non pas seulement en ce qu’il existe encore et toujours de l’esclavage, mais parce que de ce que nous ferons de son passé se joue une part de notre avenir. » Ibid., Paulin Ismard, « Introduction ».
[14] Ibid., « Épilogue », p. 1089. C’est moi qui souligne, parce qu’il me semble que ces termes de « racialisation » et « racisé » marquent bien le côté actif du racisme : il ne s’agit pas d’une obscure pulsion enfouie quelque part en nous et qui resurgirait à la moindre occasion (donnant raison à Hobbes – l’homme est un loup pour l’homme), mais bien d’une action déterminée.
[15] Bewältigen, qui donne la Bewältigung (féminin), partage semble-t-il une étymologie commune avec Gewalt (substantif féminin) dont la signification, selon le contexte, oscille entre pouvoir, autorité, contrôle et violence (j’espère ne pas trop me tromper, mes cours d’allemand sont si loin…).
