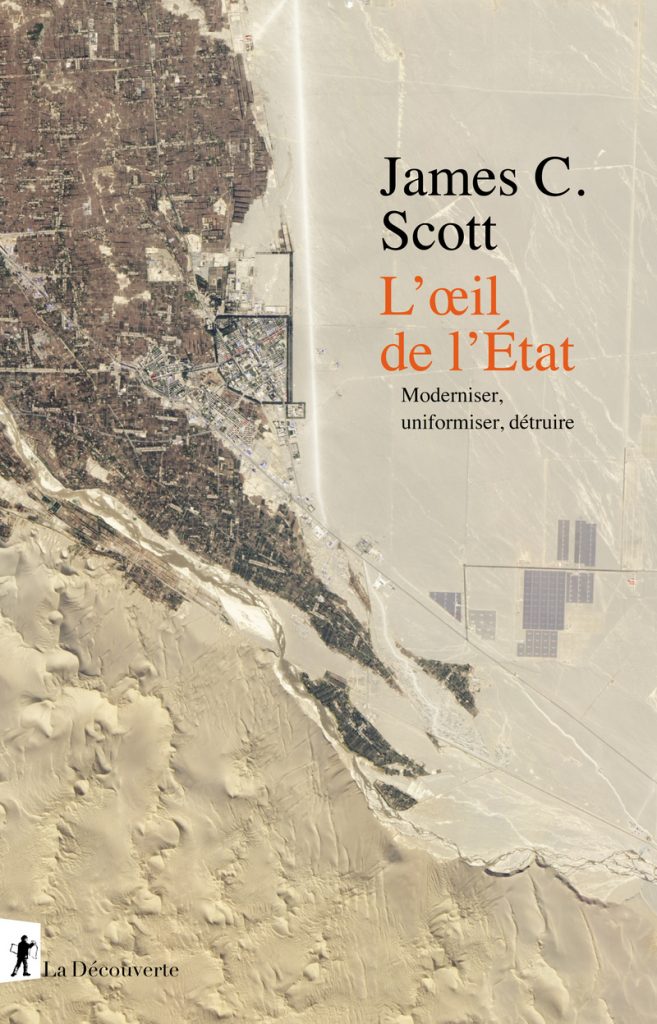 James C. Scott, L’Œil de l’État. Moderniser, uniformiser, détruire, traduit de l’anglais (États-Unis) par Olivier Ruchet, Paris, La Découverte, 2021 [Yale University Press, 1998]
James C. Scott, L’Œil de l’État. Moderniser, uniformiser, détruire, traduit de l’anglais (États-Unis) par Olivier Ruchet, Paris, La Découverte, 2021 [Yale University Press, 1998]
En France, nous commençons à connaître un peu les travaux de James C. Scott puisque plusieurs de ses livres ont été traduits, depuis La Domination et les arts de la résistance (Amsterdam éd., 2009), dont j’ai rendu compte ici-même à l’occasion de sa dernière réédition (même éditeur, 2019) jusqu’à Homo domesticus, paru l’an passé à La Découverte (dont on trouvera une recension sur le blog Bibliothèque Farenheit 451), en passant par Zomia ou L’Art de ne pas être gouverné (Le Seuil, 2013) et Petit éloge de l’anarchisme (Lux éditeur, 2013) ; ces seuls titres laissent comprendre quelle est l’orientation politique de leur auteur. Dans cette série, il nous manquait L’Œil de l’État, qui est semble-t-il son ouvrage le plus connu dans le monde anglo-saxon. C’est une somme, un texte foisonnant (plus de 500 pages bien tassées) appuyé, comme à l’accoutumée chez Scott, sur des centaines de références (ouf, les notes sont en bas de page, merci à l’éditeur). Mais c’est aussi un livre « facile » à lire, pour peu que l’on en prenne le temps – facile d’accès, sans vocabulaire trop spécialisé ni phrases trop longues et complexes.
En introduction, Scott explique que ce pavé « est le fruit d’un détour intellectuel si étourdissant [qu’il a] fini par en abandonner l’itinéraire initial ». Au départ, il avait voulu chercher à comprendre pourquoi l’État a toujours manifesté une certaine hostilité envers « ceux qui ne tiennent pas en place », une question qu’il avait rencontrée lors de ses « terrains » dans le Sud-Est asiatique – et qu’il a développée ensuite dans Zomia – et dont il avait vite compris qu’elle « transcende les frontières géographiques de cette région ». En effet, « les peuples nomades et pastoraux (tels les Berbères ou les Bédouins), les peuplades de chasseurs-cueilleurs, les Roms, les vagabonds et les clochards, les itinérants, les esclaves marrons et les serfs ont toujours été autant d’épines plantées dans le pied des États. » Et ces derniers ont toujours entrepris de les fixer, de les sédentariser. « Plus j’examinais ces tentatives de sédentarisation, plus elles m’apparaissaient comme des tentatives […] de rendre la société lisible, d’arranger la population de manière à simplifier les fonctions étatiques classiques telles la levée des impôts, la conscription et la prévention des révoltes. » Scott y reviendra plus tard dans Homo domesticus, qui est une histoire, ou un essai d’histoire de la naissance des premières formes d’État : l’État prémoderne ne savait pas grand-chose sur la société qu’il prétendait dominer. « Il ne disposait d’aucune “carte” de son territoire ni de sa population. » Il ne possédait pas non plus d’unités de mesures standardisées ni d’outils statistiques qui lui auraient permis d’évaluer les ressources et la production des territoires qu’il « contrôlait » d’une façon encore bien lâche, en conséquence de quoi [ses] actions étaient souvent frustes et vouées à l’échec. » Et c’est là que le « détour » (qui n’en est pas vraiment un, selon moi) a commencé : Scott est passé du « pourquoi » (de l’hostilité de l’État à l’égard des nomades et autres indisciplinés) au « comment » (l’État en est-il arrivé à « mieux connaître ses sujets et son environnement »).
« Soudain, des processus aussi disparates que la création de patronymes permanents, la standardisation des unités de poids et de mesure, l’établissement de cadastres et de registres de population, l’invention de la propriété libre et perpétuelle, la standardisation de la langue et du discours juridique, l’aménagement des villes et l’organisation des réseaux de transports me sont apparus comme autant de tentatives d’accroître la lisibilité et la simplification. Dans chacun de ces cas, des agents de l’État se sont attaqués à des pratiques sociales locales d’une extrême complexité, quasiment illisibles, comme les coutumes d’occupation foncière ou d’attribution de noms propres, et ils ont créé des grilles de lecture standardisées à partir desquelles les pratiques pouvaient être consignées et contrôlées centralement. »
Chacun de ces « processus disparates » fait l’objet d’un chapitre du livre. Et il y a de quoi apprendre… Je ne citerai ici qu’un seul exemple tiré de la section « Création des patronymes » du chapitre 2 : « Villes, langues peuples ». Comme nous le fait remarquer Scott , « Un certain nombre des catégories qui nous sont tout à fait évidentes et à travers lesquelles nous appréhendons quotidiennement le monde social ont pour origine des projets étatiques de standardisation et de lisibilité ». Il en va ainsi des patronymes permanents. Au moins jusqu’au xive siècle, la grande majorité des Européens n’en possédaient pas. « Imaginons, s’amuse Scott, le dilemme d’un percepteur de la dîme ou de la capitation face à une population mâle [en Angleterre] dont 90 % des membres répondaient à un total de six noms de baptême différents (John, William, Thomas, Robert, Richard et Henry). » C’est pourquoi il était crucial pour l’État d’imposer l’usage de « seconds noms » permanents et uniques. Différentes méthodes furent employées à cette fin (entre autres, et pas des moindres, l’établissement des registres cadastraux : si un propriétaire et ses enfants, si pauvres soient-ils, tenaient à conserver leur taudis ou leur lopin de terre, ils avaient intérêt à ce qu’il soit enregistré… « à leur nom », et que ce dernier ne puisse pas être confondu avec un autre, donc qu’il soit un véritable « nom propre »). Les plus caricaturales (et les plus violentes) entreprises d’imposition de noms « propres » eurent lieu aux colonies, où elles ne durèrent que quelques années alors qu’elles avaient pris des décennies, voire des siècles en Europe. Ainsi, en Algérie en mars 1882 fut promulguée par le colonisateur français une loi sur l’état-civil. En effet, ainsi que le rapportait Karima Lazali dans son excellent Trauma colonial :
« L’administration coloniale décid[a] alors de changer le système traditionnel de nomination tribale de chaque individu, jugé trop complexe pour bien identifier les individus. Ce système procédait par un enchaînement de noms, et un renvoi : nom du père, du grand-père, du lieu-dit, etc. Il s’agissait d’un nom qui faisait localité, au sens fort, liant par le père les générations à la terre et à l’histoire. Dans ce système ancestral, le nom du père (lui-même nom de son père, et du père de celui-ci, etc.) et la terre étaient des propriétés collectives, qui rendaient difficile une lisibilité par l’administration coloniale. L’autochtone s’y reconnaissait, alors que le colon s’y perdait. D’où la volonté d’imposer un système de nomination français, avec réduction au prénom et à un nom attribué par l’administration. Lequel était parfois référé au nom de la filiation, mais aussi souvent complètement décroché de toute trace historique et généalogique. » On voit bien le double intérêt de cette opération pour les colons : d’abord, s’y retrouver, savoir qui est qui selon une vision administrative de la « population », mais aussi, en brisant les liens entre le nom et la terre… s’approprier cette dernière, justement : « […] pour l’administration coloniale, cette loi répondait également à l’objectif d’identifier les biens, en particulier les terres de la propriété collective en usage dans le système traditionnel : l’individualisation par des noms fictifs facilitait les transactions immobilières et les expropriations de terres, engagées dès le début de la colonisation. » Je me suis permis de citer ici une de mes précédentes notes de lecture, car le propos de Lazali fait écho de manière frappante à celui de Scott, lequel quant à lui, donne plusieurs autres exemples dont l’un des plus fous se situe aux Philippines sous la colonisation espagnole :
« Par un décret du 21 novembre 1849, on enjoignit aux Philippins d’adopter des patronymes hispaniques permanents. L’auteur du décret, le gouverneur (et lieutenant général) Narciso Claveria y Zaldua, était un administrateur méticuleux, aussi déterminé à rationaliser les patronymes qu’il l’avait été à rationaliser le droit positif, les frontières provinciales et le calendrier. Comme l’indique son décret, il avait observé que les Philippins étaient en général dépourvus de patronymes individuels qui auraient permis de “les distinguer par familles”, et que leur habitude d’adopter les noms baptismaux d’un nombre restreint de saints créait une grande “confusion”. Le remède fut trouvé dans le catalogo, un compendium de noms de familles mais également de noms et d’adjectifs tirés de la flore, de la faune, des minerais, de la géographie et des arts, que les autorités pourraient utiliser afin d’attribuer des patronymes permanents, voués à être transmis d’une génération à l’autre. On confia à chaque administrateur local une liste de patronymes suffisante pour sa circonscription, “en prenant soin que la distribution soit faite par lettres [de l’alphabet]”. En pratique, chaque ville reçut un certain nombre de pages du catalogo (organisé par ordre alphabétique), avec pour résultat que dans des villes entières les patronymes commençaient par la même lettre. Là où la migration interne a été faible au cours des cent cinquante dernières années, les traces de cette réforme administrative sont encore bien visibles […] » Dans le cas de l’Algérie aussi, « cette destruction des généalogies par des attributions de noms, hors histoire et ascendance, s’est parfois effectuée en donnant aux personnes d’un même village des noms commençant par une lettre de l’alphabet identique, afin de les contrôler de manière individuelle et d’éliminer définitivement le collectif tribal : les noms d’un premier village commençaient tous par la lettre A, ceux du suivant par la lettre B., etc. jusqu’au dernier village. »
On a pris ici deux exemples tirés de la colonisation au sens classique du terme, mais l’on comprend bien, à travers eux, comment l’État s’est construit en colonisant ses premiers domaines et les premières populations qu’il a pu soumettre à sa domination. Il s’agissait d’un effort continu, opiniâtre et violent de simplification en même temps que d’atomisation. L’objectif était la lisibilité des populations, de la nature et de toute chose et, à cette fin, la destruction impitoyable de tous les liens enchevêtrés entre les humains entre eux et entre eux et leur environnement, liens qui tissaient au devant de l’œil de l’État un voile d’opacité tendant à rendre impossible toute prétention à sa domination. Il faudrait ajouter ici : destruction des liens internes à la nature elle-même. Ainsi Scott commence-t-il son récit par la parabole de l’État et de la sylviculture scientifique. L’idée que se faisait l’État de la forêt devait pouvoir se résumer à une certaine quantité de bois d’œuvre sur pied, pour aller vite. Seulement, cela éliminait tout le reste de ce qui constituait un écosystème forestier : la plupart des essences d’arbres, jugées non rentables, la faune et la flore estimées « superflues » par les forestiers « scientifiques », ainsi que, bien sûr, les femmes et les hommes qui vivaient en forêt ou sur ses lisières et en tiraient des compléments de ressources (cueillettes, bois mort, petite chasse plus souvent dénoncée comme braconnage) non négligeables. D’après Scott, c’est à des forestiers allemands que l’on doit le développement de la sylviculture scientifique au xviiie siècle. L’idée était de remplacer les anciens domaines forestiers impossibles à « gérer », c’est-à-dire à mesurer précisément et à exploiter commercialement, par des plantations d’arbres rationnelles et transparentes.
« Les anciennes forêts diversifiées, dont environ les trois quarts étaient composées d’essences à feuilles caduques (décidues), furent remplacées par des forêts à dominante de conifères où l’épicéa de Norvège et le pin sylvestre constituaient les principales et souvent les deux seules essences.
À court terme, cette expérience de simplification radicale de la forêt en une marchandise unique connut un grand succès. Ce fut un court terme relativement long, étant donné qu’une génération d’arbres peut prendre jusqu’à quatre-vingts ans pour arriver à maturité. La productivité de la nouvelle forêt mit un terme au déclin de l’approvisionnement en bois domestique, fournit des arbres plus uniformes et de la fibre de bois d’une plus grande qualité, augmenta le rapport économique des terres forestières et diminua de manière appréciable les temps de rotation (le temps nécessaire pour faire pousser un îlot de forêt, l’abattre et en planter un autre). Tout comme des cultures plantées en ligne dans un champ, les nouvelles forêts de résineux produisirent une marchandise unique en quantité prodigieuse. Il n’est en cela pas étonnant que le modèle allemand de sylviculture commerciale intensive se soit imposé à travers le monde. »
Évidemment, après le « court terme », il fallut déchanter. On s’aperçut bien vite que dès la deuxième génération de monoculture forestière, les rendements commencèrent à décroître puis que, comme toute monoculture, celle-ci se révéla beaucoup plus fragile et moins résiliente qu’une forêt diversifiée (développement de maladies, de parasites, vulnérabilité plus grande aux événements climatiques – tempêtes, sécheresse –, sans parler de la perte des autres ressources forestières qui représenta un véritable désastre pour les paysans et les petites gens qui en vivaient.
Si Scott a placé cette parabole au début de son livre, c’est parce qu’elle montre bien comment, dans son souci de lisibilité et de contrôle, l’État n’a jamais hésité à remodeler (on devrait dire élaguer, voire équarrir) la réalité – communautés humaines, villes, environnements naturels et rapports sociaux enchevêtrés – afin de la rendre mesurable, comptabilisable et exploitable à merci.
L’État a besoin d’individus « normaux » comme les forestiers scientifiques ont besoin de « Normalbaüme » (arbres « normaux »). Scott passe donc en revue les différents domaines d’application de cette féroce normalisation (foresterie, agriculture, langues, propriété, urbanisme, etc.) avant d’en venir à l’exacerbation de ce phénomène qu’a connue le xxe siècle : ce qu’il nomme le « haut-modernisme autoritaire ». Et là encore, il étudie plusieurs de ses domaines d’application, avec leur thuriféraires et leurs critiques : la ville haut-moderniste avec les plans délirants de Le Corbusier et la critique de Jane Jacobs, le Parti révolutionnaire avec les plans non moins délirants de Lénine et les critiques de Rosa Luxemburg et Alexandra Kollontaï, puis les expériences désastreuses de la collectivisation en URSS et des stratégies de « villagisation » en Tanzanie et Éthiopie, pour terminer par la « domestication de la nature », soit l’agriculture industrielle et ses ravages en termes de destruction des sols et de la biodiversité. Ce qu’il y a de commun à tous ces processus, c’est l’imposition (ou la tentative d’imposition) d’une vue théorique, « d’en haut » à la réalité « d’en bas » (et à gauche, ajouteraient certain·e·s habitant·e·s des montagnes du Sud-Est mexicain). J’emprunterais une idée à Isabelle Stengers afin de mieux formuler cela : il s’agit de la différence qu’il y a, en traduction, entre thème et version. (J’interprète librement mais, je l’espère, pas faussement cette image qu’elle développe dans Les Faiseuses d’histoire. Que font les femmes à la pensée ?1, écrit avec Vinciane Despret.) On pourrait dire que l’État a un texte en tête et qu’il tâche de le traduire dans la réalité, soit une langue étrangère qu’il doit tout d’abord simplifier avant de pouvoir la conformer à son (pré)texte : l’État comme producteur de thème. Une pensée verticale, qui va du « haut » vers le « bas » – genre Macron lorsqu’il condescend à s’adresser au bas peuple que nous sommes, ou tous ces épidémiologistes et autres virologues qui savent ce qui est bon pour nous, misérables ignorants. A contrario, l’exercice de la version est horizontal. Il ne s’agit pas de tracer un plan puis de le plaquer à la réalité (le thème), mais bien plutôt de tâcher d’observer, de participer, voir de comprendre cette même réalité et de la « traduire », soit d’en tirer quelques modestes leçons – au moins, par exemple, ne pas répéter les erreurs que nous avons déjà commises, ce qui ne serait déjà pas si mal. Cet exercice-là requiert une intelligence sensible et une certaine rouerie, qui nous permettra (peut-être) de contourner les obstacles trop importants ou de ruser avec plus fort que nous afin, sinon de retourner sa force contre lui, du moins de l’utiliser à meilleur escient. C’est quelque chose de ce genre que les Grecs appelaient mètis. James Scott termine justement son livre par un chapitre consacré à la mètis, ce « savoir pratique » qu’il oppose à ce qu’il appelle les « simplifications minces » de l’État. Car à l’instar d’une certaine science, l’État doit se débarrasser de toute source de complexité dans son appréhension et sa préhension de la réalité. Une fois traitée par lui, cette dernière n’a plus aucune épaisseur, elle est réduite à l’image que l’État s’en était faite a priori (toujours le thème).
Je crois que je pourrais écrire encore des heures à propos de ce livre qui me paraît essentiel à bien des égards. Je pourrais aussi émettre quelques réserves, en particulier sur le fait qu’il est trop long. L’éditeur américain aurait probablement dû le raccourcir ou le faire raccourcir par son auteur, car certaines parties sont vraiment trop longues et finalement quelque peu redondantes. Mais c’est un défaut mineur par rapport à tout ce que nous apporte ce texte. C’est pourquoi je le recommande chaudement.
franz himmelbauer
1Paris, les Empêcheurs de penser en rond/la Découverte, 2011.
